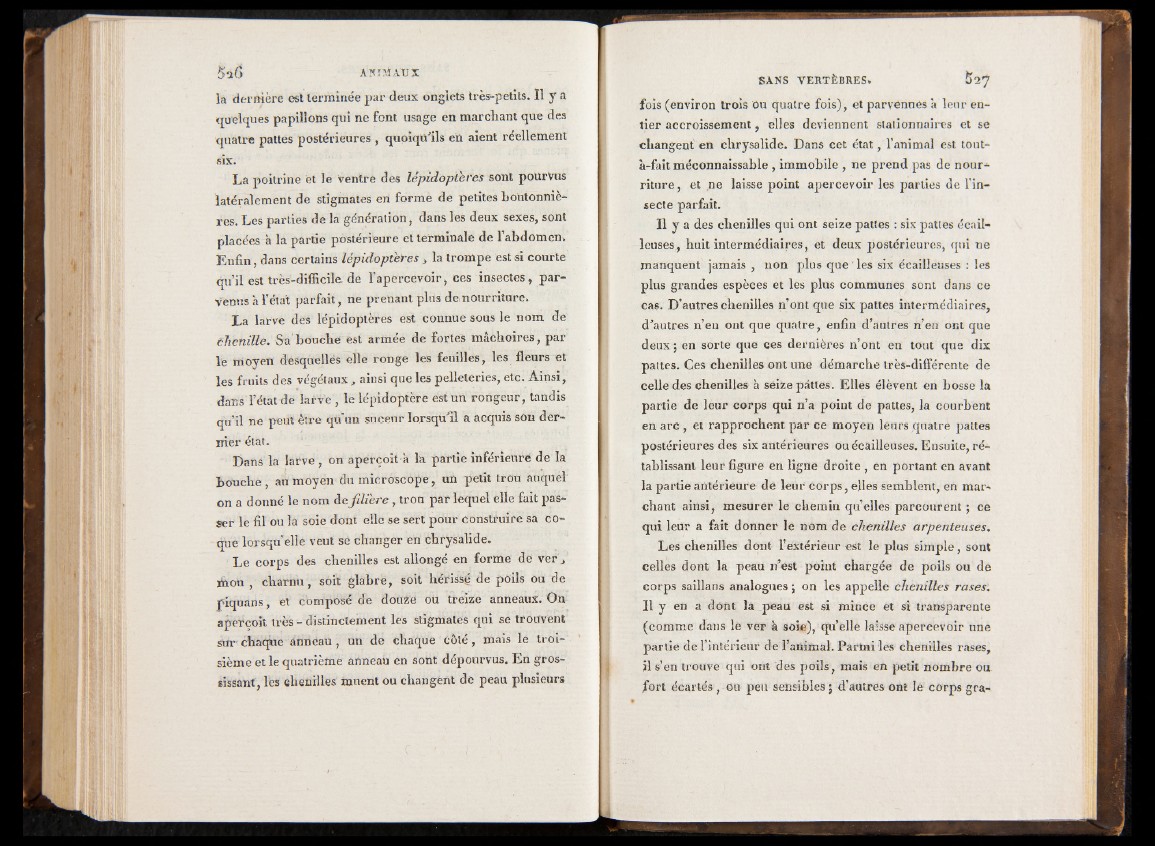
la dernière est terminée par deux onglets très-petits. Il y a
quelques papillons qui ne font usage en marchant que des
quatre pattes postérieures , quoiqu'ils en aient réellement
six.
Là poitrine et le ventre des lépidoptères sont pourvus
latéralement de stigmates en forme de petites boutonnières.
Les parties de la génération, dans les deux sexes, sont
placées à la partie postérieure et terminale de l’abdomen.
Enfin, dans certains lépidoptères > la trompe est si courte
qu’il est très-difficile, de l'apercevoir, ces insectes, parvenus
a l’état parfait, ne prenant plus de nourriture.
La larve des lépidoptères est connue sous le nom de
chenille. Sa'bouche est armée de fortes mâchoires, par
le moyen desquelles elle ronge les feuilles, les fleurs et
les fruits des végétaux, ainsi que les pelleteries, etc. Ainsi,
dans l’état de larve, le lépidoptère est un rongeur, tandis
qu’il ne peut être quun suceur lorsqu'il a acquis sou dernier
état.
Dans la larve, on aperçoit à la partie inférieure de la
bouche , an moyen du microscope, un petit trou auquel
on a donné le nom de filiè r e , trou par lequel elle fait passer
le fil ou la soie dont elle se sert pour construire sa coque
lorsqu’elle veut se changer en chrysalide.
Le corps des chenilles est allongé en forme de ver ,
filou , charnu, soit glabre, soit hérissy de poils ou de
fiquans, et composé de douze ou treize anneaux. On
aperçoit très - distinctement les stigmates qui se trouvent
sur chaque anneau, un de chaque côté, mais le troisième
et le quatrième anneau en sont dépourvus. En grossissant,
les chenilles inuent ou changent de peau plusieurs
fois (environ trois ou quatre fois), et parvenues à leur entier
accroissement, elles deviennent stalionnaires et se
changent en chrysalide. Dans cet état, l’animal est tout-
à-fait méconnaissable , immobile , ne prend pas de nourriture
, et ne laisse point apercevoir les parties de l'insecte
parfait.
31 y a des chenilles qui ont seize pattes : six pattes écailleuses^
huit intermédiaires, et deux postérieures, qui ne
manquent jamais , non plus que les six écailleuses : les
plus grandes espèces et les plus communes sont dans ce
cas. D’autres chenilles n’ont que six pattes intermédiaires,
d'autres n’en ont que quatre, enfin d’autres n’en ont que
deux ; en sorte que ces dernières n’ont en tout que dix
pattes. Ces chenilles ont une démarche très-différente de
celle des chenilles à seize pattes. Elles élèvent en bosse la
partie de leur corps qui n’a point de pattes, la courbent
en arc , et rapprochent par ce moyen leurs quatre pattes
postérieures des six antérieures ou écailleuses. Ensuite, rétablissant
leur figure en ligne droite , en portant en avant
la partie antérieure de leur corps, elles semblent, en marchant
ainsi, mesurer le chemin qu’elles parcourent ; ce
qui leur a fait donner le nom de chenilles arpenteuses.
Les chenilles dont l’extérieur est le plus simple, sont
celles dont la peau n’est point chargée de poils ou de
corps saillans analogues ; on les appelle chenilles rases.
Il y en a dont la peau est si mince et si transparente
(comme dans le Ver à soie), qu’elle laisse apercevoir une
partie de l’intérieur de l’animal. Parmi les chenilles rases,
il s’en trouve qui ont des poils, mais en petit nombre ou
fort écartés , ou peu sensibles j d’autres ont le corps gra