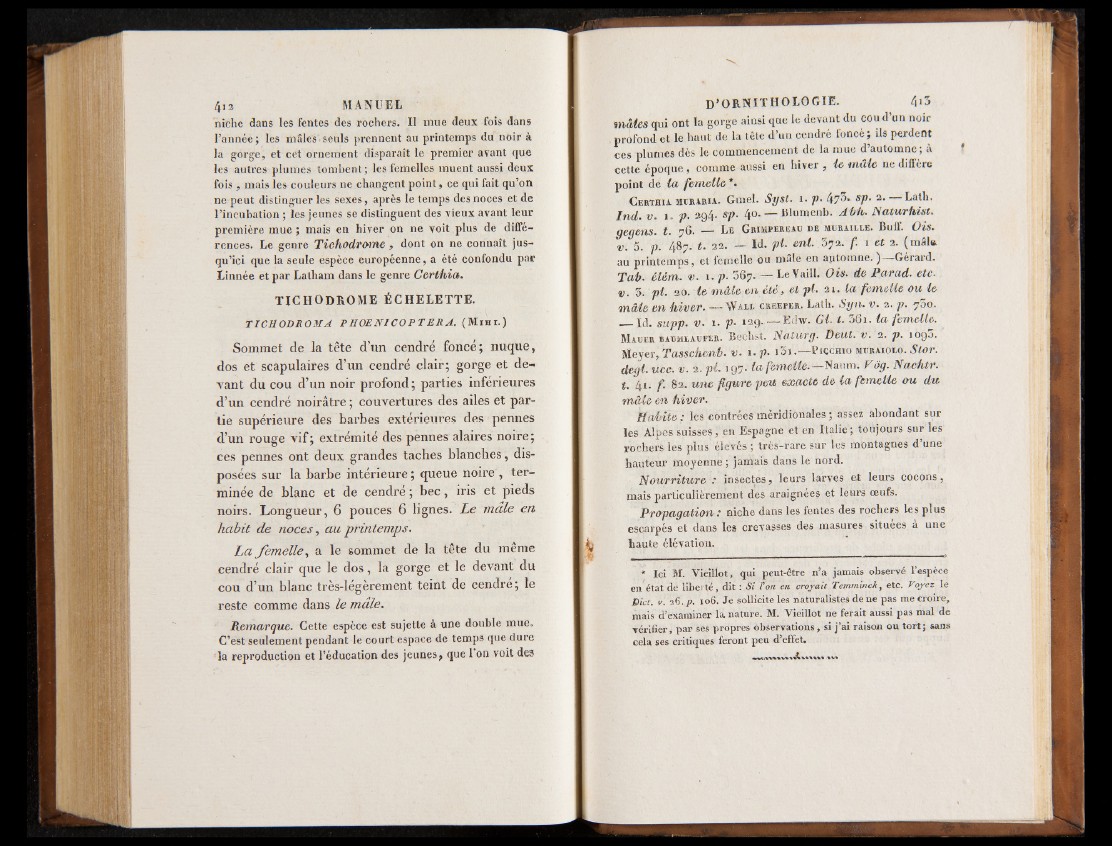
412 MANUEL
niche dans les fentes des rochers. II mue deux fois dans
l’année ; les mâles. seuls prennent au printemps du n&ir à
la gorge, et cet ornement disparaît le premier avant que
les autres plumes tombent; les femelles muent aussi deux
fois , mais les couleurs ne changent point, ce qui fait qu’on
ne peut distinguer les sexes, après le temps des noces et de
l ’incubation ; les jeunes se distinguent des vieux avant leur
première mue ; mais en hiver on ne voit plus de différences.
Le genre Tichodrome, dont on ne connaît jusqu’ici
que la seule espèce européenne, a été confondu par
Linnée et par Latham dans le genre Certhia.
t i c h o d r o m e é c h e l e t t e .
T I CHO D R OMA P HOEJVJ COP T ER A. ( M i h i . )
Sommet de la tête d’un cendré foncé; nuque,
dos et scapulaires d’un cendré clair; gorge et devant
du cou d’un noir profond; parties inférieures
d’un cendré noirâtre ; couvertures des ailes et partie
supérieure des barbes extérieures des pennes
d’un rouge v if ; extrémité des pennes al^ires noire;
ces pennes ont deux grandes taches blanches, disposées
sur la barbe intérieure; queue noire , terminée
de blanc et de cendré ; b e c , iris et pieds
noirs. Longueur, 6 pouces 6 lignes. L e mâle en
habit de noces, au printemps.
L a fem e lle , a le sommet de la tête du meme
cendré clair que le d o s , la gorge et le devant du
cou d’un blanc très-légèrement teint de cendré; le
reste comme dans le male.
Remarque. Cette espèce est sujette à une double mue.
C’est seulement pendant le court espace de temps que dure
la reproduction et l’éducation des jeunes, que l’on voit des
mâles qui ont la gorge ainsi que le devant du cou d’un noir
préfond et le haut de la tête d’un cendré foncé; ils perdent
ces plumes dès le commencement de la mue d’automne ; à
cette époque, comme aussi en hiver , le mâle ne diffère
point de la femelle *•
C e r t h ia m u r a r ia . Gmel. Syst. i. p. 47^* SP‘ Lath.
In d .v . i. p- 294. sp. 40. — Blumenb. Abh. Naturhist.
gegens. t. y6* — Le G r im p e r e a u d e m u r a il l e . Buff. Ozs.
v. S. p. 487. t. 22. — Id. pl. eut. 372. f. 1 et 2. (mâla
au printemps, et femelle ou mâle en automne. ) -Gérard.
Tab. étém. v. 1. p• 367. — LeVaill. Ois. de Parad• etc.
v. 3. pl. 20. le mâle eu été, et pl. 21. la femelle ou le
mâle en hiver. — W a l l c r e e p e r . Lath. Syn. v. 2. p. 7730.
Id. supp. v. 1. p• i2p-—— Edvv. Gl. t. 061. la femelle.
M a u e r b a u m l a u f e r . Bechst. Naturg. Peut. v. 2. p. 1090,
Meyer, Tasschenb. v. i . p• i 3 i .— P ic c h io m u r a io l o . Stor.
degl. ucc. v. 2. pl. 197. la femelle.— Namn. Vôg. Nachtr.
t. 41. f. 82. une figure peu exacte de la femelle ou du
mâle en hiver.
Habite : les contrées méridionales ; assez abondant sur
les Alpes suisses, en Espagne et en Italie; toujours sur les
rochers les plus élevés ; très-rare sur les montagnes d’une
hauteur moyenne; jamais dans le nord.
Nourriture : insectes, leurs larves et leurs cocons,
mais particulièrement des araignée? et leurs oeufs.
Propagation : niche dans les fentes des rochers les plus
escarpés et dans les crevasses des masures situées à une
haute élévation.
* Ici M. Vieillot, qui peut-être n’a jamais observé l’espèce
en état de liberté, dit : Si ton en croyait Temminck, etc. Voyez le
Dict. v. 26 .p. 106. Je sollicite les naturalistes de ne pas me croire,
mais d’examiner la nature. M. Vieillot ne ferait aussi pas mal de
vérifier, par ses propres observations , si j ’ai raison ou tort; sans
cela ses critiques feront peu d’effet.