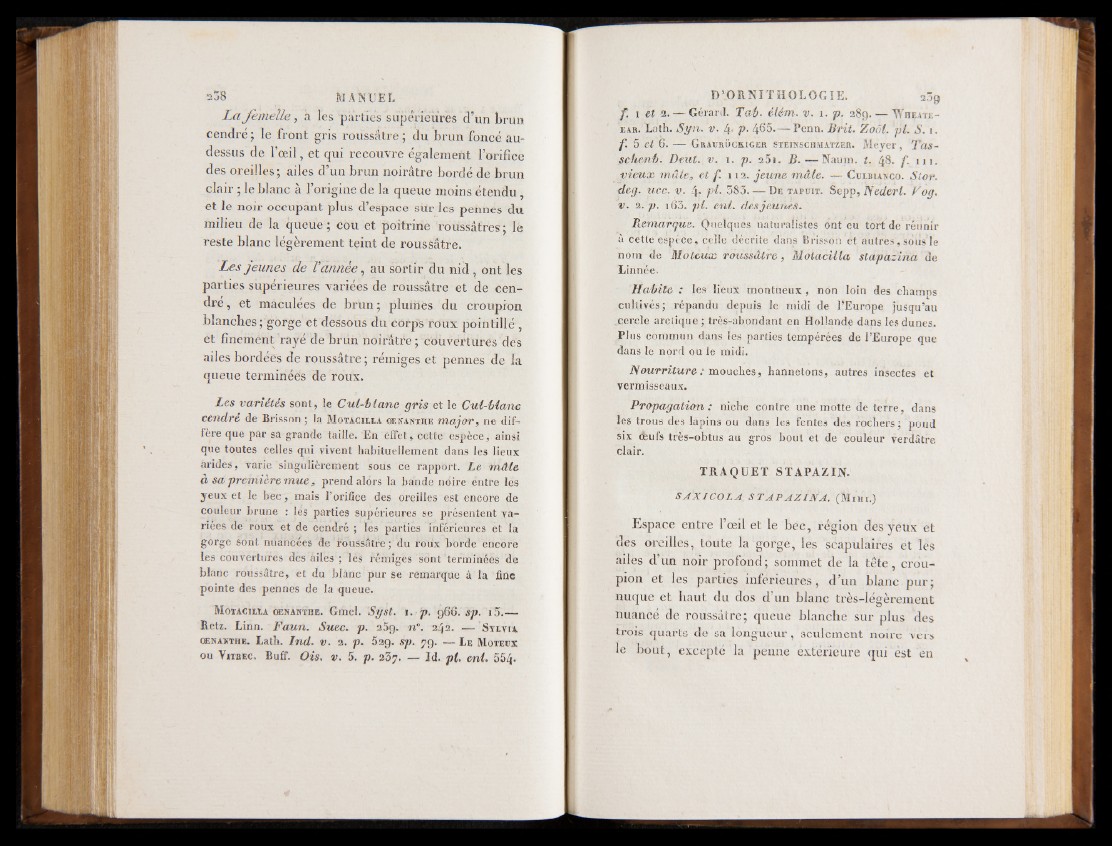
L a fem e lle , à les parties supérieures d’un brüli
cendré ; le front gris roussâtre ; du brun foncé au-dessus
de l’oe il, et qui recouvre également l’orifice
des oreilles; ailes d’un brun noirâtre bordé de brun
clair ; le blanc à l’origine de la queue moins étendu,
et le noir occupant plus d’espace sur les pennes du
milieu de la queue ; cou et poitrine roussâtres ; le
reste blanc légèrement teint de roussâtre.
Les jeunes de Vannée, au sortir du n id , ont les
parties supérieures variées de roussâtre et de cendre
, et maculées de brun ; plumes du croupion
blanches ; gorge et dessous du corps roux p o intillé ,
et finement rayé de brun noirâtre ; couvertures dés
ailes bordées de roussâtre ; rémiges et pennes de la
queue terminées de roux.
Les variétés sont, le Cul-blanc gris et le Cul-blanc
cendré de Brisson ; la M o t a c i l l a o e n a n th e major, ne diffère
que par sa grande taille. En elTet, cette espèce, ainsi
que toutes celles qui vivent habituellement dans les lieux
arides, varie singulièrement sous ce rapport. Le mâle
à sa-premièremue, prend alors la bande noire entre les
yeux et le bec, mais l’orifice des oreilles est encore de
couleur brune : lès parties supérieures se présentent variées
de roux et de cendré ; les parties inférieures et la
gorge sont nuancées de roussâtre; du roux borde encore
les couvertures des ailes ; lès rémiges sont terminées de
blanc roussâtre, et du blanc pur se remarque à la fine
pointe des pennes de la queue.
Motaciixa oenasthe. Gmel. Syst. i. p. 96G. sp. i 5.—
Retz. Linn. Faun. Suec. p. 259. n°. 242. — Sylvia
genawthe. Lath. Ind. v. 2. p. 529. sp. 79. — Le Moteux
ou Yitbec. Buff. Ois. v. 5. p. 237. — Id. pl. ent. 554.
D’ORNITHOLOGIE. 239
f 1 et 2. — Gérard. Tab. élém. v. 1. p. 289. — W h e a t e -
ear. Lath. Syn. v. 4- p• 465. — Penn. Brit. Zoôi. pl. S. 1 .
f. 5 et 6. — G r a t ir ü ck ig e r ste inschmat zer. Meyer, Tas-
schenb. Deut. v. 1 . p. 251 . B .— Naum. 1. 48. f. m .
vieux mâle, et f 1 1 2 . jeune mâle. — C u l b ian co . Si or.
deg. ucc. v. 4 . pl. 383. — D e t a pu it . Sepp, Nederl. Vog.
v. 2. p. i 63. pl. enl. des jeunes.
Remarque. Quelques naturalistes ont eu tort de réunir
à cette espèce, celle décrite dans Brisson et autres, sous le
nom de Moteux roussâtre, Motacilla stapazina de
Linnée.
Habite : les lieux montueux, non loin des champs
cultivés; répandu depuis le midi de l’Europe jusqu’au
cercle arctique; très-abondant en Hollande dans les dunes.
Plus commun dans les parties tempérées de l ’Europe que
dans le nord ou le midi.
Nourriture : mouches, hannetons, autres insectes et
vermisseaux.
Propagation: niche contre une motte de terre, dans
les trous des lapins ou dans les fentes des rochers; pond
six (feufs très-obtus au gros bout et de couleur verdâtre
clair.
TRAQUET STAPAZIN.
S A X I C O L A S T A P A Z I N A . (Mmi.)
Espace entre l’oeil et le bec, région des yeux et
des oreilles, toute la gorge, les scapulaires et les
ailes d’un noir profond; sommet de la tête, croupion
et les parties inferieures, d’un blanc pur;
nuque et haut du dos d’un blanc très-légèrement
nuancé de roussâtre; queue blanche sur plus des
trois quarts de sa longueur, seulement noire vers
le bout, excepté la penne extérieure qui est en