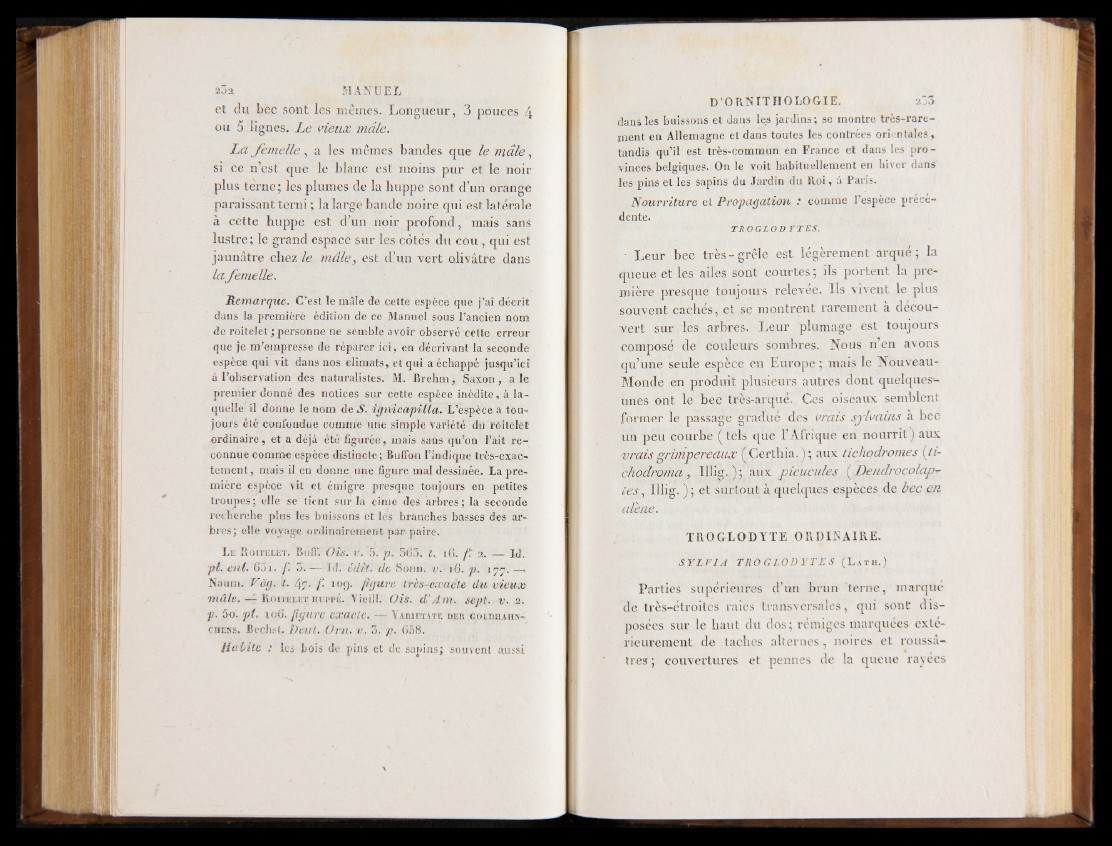
et du bec sont les mêmes. Longueur, 3 pouces 4
ou 5 lignes. L e vieux mâle.
L a ƒ em e lle , a les mêmes bandes que le m â le,
si ce n’est que le blanc est moins pur et le noir
plus terne; les plumes de la huppe sont d’un orange
paraissant terni ; la large bande noire qui est latérale
à cette huppe est d’un noir profond, mais sans
lustre; le grand espace sur les côtés du cou , qui est
jaunâtre chez le mâle, est d’un vert olivâtre dans
lafemelle.
Remarque. C’est le mâle de cette espèce que j’ai décrit
dans la première édition de ce Manuel sous l’ancien nom
de roitelet ; personne ne semble avoir observé cette erreur
que je m’empresse de réparer ici, en décrivant la secondé
espèce qui vit dans nos elimats, et qui a échappé jusqu’ici
à l’observation des naturalistes. M. Brehm, Saxon, ale
premier donné des notices sur cette espèce inédite, à laquelle
il donne le nom de S. ignicapiiia. L’espèce a toujours
été confondue comme une simple variété du roitelet
ordinaire, et a déjà été figurée, mais sans qu’on l’ait reconnue
comme espèce distincte; Buffon l’indique très-exactement,
mais il en donne une figure mal dessinée. La première
espèoe vit et émigre presque toujours en petites
troupes; elle se tient sur la cime des arbres; la seconde
recherche plus les buissons et les branches basses des arbres;
elle voyage ordinairement par paire..
L e .Roitelet. S u f f i Ois. v. 5. p. 565, t. 16. / 2 . — Id.
pi. ont. 601. f. 5 .— Id. tdit. de Sonn. vV 16. p. lyy. —
Naum. Vôg. t. 47. f'- 109. figure très-exacte du vieux
mâle. —- Roitelet huppé. Vieil K Ois. d’Am. sept. v. 2.
p. 5o. pl. 106. figure exacte. — Yabietate de» goidhahn-
çheks. Bechst. Deut. Orn. v. 5. p. 658.
H alite : les bois de pins et de sapins; souvent aussi
D’ORNITHOLOGIE, 2 JO
dans les buissons et dans les jardins; se montre très-rarement
en Allemagne et dans toutes les contrées orientales,
tandis qu’il est très-commun en France et dans les provinces
belgiques. On le voit habituellement en hiver dans
les pins et les sapins du Jardin du Roi, à Paris.
Nourriture et Propagation : comme l’espèce précédente.
TROGLOD YTES.
Leur bec trè s -g rê le est légèrement arqué; la
queue et les ailes sont courtes ; ils portent la première
presque toujours relevee. Ils vivent le plus
souvent cachés, et se montrent rarement à découvert
sur les arbres. Leur plumage est toujours
composé de couleurs sombres. Nous n’ en avons
qu’ une seule espèce en Europe ; mais le Nouveau-
Monde en produit plusieurs autres dont quelques-
unes ont le bec très-arqué. Ces oiseaux semblent
former le passage gradué des vrais sjivains à bec
un peu courbe (tels que l’Afrique en nourrit) aux
vrais grimpereaux (C e r th ia .); aux tichodromes (ti-
chodroma, Illig. ) ; aux picucules ( Dendrocolap-
le s, Illig. ); et surtout à quelques espèces de bec en
ale ne.
TROGLODYTE ORDLSAIR&
S Y L V 1A T RO G L O D Y T E S ( L a th.)
Parties supérieures d’un brun terne, marque
de très-étroites raies transversales, qui sont disposées
sur le haut du dos ; rémiges marquées extérieurement
de taches alternes, noires et roussâ-
tres ; couvertures et pennes de la queue rayées