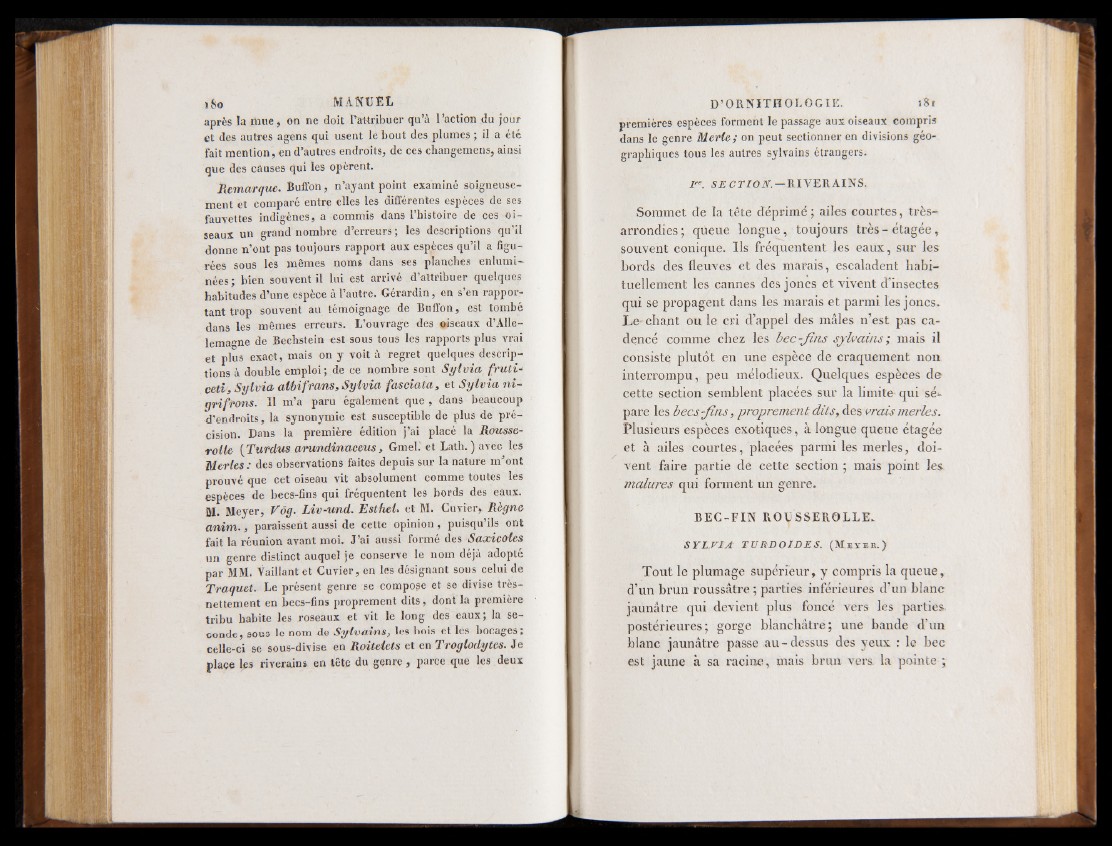
après la mue, on ne doit Fattribuer qu’à l ’action du jour
et des autres agens qui usent lé bout des plumes ; il a été
fait mention, en d’autres endroits, de ces changemens, ainsi
que des causes qui les opèrent.
Remarque. Èuffon, n’ayant point examiné soigneusement
et comparé entre elles les différentes espèces de ses
fauvettes indigènes, a commis dans l’histoire de ces oiseaux
un grand nombre d’erreurs; les descriptions qu’il
donne n’ont pas toujours rapport aux espèces qu’il a figurées
sous les mêmes noms dans ses planches enluminées;
bien souvent il lui est arrivé d’attribuer quelques
habitudes d’une espèce à l’autre. Gerardin, en s’en rapportant
trop souvent au témoignage de Buffon, est tombé
dans les mêmes erreurs. L’ouvrage des oiseaux d’Alle-
lemagne de Bechstein est sous tous les rapports plus vrai
et plus exact, mais on y voit à regret quelques descriptions
à double emploi ; de ce nombre sont Syivia fru ti-
ceti, Syivia albifrans, Syivia fasciata, et Syivia ni-
griftons. Il m’a paru également que , dans beaucoup
d’endroits, la synonymie est susceptible de plus de précision.
Dans la première édition j’ai placé la Rousse-
rolle (Turdus arundinaceus > Gmel.' et Lath. ) avec les
Merles : des observations faites depuis sur la nature m’ont
prouvé que cet oiseau vit absolument comme toutes les
espèces de becs-fins qui fréquentent les bords des eaux.
M. Meyer, Vôg. Liv-und. EstheU et M. Cuvier, Règne
anim., paraissent aussi de cette opinion, puisqu’ils ont
fait la réunion avant moi. J’ai aussi formé des Saxicoies
un genre distinct auquel je conserve le nom déjà adopté
par MM. Vaillant et Cuvier, en les désignant sous celui de
Traquet. Le présent genre se compo.se et se divise très-
nettement en becs-fins proprement dits, dont la première
tribu habite les roseaux et vit le long des eaux; la seconde,
sous le nom de Syivains, les bois et les bocages;
celle-ci se sous-divise en Roitelets et en Troglodytes. Je
place les riverains en tête du genre, parce que les deux
D’ORNITHOLOGIE. i8t
premières espèces forment le passage aux oiseaux compris
dans le genre Merle; on peut sectionner en divisions géographiques
tous les autres syivains étrangers.
I re. SE CTION. — R IV E R A IN S .
Sommet de la tête déprimé ; ailes courtes, très-
arrondies; queue longue, toujours t rè s -é ta g é e ,
souvent conique. Ils fréquentent les eaux, sur les
bords des fleuves et des marais, escaladent habituellement
les cannes des joncs et vivent d’insectes
qui se propagent dans les marais et parmi les joncs.
Le-chant ou le cri d’appel des mâles n’est pas cadencé
comme chez les bec-fins syivains; mais il
consiste plutôt en une espèce de craquement non
interrompu, peu mélodieux. Quelques espèces de
cette section semblent placées sur la limite qui sépare
les becs fin s , proprement dits, des vrais merles.
Plusieurs espèces exotiques, à longue queue étagée
et à ailes courtes, placées parmi les merles, doivent
faire partie de cette section ; mais point les
malures qui forment un genre.
BEC-F IN ROUS SEROL LE.
S Y L .V IA TU RD O I D E S. (M e y e r . )
Tout le plumage supérieur, y compris la queue,
d’un brun roussâtre ; parties inférieures d’un blanc
jaunâtre qui devient plus foncé vers les parties
postérieures; gorge blanchâtre; une bande d’un
blanc jaunâtre passe au-dessus des yeux : le bec
est jaune à sa racine, mais brun vers la pointe ;