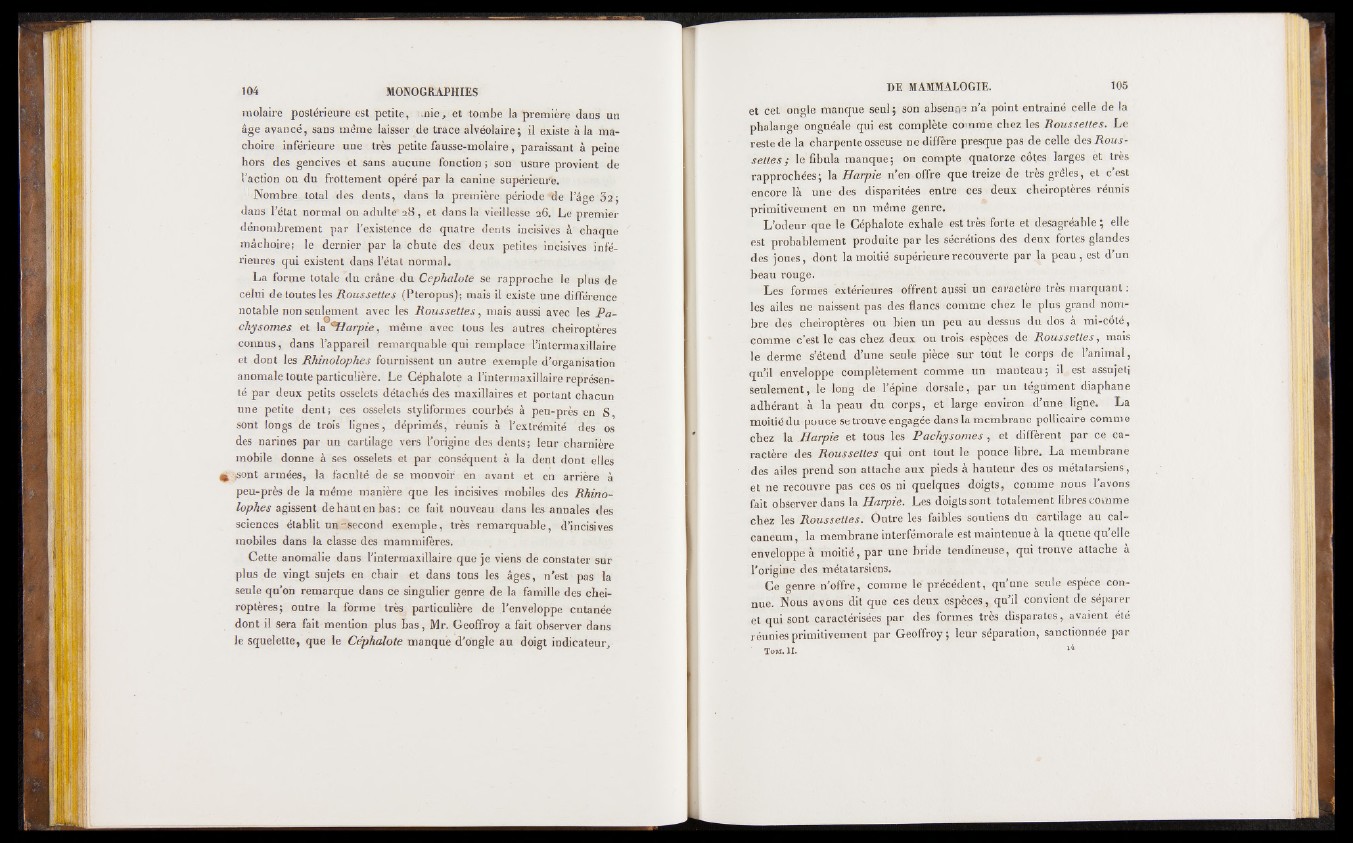
molaire postérieure est petite, .oie, et tombe la première dans un
âge avancé, sans même laisser de trace alvéolaire; il existe à la mâchoire
inférieure une très petite fausse-molaire, paraissant à peine
hors des gencives et sans aucune fonction ; son usure provient de
l’action ou du frottement opéré par la canine supérieure.
Nombre total des dents, dans la première période de l’âge 32;
dans l’état normal ou adulte? 28, et dans la vieillesse 26. Le premier
dénombrement par l’existence de quatre dents incisives à chaque
mâchoire; le dernier par la chute des deux petites incisives inférieures
qui existent dans l’état normal.
La forme totale du crâne du Cephalote se rapproche le plus de
celui de toutes les Roussettes (Pteropus); mais il existe une différence
notable non seulement avec les Roussettes, mais aussi avec les Pa-
chysomes et la h a r p ie , même avec tous les autres chéiroptères
connus, dans l’appareil remarquable qui remplace l’intermaxillaire
et dont les Rkinolophes fournissent un autre exemple d’organisation
anomale toute particulière. Le Céphalote a l’intermaxillaire représenté
par deux petits osselets détachés des maxillaires et portant chacun
une petite dent; ces osselets styliformes courbés à peu-près en S
sont longs de trois lignes, déprimés, réunis à l’extrémité des os
des narines par un cartilage vers l’origine des dents; leur charnière
mobile donne à ses osselets et par conséquent à la dent dont elles
■ »sont armées, la faculté de se mouvoir en avant et en arrière à
peu-près de la même manière que les incisives mobiles des Rhino-
lophes agissent de haut en bas: ce fait nouveau dans les annales des
sciences établit un-second exemple, très remarquable, d’incisives
mobiles dans la classe des mammifères.
Cette anomalie dans l’intermaxillaire que je viens de constater sur
plus de vingt sujets en chair et dans tous les âges, n’est pas la
seule qu’on remarque dans ce singulier genre de la famille des chéiroptères;
outre la forme très particulière de l’enveloppe cutanée
dont il sera fait mention plus bas, Mr. Geoffroy a fait observer dans
le squelette, que le Ce'phalote manque d’ongle au doigt indicateur,
et cet ongle manque seul ; son absence n’a point entrainé celle de la
phalange onguéale qui est complète comme chez les Roussettes. Le
reste de la charpente osseuse ne diffère presque pas de celle des Roussettes;
le fibula manque; on compte quatorze côtes larges et très
rapprochées; la Harpie n’en offre que treize de très grêles, et c’est
encore là une des disparitées entre ces deux chéiroptères réunis
primitivement en un même genre.
L ’odeur que le Céphalote exhale est très forte et désagréable ; elle
est probablement produite par les sécrétions des deux fortes glandes
des joues, dont la moitié supérieure recouverte par la peau, est d’un
beau rouge.
Les formes extérieures offrent aussi un caractère très marquant :
les ailes ne naissent pas dès flancs comme chez le plus grand nombre
des chéiroptères ou bien un peu au dessus du dos à mi-coté,
comme c’est le cas chez deux ou trois espèces de Roussettes, mais
le derme s’étend d’une seule pièce sur tout le corps de l’animal,
qu’il enveloppe complètement comme un manteau; il est assujeti
seulement, le long de l’epine dorsale, par un tégument diaphane
adhérant à la peau du corps, et large environ d’une ligne. L a
moitié du pouce se trouve engagée dans la membrane pollicaire comme
chez la Harpie et tous les Pachysomes, et diffèrent par ce caractère
des Roussettes qui ont tout le pouce libre. La membrane
des ailes prend son attache aux pieds à hauteur des os métatarsiens,
et ne recouvre pas ces os ni quelques doigts, comme nous l’avons
fait observer dans la Harpie. Les doigts sont totalement libres comme
chez les Roussettes. Outre les faibles soutiens du cartilage au calcanéum
, la membrane interfémorale est maintenue à la queue quelle
enveloppe à moitié, par une bride tendineuse, qui trouve attache à
l’origine des métatarsiens.
Ce genre n’offre, comme le précédent, qu’une seule espèce connue.
Nous avons dit que ces deux espèces, qu’il convient de séparer
et qui sont caractérisées par des formes très disparates , avaient été
réunies primitivement par Geoffroy; leur séparation, sanctionnée par
Tom. h . l4