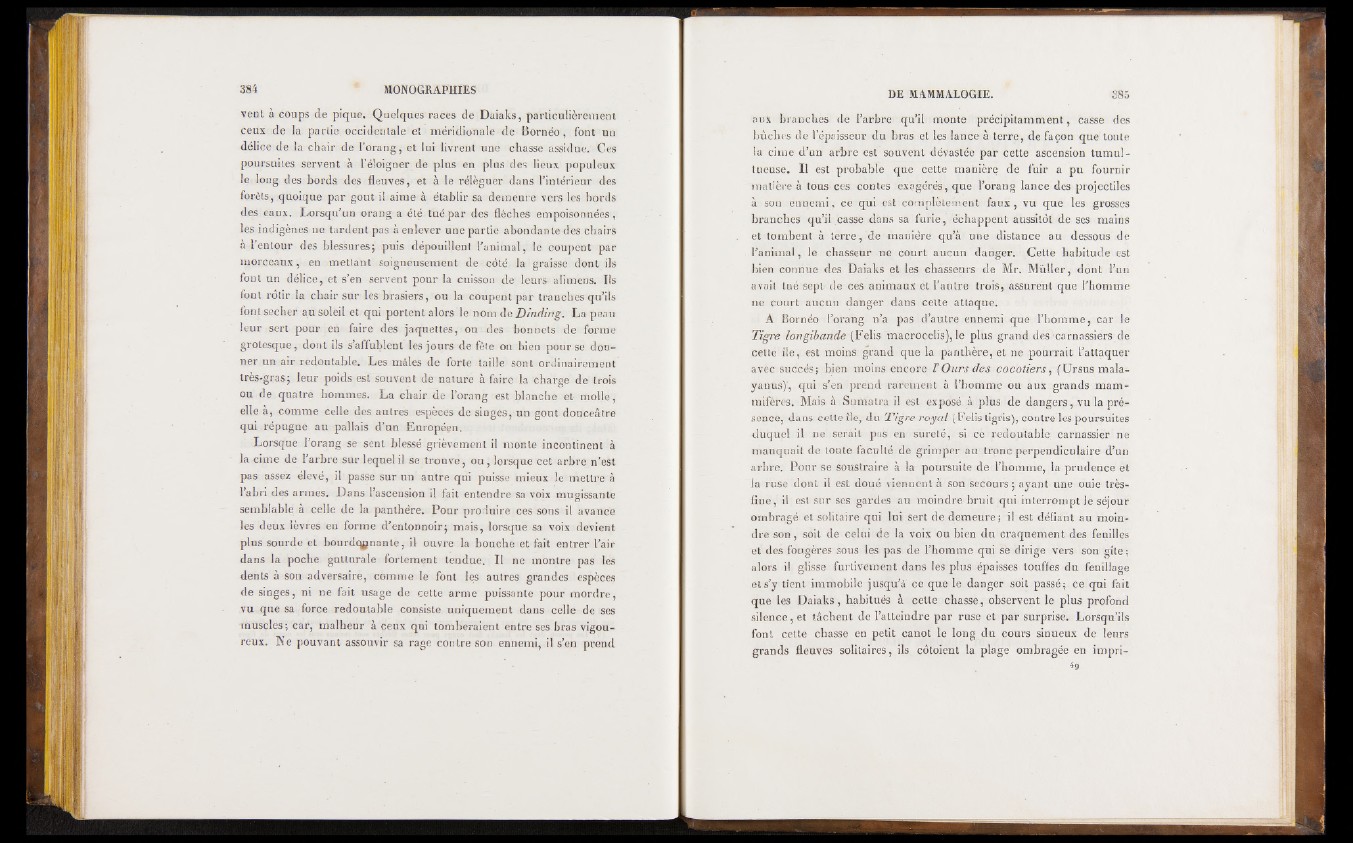
vent à coups de pique. Quelques races de Daiaks, particulièrement
ceux de la partie occidentale et méridionale de Bornéo , font un
délice de la chair de l’orang, et lui livrent une chasse assidue. Ces
poursuites servent à l’éloigner de plus en plus des lieux populeux
le long des bords, des fleuves, et à le rélèguer dans l’intérieur des
forêts, quoique par goût il aime à établir sa demeure vers les bords
des eaux. Lorsqu’un orang a été tué par des flèches empoisonnées ,
les indigènes ne tardent pas à enlever une partie abondante des chairs
à l’enlour des blessures; puis dépouillent l’animal, le coupent par
morceaux, en mettant soigneusement de côté la graisse dont ils
font un délice, et s’en servent pour la cuisson de leurs- ali mens. Ils
font rôtir la chair sur les brasiers, ou la coupent par tranches qu’ils
font secher au soleil et qui portent alors le nom de Dinrfing. La peau
leur sert pour en faire des jaquettes, ou des bonnets de forme
grotesque, dont ils s’affublent les jours de fête on bien pour se donner
un air redoutable. Les mâles de forte taille sont ordinairement
tres-gras; leur poids est souvent de nature à faire la charge de trois
ou de quatre hommes. La chair de l’orang est blanche et molle,
elle à, comme celle des autres espèces de singes, un goût douceâtre
qui répugne au pallais d’un Européen.
Lorsque l’orang se sent blessé grièvement il monte incontinent à
la cime de l’arbre sur lequel il se trouve, ou, lorsque cet arbre n’est
pas assez élevé, il passe sur un autre qui puisse mieux le mettre à
l’abri des armes. Dans l’ascension il fait entendre sa voix mugissante
semblable à celle de la panthère. Pour produire ces sons il avance
les deux lèvres en forme d’entonnoir; mais, lorsque sa voix devient
plus sourde et bourdqgnante, il ouvre la bouche et fait entrer l’air
dans la poche gutturale fortement tendue. Il ne montre pas les
dents à son adversaire, comme le font les autres grandes espèces
de singes, ni ne fait usage de cette arme puissante pour mordre,
vu que sa force redoutable consiste uniquement dans celle de ses
muscles; car, malheur à ceux qui tomberaient entre ses bras vigoureux.
Ne pouvant assouvir sa rage contre son ennemi, il s’en prend
au* branches de l’arbre qu’il monte précipitamment, casse des
bûches de l’épaisseur du bras et les lance à terre, de façon que tonte
la cime d’un arbre est souvent dévastée par cette ascension tumultueuse.
Il est probable que cette manière de fuir a pu fournir
matière à tous ces contes exagérés, que l’orang lance des projectiles
à son ennemi, ce qui est complètement faux, vu que les grosses
branches qu’il casse dans sa furie, échappent aussitôt de ses mains
et tombent à terre, de manière qu’à une distance au dessous de
l’animal, le chasseur ne court aucun danger. Cette habitude est
bien connue des Daiaks et les chasseurs de Mr. Muller, dont l’un
avait tué sept de ces animaux et l’autre trois, assurent que l’homme
ne court aucun danger dans celte attaque.
A Bornéo l’orang n’a pas d’autre ennemi que l’homme, car le
Tigre longibande (Felis macrocelis), le plus grand des carnassiers de
cette île, est moins grand que la panthère, et ne pourrait l’attaquer
avec succès; bien moins encore VOurs des cocotiers, (Ursusmala-
yanus)’, qui s’en prend rarement à l ’homme ou aux grands mammifères.
Mais à Sumatra il est exposé à plus de dangers, vu la présence,
dans celte île, du Tigre royal (Felis ligris), contre les poursuites
duquel il ne seraiL pas en sûreté, si ce redoutable carnassier ne
manquait de toute faculté de grimper au tronc perpendiculaire d’un
arbre. Pour se soustraire à la poursuite de l’homme, la prudence et
la ruse dont il est doué viennent à son secours; ayant une ouie très-
fine, il est sur ses gardes au moindre bruit qui interrompt le séjour
ombragé et solitaire qui lui sert de demeure; il est défiant au moindre
son, soit de celui de la voix ou bien du craquement des feuilles
et des fougères sous les pas de l’homme qui se dirige vers son gîte;
alors il glisse furtivement dans les plus épaisses touffes du feuillage
et s’y tient immobile jusqu’à ce que le danger soit passé; ce qui fait
que les Daiaks, habitués à celte chasse, observent le plus profond
silence, et tâchent de l ’atteindre par ruse et par surprise. Lorsqu’ils
font cette chasse en petit canot le long du cours sinueux de leurs
grands fleuves solitaires, ils côtoient la plage ombragée en impri-
49