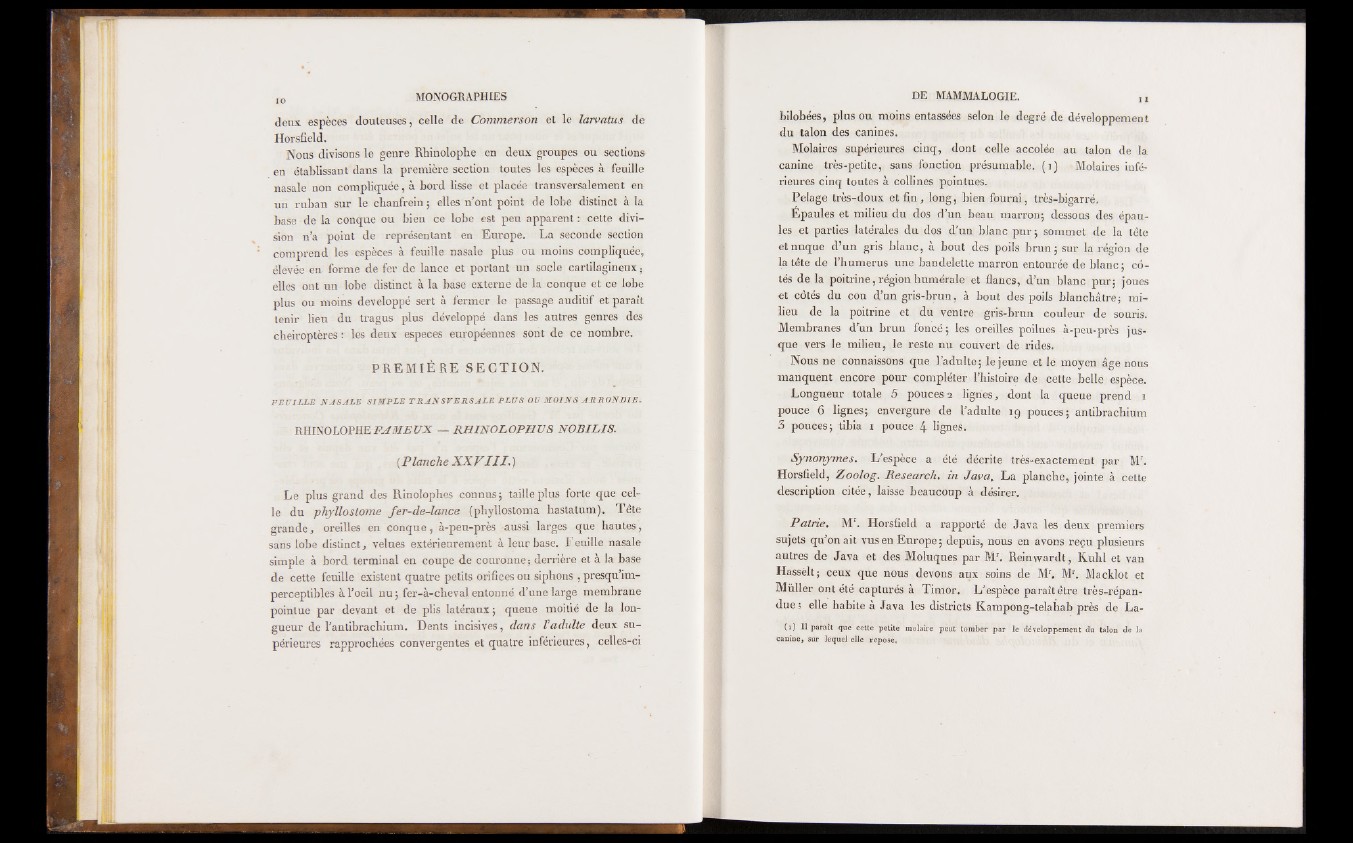
deux espèces douteuses, celle de Commerson et le larvatus de
Horsfield.
Nous divisons le genre Rhinolophe en deux groupes ou sections
en établissant dans la première section toutes les espèces à feuille
nasale non compliquée, à bord lisse et placée transversalement en
un ruban sur le chanfrein ; elles n'ont point de lobe distinct à la
base de la conque ou bien ce lobe est peu apparent : celte division
n’a point de représentant en Europe. La seconde section
comprend les espèces à feuille nasale plus ou moins compliquée,
élevée en forme de fer de lance et portant un socle cartilagineux ;
elles ont un lobe distinct à la base externe de la conque et ce lobe
plus ou moins développé sert à fermer le passage auditif et paraît
tenir lieu du tragus plus développé dans les autres genres des
chéiroptères : les deux especes européennes sont de ce nombre.
P R E M I È R E S E C T I O N .
F E U I L L E N A S A L E S IM P L E T R A N S V E R S A L E P L U S OU M O IN S A R R O N D I E .
RHINOLOPHE FAMEUX — RHINOLOPHUS NOBILIS.
[Planche X X V I I I . )
L e plus grand des Rinolophes connus; taille plus forte que celle
du phyllostome fer-de-lance (phyllostoma hastatum). Tête
grande, oreilles en conque, à-peu-près aussi larges que hautes,
sans lobe distinct, velues extérieurement à leur base. Feuille nasale
simple à bord terminal en coupe de couronne; derrière et à la base
de cette feuille existent quatre petits orifices ou siphons , presqu’im-
perceptibles à l’oeil nu ; fer-à-cheval entonné d’une large membrane
pointue par devant et de plis latéraux; queue moitié de la longueur
de l’antibrachium. Dents incisives, dans l’adulte deux supérieures
rapprochées convergentes et quatre inférieures, celles-ci
bilobées, plus ou moins entassées selon le degré de développement
du talon des canines.
Molaires supérieures cinq, dont celle accolée au talon de la
canine très-petite, sans fonction présumable, ( j) Molaires inférieures
cinq toutes à collines pointues.
Pelage très-doux et fin, long, bien fourni, très-bigarré.
Épaules et milieu du dos d’un beau marron; dessous des épaules
et parties latérales du dos d’un blanc pur; sommet de la tête
et nuque d’un gris blanc, à bout des poils brun; sur la région de
la tête de l’humerus une bandelette marron entourée de blanc ; côtés
de là poitrine, région humérale et flancs, d’un blanc pur; joues
et côtés du cou d’un gris-brun, à bout des poils blanchâtre; milieu
de la poitrine et du ventre gris-brun couleur de souris.
Membranes d’un brun foncé; les oreilles poilues à-peu-près jusque
vers le milieu, le reste nu couvert de rides.
Nous ne connaissons que l’adulte; le jeune et le moyen âge nous
manquent encore pour compléter l’histoire de cette belle espèce.
Longueur totale 5 pouces 2 lignes, dont la queue prend 1
pouce 6 lignes; envergure de l’adulte 19 pouces; anlibrachium
3 pouces; tibia 1 pouce 4 lignes.
Synonymes. L ’espèce a été décrite très-exactement par Mr.
Horsfield, Zoolog. Research, in Java. La planche, jointe à cette
description citée, laisse beaucoup à désirer.
Patrie. Mr. Horsfield a rapporté de Java les deux premiers
sujets qu’on ait vus en Europe; depuis, nous en avons reçu plusieurs
autres de Java et des Moluques par Mr. Reinwardt, Kuhl et van
Hassèlt; ceux que nous devons aux soins de Mr. Mr. Macklot et
Millier ont été capturés à Timor. L ’espèce paraîtêtre très-répandue;
elle habite à Java les districts Kampong-telahab près de La-
(1) Il paraît que cette petite molaire peut tomber par le développement du talon de la
canine, sur lequel elle repose.