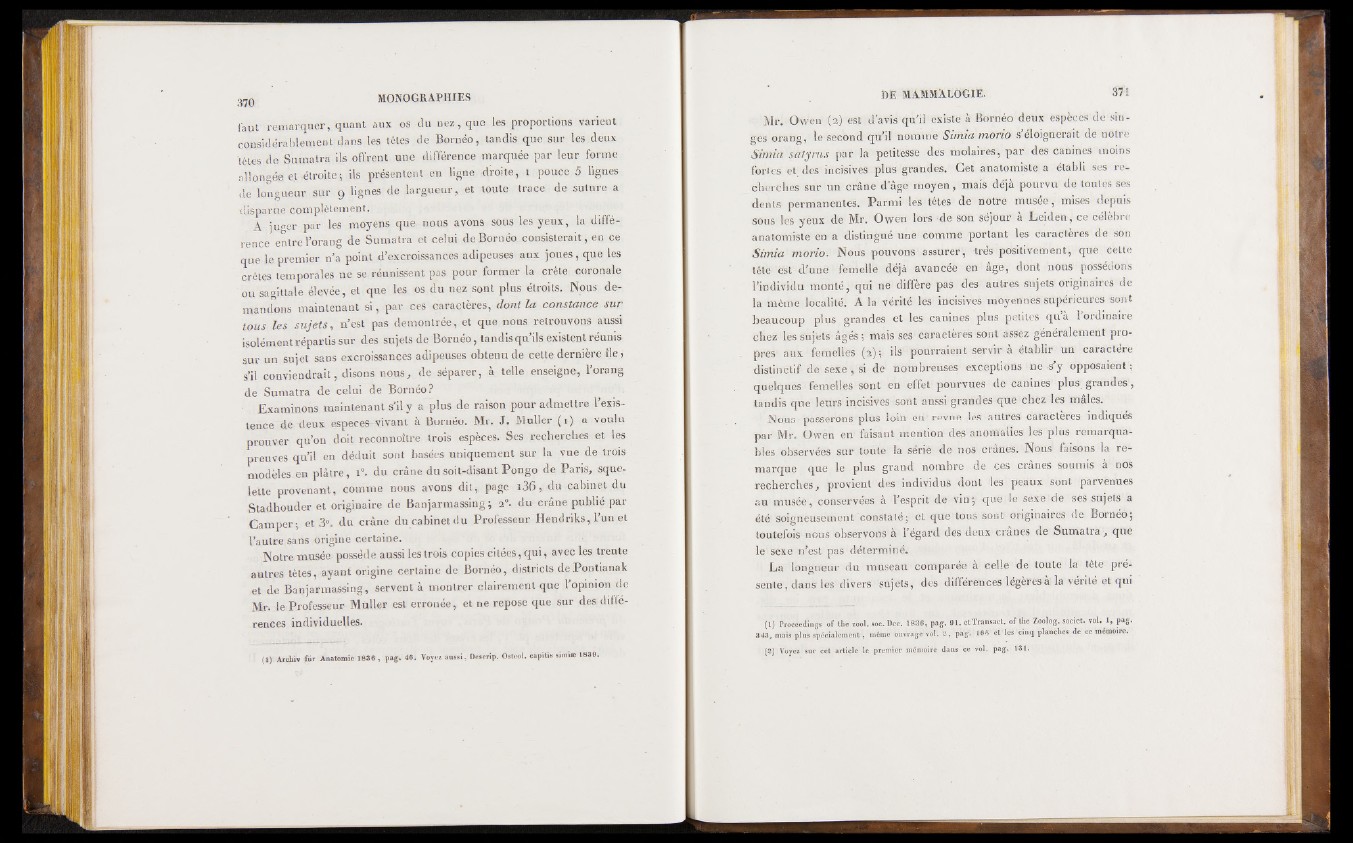
faut remarquer, quant aux os du nez, que les proportions varient
considérablement dans les têtes de Bornéo, tandis que sur les deux
têtes de Sumatra ils offrent une différence marquée par leur forme
allongée et étroite5 ils présentent en ligne droite, t pouce 5 lignes
de longueur sur 9 lignes de largueur, et toute trace de suture a
disparue complètement.
A juger par les moyens que nous avons sous les yeux, la différence
entre l’orang de Sumatra et celui de Bornéo consisterait, en ce
que le premier n'a point d’excroissances adipeuses aux joues, que les
crêtes temporales ne se réunissent pas pour former la crête coronale
ou sagittale élevée, et que les os du nez sont plus étroits. Nous demandons
maintenant s i, par ces caractères, dont la constance sur
tous les su je ts, n’est pas démontrée, et que nous retrouvons aussi
isolément répartis sur des sujets de Bornéo, tandis qu’ils existent réunis
sur un sujet sans excroissances adipeuses obtenu de cette dernière île 5
s’il conviendrait, disons nous, de séparer, à telle enseigne, l’orang
de Sumatra de celui de Bornéo?
Examinons maintenant s’il y a plus de raison pour admettre l’existence
de deux especes vivant à Bornéo. Mr. J. Muller (1) a voulu
prouver qu’on doit reconnoître trois espèces. Ses recherches et les
preuves qu’il en déduit sont basées uniquement sur la vue de trois
modèles en plâtre, i°. du crâne dusoit-disant Pongo de Paris, squelette
provenant, comme nous avons dit,, page i 3f5, du cabinet du
Stadhouder et originaire de Banjarmassing ; 20. du crâne publié par
Camper; et 3“. du crâne du cabinet du Professeur Hendriks, l’un et
l’autre sans origine certaine.
Notre musée possède aussi les trois copies ci tées, qui, avec les trente
autres têtes, ayant origine certaine de Bornéo, districts de Pontianak
et de Banjarmassing, servent à montrer clairement que l'opinion de
Mr. le Professeur Muller est erronée, et ne repose que sur des différences
individuelles.
(1) Archiv fur Anatomie 1838 , pag. 46. Voyez anssi, Descrip. Osleol. capitis simiæ 1839.
Mr. Owen (2) est d’avis qu’il existe à Bornéo deux espèces de singes
orang, le second qu’il nomme Simia mono s’éloignerait de notre
Sirnia satyrus par la petitesse des molaires, par des canines moins
fortes et des incisives plus grandes. Cet anatomiste a établi ses recherches
sur un crâne d’âge moyen, mais déjà pourvu de toutes ses
dents permanentes. Parmi les letes de notre musee , mises depuis
sous les yeux de Mr. Owen lors de son séjour à Leiden, ce célèbre
anatomiste en a distingué une comme portant les caractères de son
Simia morio. Nous pouvons assurer, très positivement, que cette
tête est d’une femelle déjà avancée en âge, dont nous possédons
l’individu monté, qui ne différé pas des autres sujets originaires de
la même localité. A la vérité les incisives moyennes supérieures sont
beaucoup plus grandes et les canines plus petites qu’à l’ordinaire
chez les sujets âgés ; mais ses caractères sont assez généralement propres
aux femelles (2) ; ils pourraient servir à établir un caractère
distinctif de sexe , si de nombreuses exceptions ne s’y opposaient ;
quelques femelles sont en effet pourvues de canines plus grandes,
tandis que leurs incisives sont aussi grandes que chez les mâles.
Nous passerons plus loin en revue les autres caractères indiques
par Mr. Owen en faisant mention des anomalies les plus remarquables
observées sur toute la sérié de nos crânes. Nous faisons la remarque
que le plus grand nombre de ces crânes soumis a nos
recherches, provient des individus dont les peaux sont parvenues
au musée, conservées à l'esprit de vin; que le sexe de ses sujets a
été soigneusement constaté; et que tous sont originaires de Bornéo;
toutefois nous observons à l’égard des deux crânes de Sumatra , que
le sexe n’est pas déterminé.
La longueur du museau comparée à celle de toute la tête présente,
dans les divers sujets, des dilférences legeresa la vérité et qui
(1) Proceedings of the zool. soc. Dec. 1836, pag. 91. etTransact. of the Zoolog. societ.343, mais plus spécialement, même ouvrage vol. 8, pag. 165 et les cinq planches de c ev oml. ém1, opiraeg.. (S) Voyez sur cet article le premier mémoire dans ce vol. pag. 131.