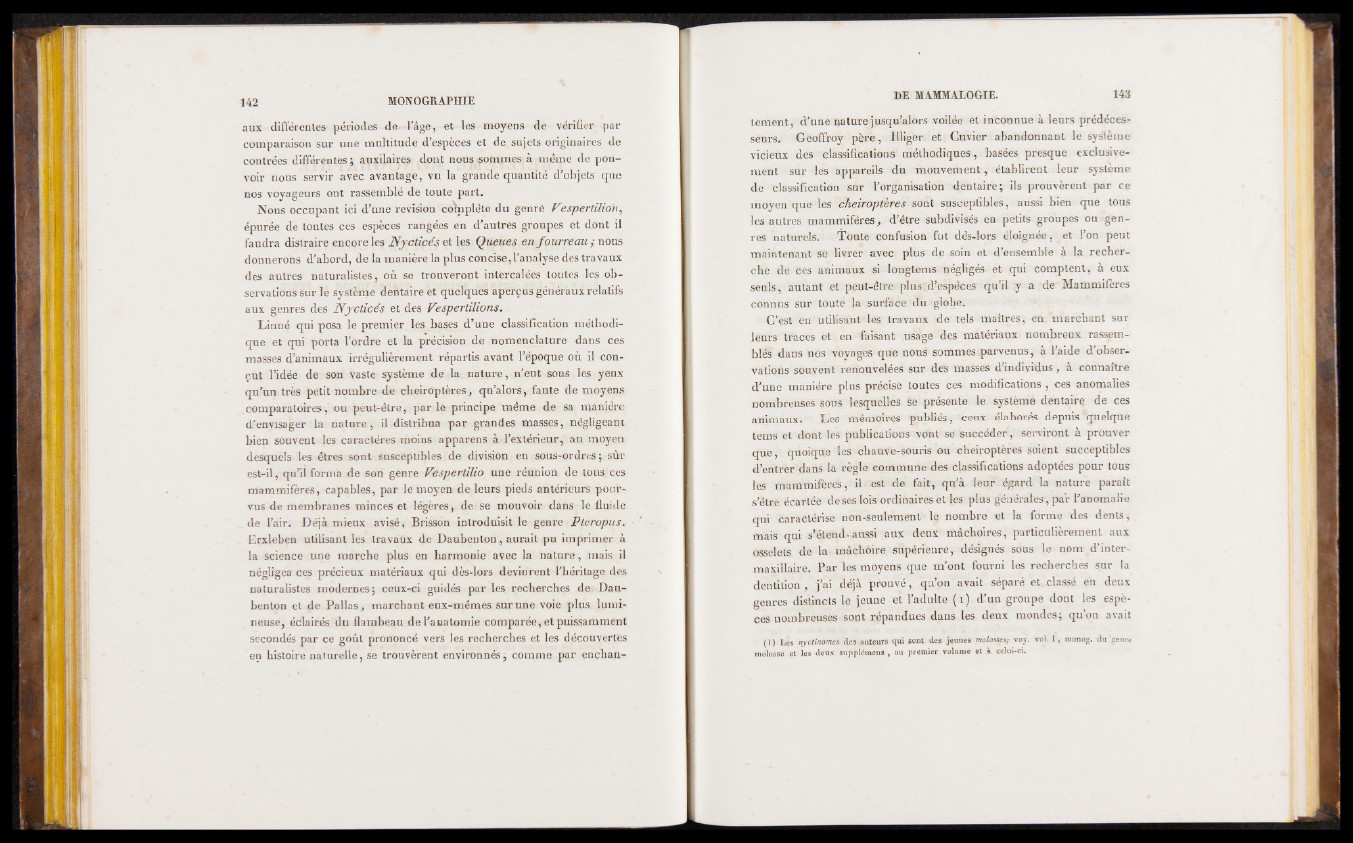
aux différentes périodes de l’â g e , et les moyens de vérifier par-
comparaison sur une multitude d’espèces et de sujets originaires de
contrées différentes; auxilaires dont nous sommes à même de pouvoir
nous servir avec avantage, vu la grande quantité d’objets que
nos voyageurs ont rassemblé de toute part.
N ou s occupant ici d’une révision complète du genrè Vespertilion,
épurée de toutes ces espèces rangées en d’autres groupes et dont il
faudra distraire encore les N jc tic é s et les Queues en fourreau ,■ nous
donnerons d’abord, de la manière la p lus c on c ise ,l’analyse des travaux
des autres naturalistes, où se trouveront intercalées toutes les ob servations
sur le système dentaire et quelques aperçus généraux relatifs
aux genres des N jc tic é s et des Vespertilions.
L in n é qui posa le premier les bases d ’une classification méthodique
et qui porta l’ordre et la précision de nomenclature dans ces
masses d’animaux irrégulièrement répartis avant l’époque où il conçut
l’idée de son vaste système de la. n a tu r e, n’eut sous les yeux
qu’un très petit nombre de chéiroptères, qu’alors, faute de moyens
comparatoires, ou p eu t-ê tr e , par le principe m êm e de sa manière
d’envisager la n a tu r e , il distribua par grandes masse s, négligeant
bien souvent les caractères moins apparens à l’extérieur, au moyen
desquels les êtres sont susceptibles de division en sous-ordres; sûr
e st-il, qu’il forma de son genre Vespertilio une réunion de tous ces
mam mifères, capables, par le moyen de leurs pieds antérieurs pourvus
de membranes min ces et légères, de: se mouvoir dans le fluide
de l’air. Dé jà mieux a v isé, Brisson introduisit le genre Pteropus.
Erxleben utilisant les travaux de D au b en ton , aurait pu imprimer à
la science une marche plus en harmonie aVec la n a tu r e , mais il
négligea ces précieux matériaux qui dès-lors devinrent l’héritage des
naturalistes modernes; ceux-ci guidés par les recherches de D au -
benton et de P a lla s , marchant eu x -m êm es sur une voie plus lum ineuse,
éclairés du flambeau de l’anatomie comparée, et puissamment
secondés par ce goût prononcé vers les recherches et les découvertes
en histoire naturelle, se trouvèrent environnés; comme par en ch an -
ten ten t, d’une nature jusqu’alors voilée et inconnue à leurs prédécesseurs.
Geoffroy p è r e , Illiger e t Cuvier abandonnant le système
vicieux des classifications m é th od iq u es, basées presque exclusivement
sur les appareils d u m o u v em e n t, établirent leur système
de classification sur l’organisation dentaire; ils prouvèrent par ce
moyen que les chéiroptères sont susceptibles, aussi bien que tous
les autres m am m ifè r es, d’être subdivisés en petits groupes ou g e n res
naturels. Toute confusion fut dès-lors é lo ig n é e , et l’on peut
maintenant se livrer avec plus de soin et d’ensemble à la recherch
e de ces animaux si longtems négligés- et qui c om p ten t, à eux
seu ls, autant et peut-être plus d’espèces q u ’il y a de Mammifères
connus sur toute la surface du globe.
C’est en utilisant les travaux de tels maîtres, en marchant sur
leurs traces et en faisant usage des matériaux nombreux rassemblés
dans nos voyages que nous sommes parvenus, à l’aide d’observations
souvent renouvelées sur des masses d’in d iv id u s, a connaître
d’une manière plus précise toutes ces modifications , ces anomalies
nombreuses sous lesquelles se présente le système dentaire de ces
animaux. L e s mémoires pu bliés, ceu x élaborés depuis quelque
tems et dont les publications vont se su c céd e r , serviront à prouver
q u e , quoique les chauve-souris ou chéiroptères soient succeptibles
d ’entrer dans la règle commu ne des classifications adoptées pour tous
les mammifères, il est de fait, qu’à leur égard la nature paraît
s’être écartée de ses lois ordinaires et les plus générales, par l’anomalie
qui caractérise non-seulement le nombre e t la forme des d en ts,
mais qui s’étend-aussi aux deux m â choires, particulièrement aux
osselets de la mâchoire supérieure, désignés sous le nom d ’intermaxillaire.
Par les moyens que m'ont fourni les recherches sur la
dentition , j’ai déjà prou v é , qu’on avait séparé et classé en deux
genres distincts le jeune et l’adulte (1 ) d’un groupe dont les espèces
nombreuses sont répandues dans les deux mondes; qu’on avait
( I) Les nyctinomes des auteurs qui sont des jeunes molosses,' voy. vol. 1 , monog. du genre
molosse et les deux supplémens , au premier volume et à celui-ci.