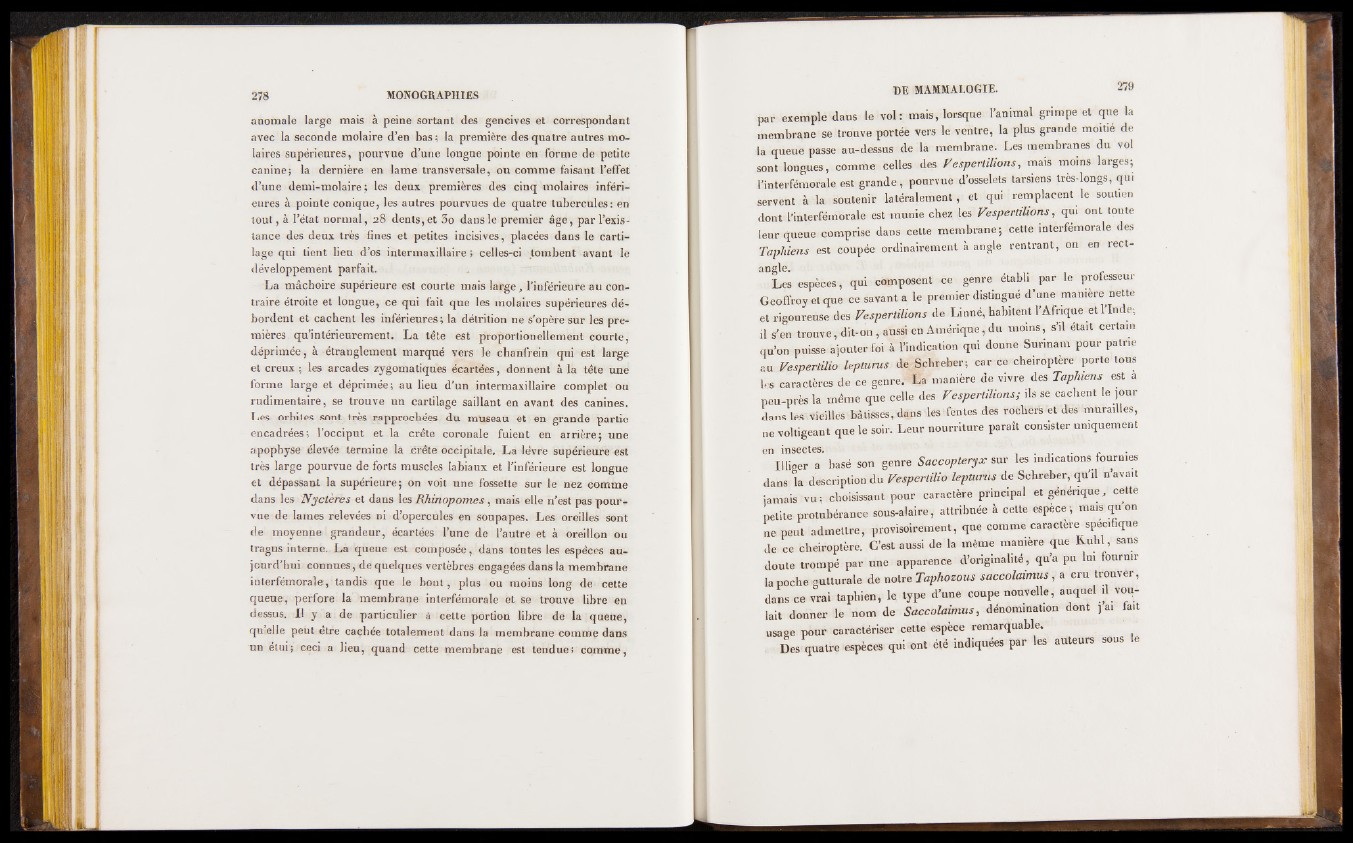
anomale large mais à peine sortant des gencives et correspondant
avec la seconde molaire d’en bas ; la première des quatre antres molaires
supérieures, pourvue d’une longue pointe en forme de petite
canine; la dernière en lame transversale, ou comme faisant l’effet
d’une demi-molaire ; les deux premières des cinq molaires inférieures
à pointe conique, les autres pourvues de quatre tubercules: en
tout, à l’état normal, 28 dents, et 3o dans le premier âge, par l’existance
des deux très fines et petites incisives, placées dans le cartilage
qui tient lieu d’os intermaxillaire ; celles-ci tombent avant le
développement parfait.
La mâchoire supérieure est courte mais large, l’inférieure au contraire
étroite et longue, ce qui fait que les molaires supérieures débordent
et cachent les inférieures; la délrition ne s'opère sur les premières
qu’intérieurement. L a tête est proportionellement courte,
déprimée, à étranglement marqué vers le chanfrein qui est large
et creux; les arcades zygomatiques écartées, donnent à la tête une
forme large et déprimée; au lieu d’un intermaxillaire complet ou
rudimentaire, se trouve un cartilage saillant en avant des canines.
Les orbites sont très rapprochées du museau et en grande partie
encadrées; l’occiput et la crête coronale fuient en arrière; une
apophyse élevée termine la crête occipitale. La lèvre supérieure est
très large pourvue de forts muscles labiaux et l’inférieure est longue
et dépassant la supérieure; on voit une fossette sur le nez comme
dans les Nyctères et dans les Rhinopomes, mais elle n’est pas pourvue
de lames relevées ni d’opercules en soupapes. Les oreilles sont
de moyenne grandeur, écartées l’une de l’autre et à oreillon ou
tragus interne. La queue est composée, dans toutes les espèces aujourd’hui
connues, de quelques vertèbres engagées dans la membrane
interfémorale, tandis que le bout, plus ou moins long de cette
queue, perfore la membrane interfémorale et se trouve libre en
dessus. Il y a de particulier à celte portion libre de la queue,
qu elle peut etre cachée totalement dans la membrane comme dans
un étui; ceci a lieu, quand cette membrane est tendue; comme,
par exemple dans le vol: mais, lorsque l’animal grimpe et que la
membrane se trouve portée vers le ventre, la plus grande moitié de
la queue passe au-dessus de la membrane; Les membranes du vol
sont longues, comme celles des Fespertilions, mais moins larges;
l’interfémorale est grande, pourvue d’osselets tarsiens très-longs, qu.
servent à la soutenir latéralement, et qui remplacent le soutien
dont l’interfémorale est munie chez les Fespertilions, qui ont toute
leur queue comprise dans celte membrane; cette interfémorale des
Taphiens est coupée ordinairement à angle rentrant, on en rect-
angle.
Les espèces, qui composent ce genre établi par le professeur
Geoffroy et que ce savant a le premier distingué d’ une manière nette
et rigoureuse des Fespertilions de L in n é , habitent l’Afrique et l’Inde;
il s’en trouve, dit-on , aussi en Amérique, du moins, s’il était certain
qu’on puisse ajouter foi à l’indication qui donne Surinam pour patrie
au Fespertilio lepturus de Schreber; car ce cheiroptère porte tous
1rs caractères de ce genre. La manière de vivre des Taphiens est a
peu-près la même que celle des Fespertilions; ils se cachent le jour
dans les vieilles bâtisses, dans les fentes des rochers et des murailles,
ne voltigeant que le soir. Leur nourriture paraît consister uniquement
en insectes.
Illiger a basé son genre Saccopteryx sur les indications fournies
dans la description du Fespertilio lepturus de Schreber, qu’il n’ava.t
jamais vu; choisissant pour caractère principal et générique, cette
petite protubérance sous-alaire, attribuée à cette espèce; mais qu’on
ne peut admettre, provisoirement, que comme caractère spécifique
de ce cheiroptère. C ’est aussi de la même manière que K u h l, sans
doute trompé par une apparence d’originalité , qu’a pu lui fournir
la poche gutturale de notre Taphozous saccolaimus , a cru trouver,
dans ce vrai taphien, le type d’une coupe nouvelle, auquel .1 voulait
donner le nom de Saccolaimus, dénomination dont ] ai lait
usage pour caractériser cette espèce remarquable.
Des quatre espèces qui ont été indiquées par les auteurs sous le