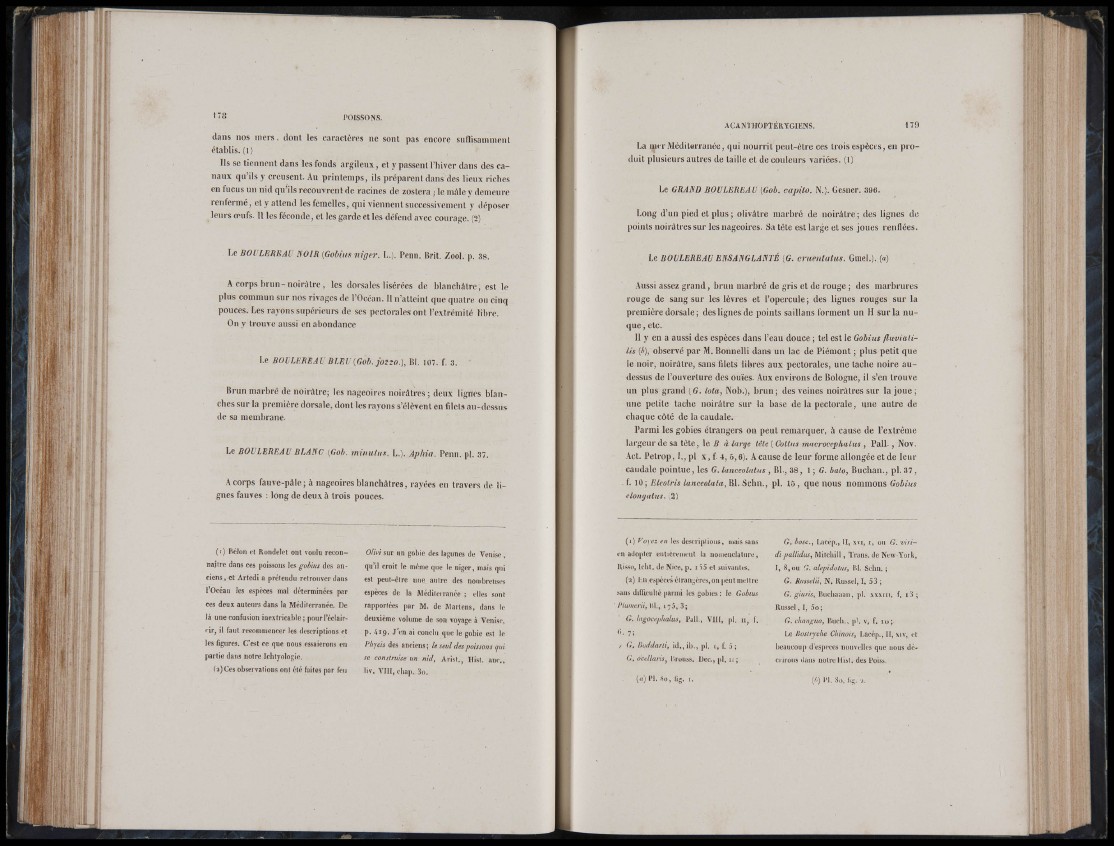
clans nos mers, dont les earaclères ne sont pas encore snilisamnienL
établis. {!)
Ils se tiennent dans les fonds argilenx , et y passent lliiver dans des canaux
qu'ils y creusent. Au printemps, ils préparent dans des lieux riches
en fucus un nid qu'ils recouvrent de racines de zostera ; le nv\le y demeure
renfermé, et y attend les femelles, qui viennent successivement y déposer
leurs oeufs. Il les féconde, et les garde et les défend avec courafîe. (2)
L e BOVLERRAU ISOIR {Gobins niger. L.l. Penii. Hrit. Zool . p. 38.
corps b run-noinUre, les dorsales lisérécs de blanchâtre, e.sl le
plus commun sur nos rivages de l'Océan. Il n'atteint que quatre ou cinq
pouces. Les rayons supérieurs de ses peclorales ont l'extrémité libre.
On y trouve aussi en abondance
L e BOULEREAL' BLnr {Goh. joizo.), RI. 107. f. 3.
Brun marbré de noirAtre; le.s nageoires noirâtres; deux lignes blaitches
sur la première dorsale, dont les rayons s'éltWent en fdets an-dessus
de sa membrane.
L e BOVLEREAV BhAJSC [Gob. minufus. L.). Aphia. Pcnn. pl. 37.
A corps fauve-pâle; à nageoires blanch<'itres, rayées en travers de lignes
tauves ; long de deux à trois pouces.
(i) Bélon et Roiidelf-l ont voulu reconnaître
dans ces poissons le.« g^ohius dc.s anriens,
et Artedi a prétendu retrouver dans
l'Océan les espèces mal détt-rminées par
ces deux autenrs dans la Méditerranée. De
là une confusion inexlricahle ; ponrréciairrir,
il faut repomiiienrer les di-scriplions et
les fignres. C'est ce que nous es.saierons rn
partie daii.< notre Ichtyologie.
Ca) Ces observations ont été faitos par feu
Oitvi sur un gohie de.s la},'unes de Venist«,
qu'il croit le même que le niger, mais qui
est peut-être une autre des nonibrctis.s
espèces de la Médik-iranée : elles .-ionl
rapportées par M. de Martens, dans le
deuxième volume de son voyage à Venise,
p. 419. J'en ai conclu que le gobie est le
Phycis des anciens le si'iil des poissons (jui
se construise un nid, ArisI,, lîist. aur..
liv. Vm. eliap. 3().
lll-'t'!
l l l ' l l
AC AN! HOPIKRYGIENS. \ 7 9
La uieri\lédit«rranée, qui nourrit peut-être ces trois espècts, e» produit
plusieurs autres de taille et de couleurs variées, (i)
Le GRAISD BOVLEREAV {Gob. capito. N.). Gest ier . 396.
Long d'un pied et plus ; olivâtre marbré de noirâtre; des lignes dii
points noirâtres sur les nageoires. Sa tète est large et ses joues renflées.
L e BOVLEREAV E!SSA?IGLA^TÉ [G. cruentaius. Gt n e l . ) . (a)
Aussi assez grand , brun marbré de gris et de rouge ; des marbrures
rouge de sang sur les lèvres et l'opercule; des lignes rouges sur la
première dorsale; des lignes de points saillans forment un H sur l a nuque
, etc.
11 y en a aussi des espèces dans l'eau douce ; tel est le Gobius fluviaii-
Us {h)y observé par M. Bonnelli dans un lac de Piémont ; plus petit que
le noir, noirâtre, sans filets libres aux pectorales, une tache noire audessus
de l'ouverture des ouïes. Aux environs de Bologne, il s'en trouve
un plus grand [G. Iota, iVob.), brun; des veines noirâtres sur la joue ;
u!ic petite tache noirâtre sur la base de la pectorale, une autre de
chaque côté de la caudale.
Parmi les gobies étrangers on peut remarquer, à cause de l'extrènie
l a r g e u r de sa t é t e , l e 5 à large têtc{Cottus mncrocephalns , Pali. , Nov.
Act. Petrop, J., pi x, f. 4, 5,6). A cause de leur forme allongée et de leur
caudale pointue, les G. lanccolatns , Bl-, 38, 1 ; G. bato, Buchan., pl. 37 ,
f. 10 ; Elcolris lanceolata, Bl. S c h n . , pl. 15, que nous nommons Gobius
cloiiyiitus.
(1) f^'aycz en les desi riiklioiis, «tais sans
eu ailopicr enlicreuu'ut hi noiiieuelature,
Risso, Iclit. de Nice, p. i i5 et suivantes.
(2} t.n esjwci-sclran^0ri's,ouiieutnicllre
.••aus difUculié parmi les gobies : le Gobius
' Plunn-rii, Isl,, 175, 3;
G. bigoccjihalus, Fell., Vili, pl. u^ f.
(i. 7;
/ a. UodJarli, id,,ib., pl. i, l'. 5;
C. ocf/iarrs, l^rouss. Dec., pl. i; ;
(<0 Pl. fio, lig. i.
G. base., Lacep., II, svi, i, ou G. viridi
pallidus, Mitcliill, Trans.de [sVw Yui k,
I, 8, ou 'î. aUpidoUts, iU. Schn. ;
G. Russala, N. Kusscl, I, 53 ;
iî. ^/'«w, lîuchaiian, pl. xxxiii, f. i3;
Russel, I, 5o;
G. chanfiua, Ruch., p'. v, f. H);
Le liosiryche Chinois, Lacép., II, mv, et
beaucoup d'csjH'ce-s nouvelles que uous déci
irous ilaus notre Hist, des t'oi»9.
{!•) l'I. S.), li^'. -i.
'llilll
û ^ • M
i n i ;
ì ' ì i i
M I
•iii,
•lUi'^'
l i ;
p i
lis