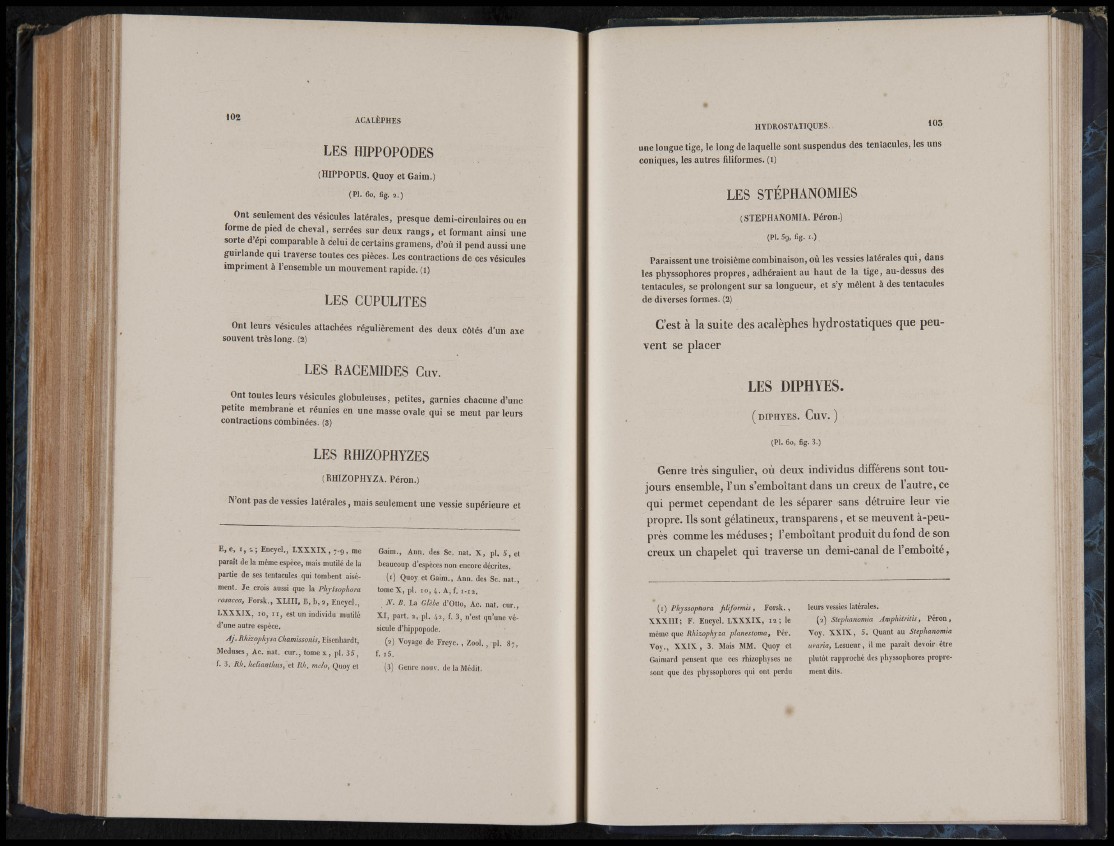
I M
LES HIPPOPODES
(HIPPOPUS. Quoy et Gaim.)
( P l . 60, £g, 2.)
Ont seulement des vésicules latérales, presque deral-circiilaires ou en
forme de pied de cheval, serrées sur deux rangs, et formant ainsi une
sorte d'épi comparable à celui de certains gramens, d'où il pend aussi une
guirlande qui traverse tontes ces pièces. Les contractions de ces vésicules
impriment à l'ensemble un mouvement rapide. (1)
LES CÜPULITES
Ont leurs vésicules attachées régulièrement des deux côlés d'un axe
souvent très long. (2)
LES RACEMIDES Cuv.
Ont toutes leurs vésicules globuleuses, petites, garnies chacune d'une
petite membrane et réunies en une masse ovale qui se meut par leurs
contraclions combinées. (3)
LES RHJZOPHYZES
(RHIZOPHYZA. Péron.)
N'ont pas de vessies latérales, mais seulement une vessie supérieure et
E , e, ï, i ; Encycl., LXXXIX, 7-9, me
paraît de la même espèce, mais mutilé de la
partie de ses tentacules qui tombent aisément.
Je crois aussi que la Phpsaphora
rosacea, Forsk., XLIII, B, b, a, Encycl.,
LXXXIX, 10, I I , est un individu mutile
d'une autre esj)èce.
Aj. Rhizophjsa Chamissonis, Eisenliardt,
Mediises, Ac, nat. cur., tome x , pl. 35,
f. 3. Rh. IielianlltiisKi Rh. malo, Quoy el
Gaim., Ann. des Se. nal, X, pl. 5 , et
beaucoup d'espèces non encore décrites.
(1) Quoy et Gaim., An», des Se. nat,,
tomeX, pl. 10, 4. A, f . 1.12.
N. B. La Glèbe d'OtIo, Ac. nat. cur.,
XI, part. 2, pl. ./j2, f. 3, n'est qo'unc vésicule
d'hippopode.
(2) Voyage de Freyc. , Zool. , pl. 87,
f. i5.
( î ) Genre iiouv. du Ja Médit.
HYDROSTATIQUES. »
une longue tige, le long de laquelle sont suspendus des tentacules, les uns
coniques, les autres filiformes. (I)
LES STÉPHANOMIES
(STEPHANOMIA. Pérou.)
(Pl. 59, fig. I.)
Paraissent une troisième combinaison, oii les vessies latérales qui , dans
les physsophores propres, adhéraient au haut de la lige, au-dessus des
tentacules, se prolongent sur sa longueur, et s'y mêlent à des tentacules
de diverses formes. (2)
C'est à la suite des acalèphes lïydrostatlques que peuvent
se placer
LES DIPHYES.
( DIPHYES. C u v . )
(PI. 60, 6g. 3.)
Genre très singulier, où deux individus différens sont toujours
ensemble, l'un s'emboîtant dans un creux de l'autre, ce
qui permet cependant de les séparer sans détruire leur vie
propre. Ils sont gélatineux, transparens, et se meuvent à-peuprès
comme les méduses ; l'emboîtant produit du fond de son
creux un chapelet qui traverse un demi-canal de l'emboîté,
( i ) Piiyisopttora jiliformls, Forsk.,
xxxnl; F. Eiicyd. LXXXIX, la; le
même que Rhliophyza planestomat Pér.
Voy., XXIX, 3, Mais MM. Quoy et
Gtiini-inl iiensent que ces rhizophyses ne
sont que des physsophores qui ont perdu
leur« vessies latérales.
(a) Stephanoniia Amphitritts, Péron,
Voy. XXIX, 5. Quant au Stephanomia
iwarïtt, Lesuenr, il me parait devoir être
plutôt rapproché des physsophores proprement
dits.