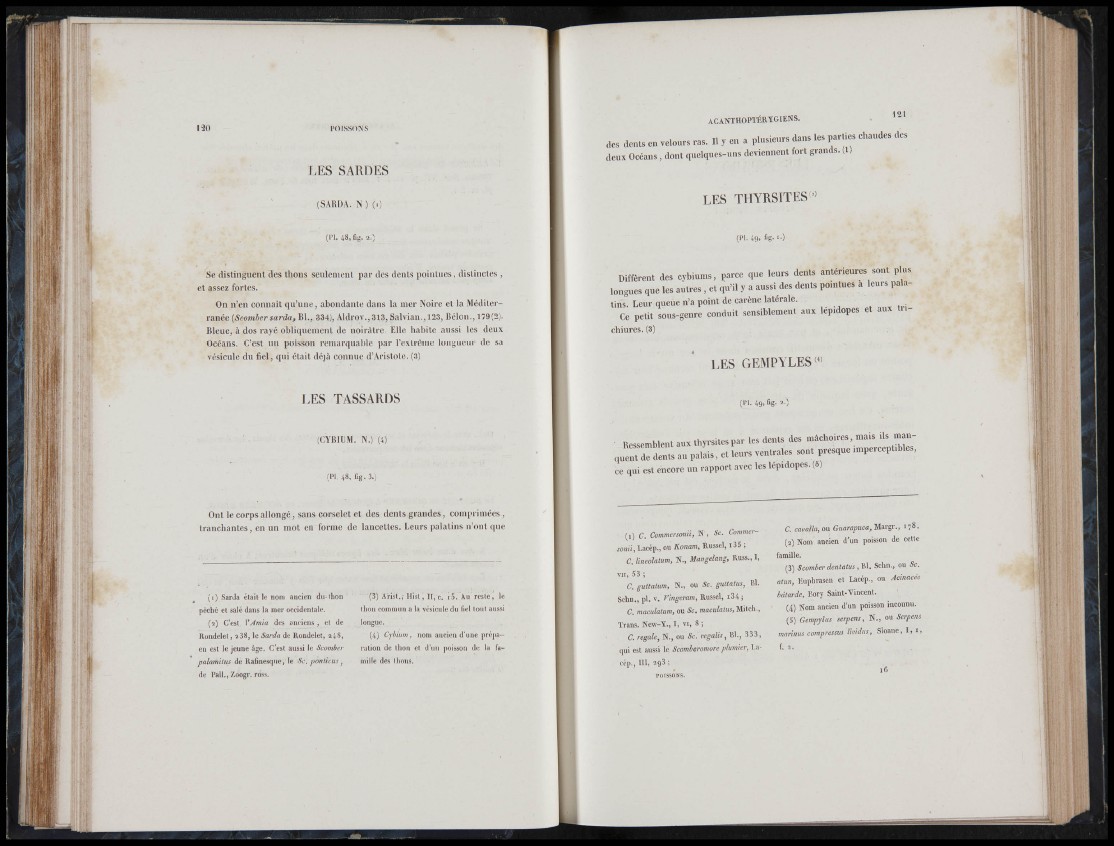
r . E S SARDES
(SAUDA. N ) CO
(PI. 48,%. '2.)
Se dist inguent des thons seulenieul par des dents pointues, distinctes ,
et assez fortes.
On n'en connaît qu'une, abondante dans la mer Noire et la Méditerr
a n é e {Scomhcr sarda, Bl., 334J, Aldrov. ,313, Salvian., 123, Bélon., 179(2).
Bleue, ù dos rayé obliquement de noirâtre Elle liabite aussi les deux
Océans. C'est un poisson remarquable par l'extrême longuoin- de sa
vésicule du fiel, qui était déjh connue d'Aristole. (3)
J . E S TASSARDS
(CVBILM. N.) (4)
(PI 48, iig. 3.)
Ont le corps a l longé, sans corselet et des dénis grandes, comprimées,
t r a n c h a n t e s , en un mot eu forme de lancettes. Leurs palatins n'ont (|ue
(i) .SarJa était le nom ancien dii-lbon
péché et salé dans ta mer occidentale.
(î) C'est i'Jmia des aiuiens , et de
Rondelet, a38, le Sarcla du Rondelet, 248,
en est le jeune âge. C'est aussi le Scombcr
palamilus de Rafinesqiie, le Se. ¡wnticus,
de l'ail., Zoogr. ross.
(3) Arist., Hist, II, c. i5. Au reste, Ir
(hon coinmiin a la vésicule du iiel loiit aussi
longue.
(4) Cybium , nom nneien d'une jiréiiii—
ration de ihoii ei d'un poisson <li: ta l'ainille
des liions.
ACANÏHOPI'ÉRYGIENS. ^ '
des a cus on velours ras. Il y on a plusieurs clans les parl ies chaudes des
deux Océans , doni quelques-uns deviennent fort grands. (1,
L E S THYRSITES
(1>1. 49, (Ig. I.)
Diffèrent des cybiums, parce que leurs dents antérieures sont plus
longues que les aut res , et qu'il y a aussi des dents pointues a leurs palatins"
Leur queue n'a point de carène latérale.
Ce petit sous-genre conduit sensiblement aux lépidopes et aux tr.-
chiures. (3)
L E S GEMPYLES'«
L
(Pl. <9, %. a.)
Ressemblent aux thyrsi lespar les dents des mâchoires, mais ils mauq
u e r d T d e n t s au p a l L , et leurs ventrales sont presque .mpercept.bles,
ce qui est encore un rapport avec les lépidopes. (6)
(,) C. Commasonü, N , Sc. Commerjo/
iii.Lacép., ou Äo""»>, »ussel, i35 i
C. Unedalum. N., Mangelang. Rliss., I,
VII, 53 ;
C. guUatum, N., ou Se. guUatm, Bl.
Schil., pi. V, Flngeram, Russel, i34;
C. maculaUm, ou Se. maculatm, Milcli.,
Trans. New-Y., I, vi, 8 -,
C. regale, N., ou Se/regalU, 111., 333,
qui est aussi le Scomberomorc phimier, l.ilri'p,,
Ul, 293;
roissilNB.
C. eavalla,on Gaarapuea^Mar^r., 17«.
(2) Nom ancien d'un poisson de ceUc
famille.
(3) Seamier denlaliit, HI. Sdm., ou Se.
atm, Knplirasen ci Lacép., ou Aeinacie
bâtarde, lìory Saint-Tillcent.
(4) Nom ancien d'un poisson inconnu.
(51 Gempjlus serpens, N., ou Serpens
marìnm compressns lU-idns, Sioanc, I, i,
t.