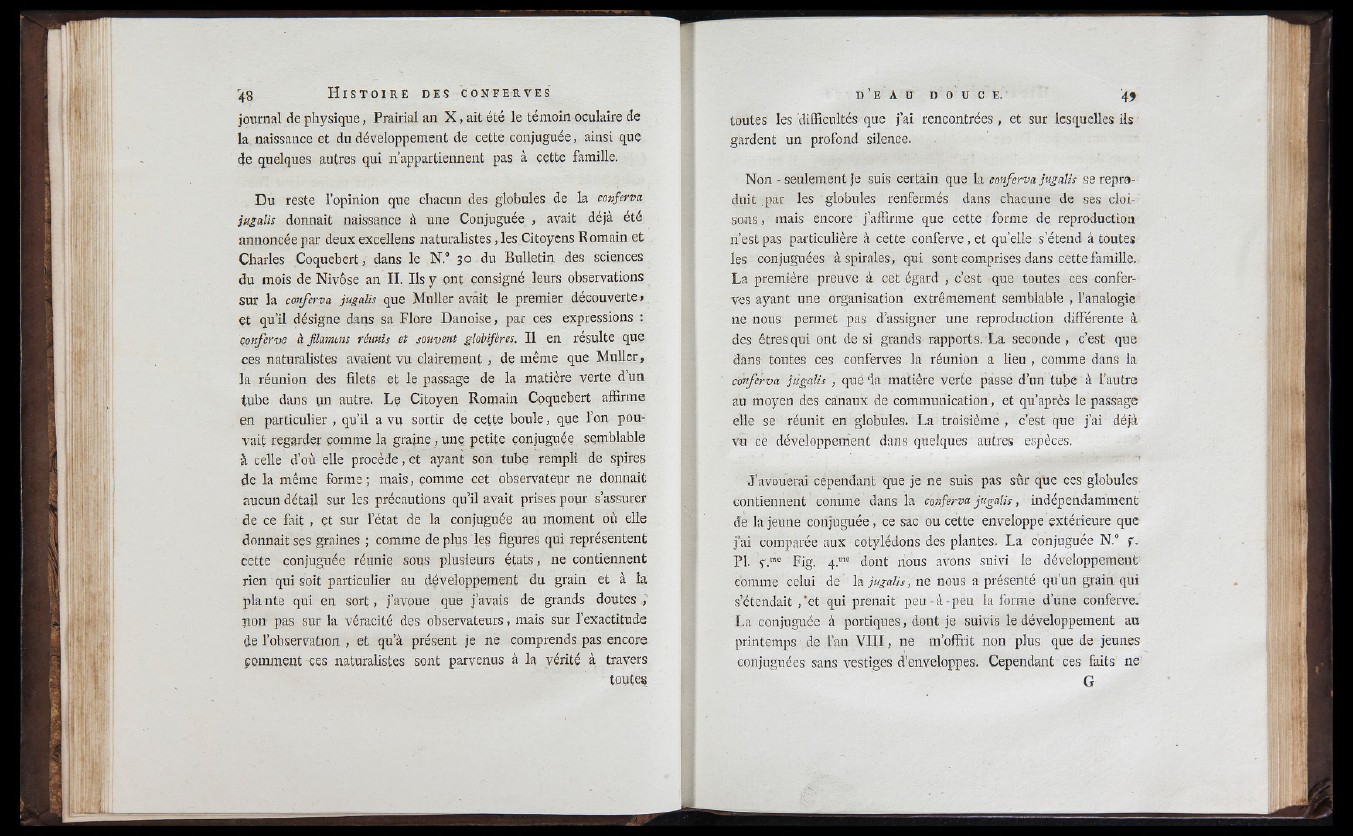
î î
' ¥
; >
V.
ri
journal de physique, Prairial an X , ait été le témoin oculaire de
la naissance et du développement de cette conjuguée, ainsi que
de quelques autres qui n’appartiennent pas à cette famille.
Du reste fopinion que chacun des globules de la conferva
jugalis donnait naissance à une Conjuguée , avait déjà été
annoncée par deux excellens naturabstes, les Citoyens Romain et
Charles Coquebert, dans le N.° 30 du Bulletin des sciences
du mois de Nivôse an II. Ils y ont consigné leurs observations
sur la conferva jugalis que Muller avait le premier découverte 1
et qu’il désigne dans sa Flore Danoise, par ces expressions :
conferve à filamtns réunis et souvent globifères. I l en résulte que
ces naturabstes avaient vu clairement , de même que Muller,
la réunion des filets et le passage de la matière verte d’un
tube dans un autre. L e Citoyen Romain Coquebert affirme
en particulier , qu’il a vu sortir de cette boule , que l’on pouvait
regarder çomme la graine, une petite conjuguée semblable
à celle d’où elle procède, et ayant son tube rempli de spires
de la même forme ; mais, çomme cet observateur ne donnait
aucun détail sur les précautions qu’il avait prises pour s’assurer
de ce fait , et sur fé ta t de la conjuguée au moment où elle
donnait ses graines ; comme de plus les figures qui représentent
cette conjuguée réunie sous plusieurs é ta ts , ne contiennent
rien qui soit particulier au développement du grain et à la
pla nte qui en s o r t , j’avoue que j’avais de grands doutes ,
non pas sur la véracité des observateurs, mais sur l’exactitude
de fobservatiou , et qu’à présent je ne comprends pas encore
comment ces naturalistes sont parvenus à la vérité à travers
toutes
d ’e a u d o u c e . '45
toutes les difficultés que j’ai rencontrées, et sur lesquelles ils
gardent un profond silence.
Non - seulement je suis certain que la conferva jugalis se reproduit
par les globules renfermés dans chacune de ses cloisons
, mais encore j’affirme que cette forme de reproduction
n’est pas particulière à cette conferve, et qu’elle s’étend à toutes
les conjuguées à spirales, qui sont comprises dans cette famille.
La première preuve à cet égard , c’est que toutes ces conferves
ayant une organisation extrêmement semblable , l’analogie
ne nous permet pas d’assigner une reproduction différente à
des êtres qui ont de si grands rapports. L a seconde , c’est que
dans toutes ces conferves la réunion a lieu , comme dans la
conferva jugalis , que ‘la matière verte passe d’un tube à fautre
au moyen des canaux de communication, et qu’après le passage
elle se réunit en globules. L a troisième , c’est que j’ai déjà
vu ce développement dans quelques autres espèces.
J’avouerai cependant que je ne suis pas sûr que ces globules
contiennent comme dans la conferva ju g a lis , indépendamment
de la jeune conjuguée , ce sac ou cette enveloppe extérieure que
j’ai comparée aux cotylédons des plantes. L a conjuguée N.“ f .
Pl. y.'"“ Fig. 4.’”= dont nous avons suivi le développement
comme celui de la jugalis, ne nous a présenté qu’un grain qui
s’étendait , ’ et qui prenait p eu -à -p eu la forme d’une confercoe.
La conjuguée à portiques, dont je suivis le développement au
printemps de fan V I I I , ne m’offrit non plus que de jeunes
conjuguées sans vestiges d’enveloppes. Cependant ces faits ne
G
• l i
t