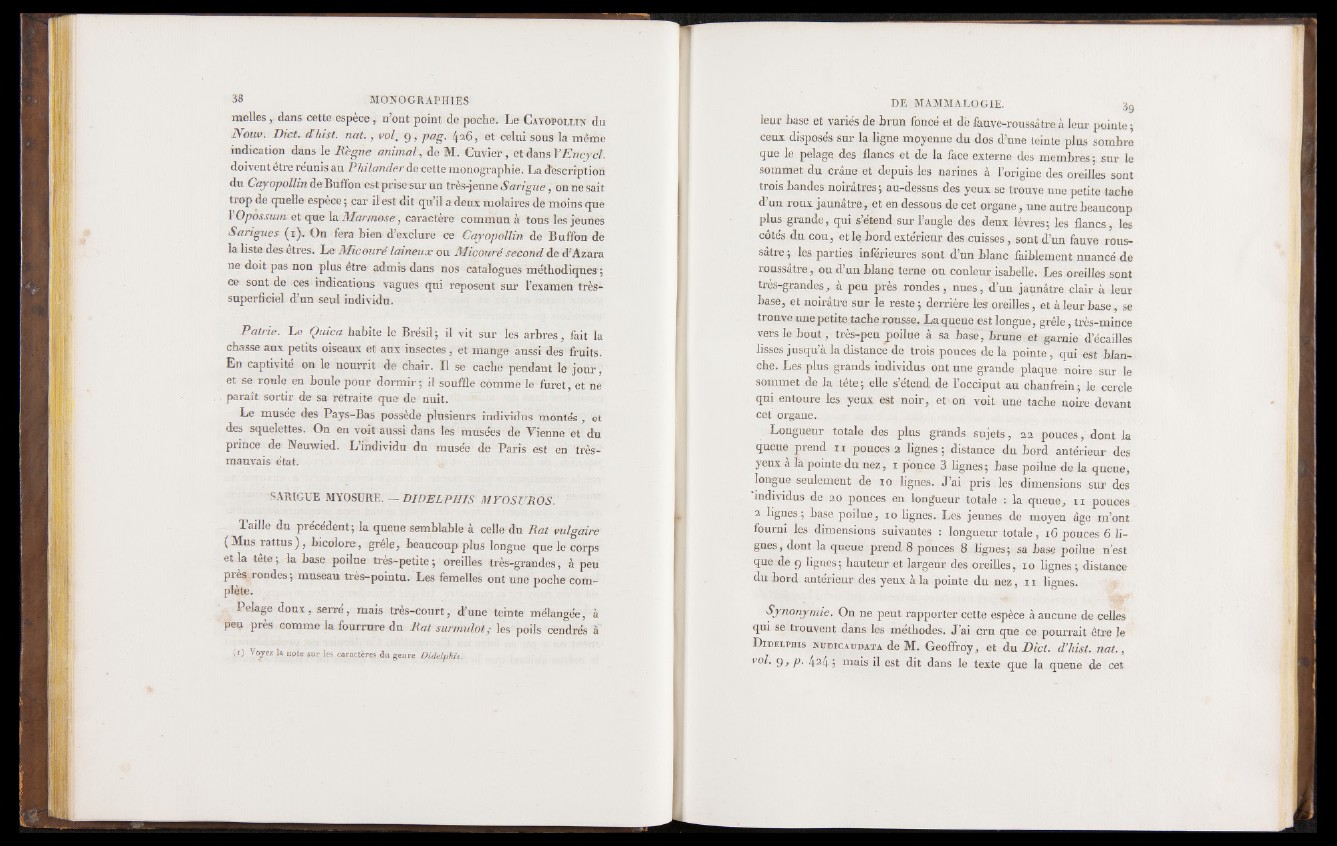
nielles, dans cette espèce, n’ont point de poche. Le C ayopollin du
JYouv. Dict. d’hist. nat. , vol, g , pag. 426, et celui sous la même
indication dans le Règne animal, de M. Cuvier, et dans YEncycl.
doivent être réunis au Philander de cette monographie. La description
du Cayopollin de Buffon est prise sur un très-jeune Sarigue, on ne sait
trop de quelle espece ; car il est dit qu’il a deux molaires de moins que
1 Opossum et que la IMarmosecaractère commun à tous les jeunes
Sarigues (1). On fera bien d’exclure ce Cayopollin de Buffon de
la liste des êtres. Le i\Iicourc laineux ou Micowrèsecond de d’Azara
ne doit pas non plus être admis dans nos catalogues méthodiques ;
ce sont de ces indications vagues qui reposent sur l’examen très-
superficiel d’un seul individu.
Patrie. Le Quica habite le Brésil ; il vit sur les arbres, fait la
chasse aux petits oiseaux et aux insectes, et mange- aussi des fruits.
En captivité on le nourrit de chair. Il se cache pendant le jour,
et se roule en boule pour dormir; il souffle comme le furet, et ne
paraît sortir de sa retraite que de nuit.
Le musée des Pays-Bas possède plusieurs individus montés, et
des squelettes. On en voit aussi dans les musées de Vienne et du
prince de Neuwied. L’individu du musée de Paris est en très-
mauvais état.
SARIGUE MYOSURE. — DIDELPHIS MYOSUROS.
Taille du précédent; la queue semblable à celle du Rat vulgaire
(Mus rattus) , bicolore, grêle, beaucoup plus longue que le corps
et la tête; la base poilue très-petite; oreilles très-grandes, à peu
près rondes ; museau 1res—poiuLu. Les femelles ont une poche complète.
Pelage doux, serré, mais très-court, d’une teinte mélangée, à
peu près comme la fourrure du Rat surmuloty les poils cendrés h
(1) Voyez la note sur les caractères du genre Didelphis.
leur base et variés de brun foncé et dé fauve-roussâtre à leur pointe ;
ceux disposés sur la ligne moyenne du dos d’une teinte plus sombre
que le pelage des flancs et de la face externe des membres ; sur le
sommet du crâne et depuis les narines à l’origine des oreilles sont
trois bandes noirâtres; au-dessus des yeux se trouve une petite tache
d’un roux jaunâtre, et en dessous de cet organe, une autre beaucoup
plus grande, qui s’étend sur l’angle des deux lèvres; les flancs, les
côtés du cou, et le bord extérieur des cuisses, sont d’un fauve rous-
sâtre ; les parties inférieures sont d’un blanc faiblement nuancé de
roussâtre, ou d’un blanc terne ou couleur isabelle. Les oreilles sont
très-grandes, à peu près rondes, nues, d’un jaunâtre clair à leur
base, et noirâtre sur le reste; derrière les oreilles, et à leur base, se
trouve une petite tache rousse. La queue est longue, grêle, très-mince
vers le bout, tres-peu poil ue a sa base, brune et garnie d’écailles
lisses jusqu’à la distance de trois pouces de la pointe, qui est blanche.
Les plus grands individus ont une grande plaque noire sur le
sommet de la .tête; elle s’étend de l’occiput au chanfrein; le cercle
qui entoure les yeux est noir, et on voit une tache noire devant
cet organe.
Longueur totale des plus grands sujets, 22 pouces, dont la
queue prend 11 pouces 2 lignes; distance du bord antérieur des
yeux à la pointe du nez, 1 pouce 3 lignes; base poilue de la queue,
longue seulement de 10 lignes. J’ai pris les dimensions sur des
individus de 20 pouces en longueur totale : la queue, 11 pouces
2 lignes ; base poilue, 10 lignes. Les jeunes de moyen âge m’ont
fourni les dimensions suivantes : longueur totale, 16 pouces 6 lignes,
dont la queue prend 8 pouces 8 lignes; sa base poilue n’est
que de 9 lignes; hauteur et largeur des oreilles, 10 lignes ; distance
du bord anterieur des yeux à la pointe du nez, 11 lignes.
Synonymie. On ne peut rapporter cette espèce à aucune de celles
qui se trouvent dans les méthodes. J’ai cru que ce pourrait être le
D id e l p h is n u b ic a u d a t a de M. Geoffroy, et du Dict. d ’hist. n a t.,
vol. 9 , p. 424 ; mais il est dit dans le texte que la queue de cet