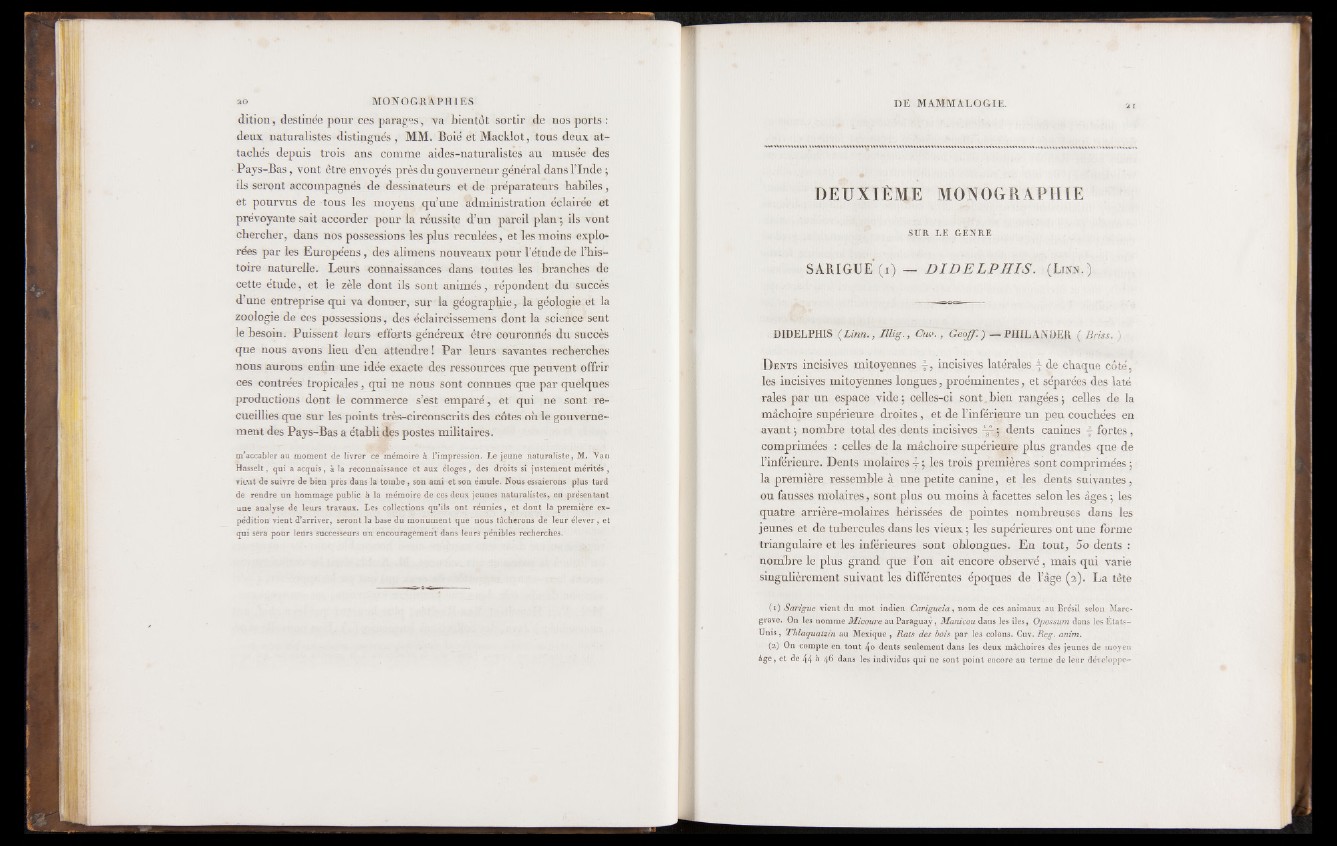
dition, destinée pour ces parages, Ta bientôt sortir de nos ports :
deux naturalistes distingués , MM. Boié et Macklot, tous deux attachés
depuis trois ans comme aides-naturalistes au musée des
Pays-Bas, vont être envoyés près du gouverneur général dans l’Inde ;
ils seront accompagnés de dessinateurs et de préparateurs habiles,
et pourvus de tous les moyens qu’une administration éclairée et
prévoyante sait accorder pour la réussite d’un pareil plan1 2; ils vont
chercher, dans nos possessions les plus reculées, et les moins explorées
par les Européens, des alimens nouveaux pour l’étude de l’histoire
naturelle. Leurs connaissances dans toutes les branches de
cette étude, et le zèle dont ils sont animés, répondent du succès
d’une entreprise qui va donner, sur la géographie, la géologie et la
zoologie de ces possessions, des éclaircissemens dont la science sent
le besoin. Puissent leurs efforts généreux être couronnés du succès
que nous avons lieu d’en attendre ! Par leurs savantes recherches
nous aurons enfin une idée exacte des ressources que peuvent offrir
ces contrées tropicales, qui ne nous sont connues que par quelques
productions dont le commerce s’est emparé, et qui ne sont recueillies
que sur les points très-circonscrits des côtes où le gouvernement
des Pays-Bas a établi des postes militaires.
m’accabler au moment de livrer ce mémoire à l’impression. Le jeune naturaliste, M. Van
Hasselt, qui a acquis, à la reconnaissance et aux éloges, des droits si justement mérités,
vient de suivre de bien près dans la tombe , son ami et son émule. Nous essaierons plus tard
de rendre un hommage public à la mémoire de ces deux jeunes naturalistes, en présentant
une analyse de leurs travaux. Les collections qu’ils ont réunies , et dont la première expédition
vient d’arriver, seront la base du monument que'nous tâcherons de leur élever , et
qui sera pour leurs successeurs un encouragement dans leurs pénibles recherches.
DEUXIÈME MONOGRAPHIE
SUR L E GEN R E
SA R IG U E ( i ) — D I D E L P H I S . (Linn. )
DIDELPHIS {Linn., Illig., Cuv., Geoff.) —PHILViN'DER ( B ris s. )
D en t s incisives mitoyennes | r , incisives latérales -f de chaque côté,
les incisives mitoyennes longues, proéminentes, et séparées des laté
raies par un espace vide ; celles-ci sont, bien rangées ; celles de la
mâchoire supérieure droites, et de l’inférieure un peu couchées en
avant ; nombre total des dents incisives fgfe dents canines » fortes ,
comprimées : celles de la mâchoire supérieure plus grandes que de
l’inférieure. Dents molaires \ ; les trois premières sont comprimées ;
la première ressemble à une petite canine, et les dents suivantes,
ou fausses molaires, sont plus ou moins à facettes selon les âges ; les
quatre arrière-molaires hérissées de pointes nombreuses dans les
jeunes et de tubercules dans les vieux ; les supérieures ont une forme
triangulaire et les inférieures sont ohlongues. En tout, 5o dents :
nombre le plus grand que l’on ait encore observé , mais qui varie
singulièrement suivant les différentes époques de l’âge (2). La tête
( 1) Sarigue vient du mot indien Carigueia, nom de ces animaux au Brésil selou Marc-
grave. On les nomme Micoure au Paraguay, Manicou dans les îles, Opossum dans les États-
Unis , Thlaquatzin au Mexique , Rats des bois par les colons. Cuv. Reg. anim.
(2) On compte en tout 4o dents seulement dans les deux mâchoires des jeunes de moyen
âge, et de 44 à 46 dans les individus qui ne sont point encore au terme de leur développe