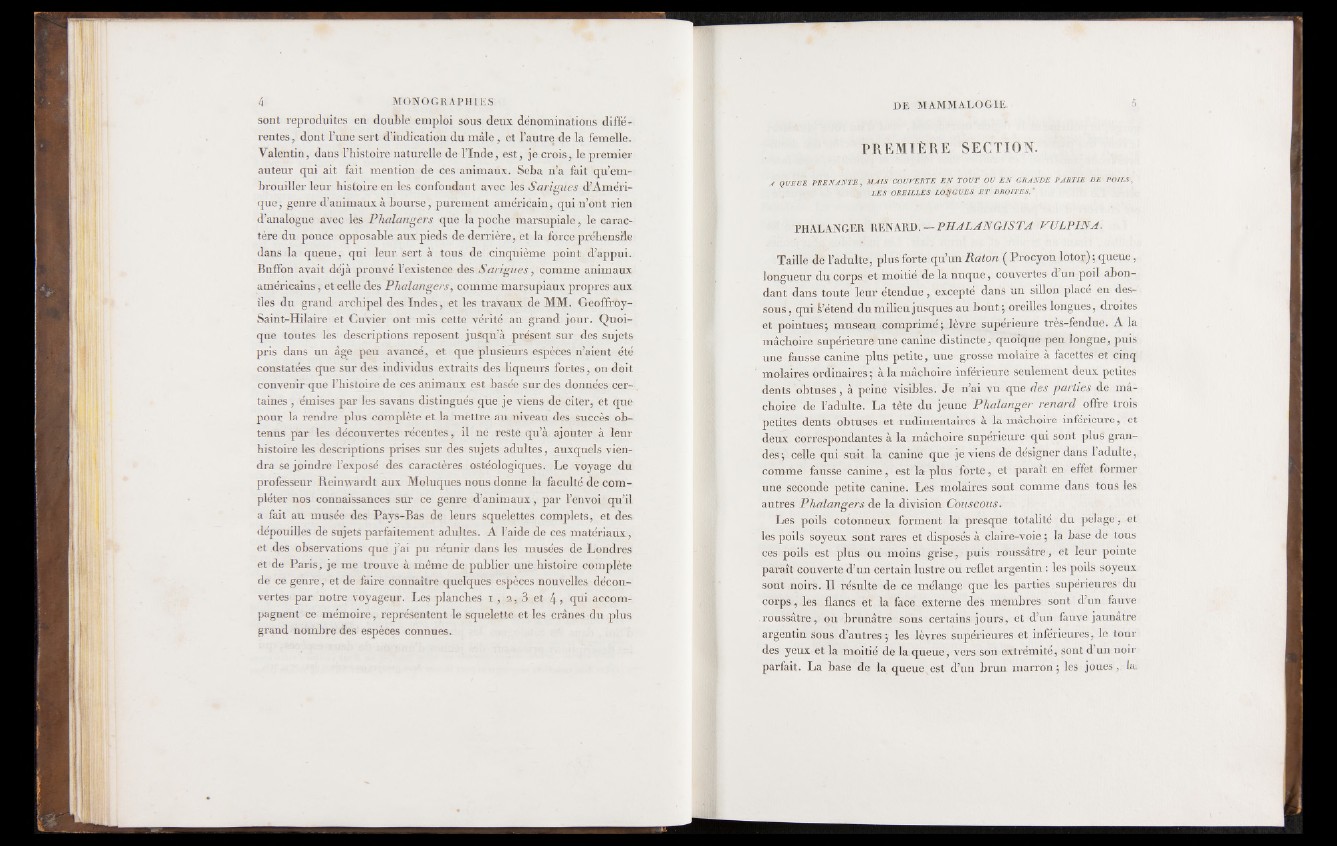
sont reproduites en double emploi sous deux dénominations différentes
, dont l’une sert d’indication du mâle, et l’autre de la femelle.
Valentin, dans l’histoire naturelle de l’Inde, est, je crois, le premier
auteur qui ait fait mention de ces animaux. Seba n’a fait qu’embrouiller
leur histoire en les confondant avec les Sarigues d’Amérique,
genre d’animaux à bourse, purement américain, qui n’ont rien
d’analogue avec les Phalangers que la poche marsupiale, le caractère
du pouce opposable aux pieds de derrière, et la force préhensile
dans la queue, qui leur sert à tous de cinquième point d’appui.
Buffon avait déjà prouvé l’existence des Sarigues, comme animaux
américains, et celle des Phalangers, comme marsupiaux propres aux
îles du grand archipel des Indes, et les travaux de MM. Geoffroy-
Saint-Hilaire et Cuvier ont mis cette vérité au grand jour. Quoique
toutes les descriptions reposent jusqu’à présent sur des sujets
pris dans un âge peu avancé, et que plusieurs espèces n’aient été
constatées que sur des individus extraits des liqueurs fortes, on doit
convenir que l’histoire de ces animaux est basée sur des données certaines
, émises par les savans distingués que je viens de citer, et que
pour la rendre plus complète et la mettre au niveau des succès obtenus
par les découvertes récentes, il ne reste qu’à ajouter à leur
histoire les descriptions prises sur des sujets adultes, auxquels viendra
se jpindre l’exposé des caractères ostéologiques. Le voyage du
professeur Reinwardt aux Moluques nous donne la faculté de compléter
nos connaissances sur ce genre d’animaux, par l’envoi qu’il
a fait au musée des Pays-Bas de leurs squelettes complets, et des-
dépouilles de sujets parfaitement adultes. A l’aide de ces matériaux,
et des observations que j’ai pu réunir dans les musées de Londres
et de Paris, je me trouve à même de publier une histoire complète
de ce genre, et de faire connaître quelques espèces nouvelles découvertes
par notre voyageur. Les planches i , 2, 3 et 4 > qui accompagnent
ce mémoire, représentent le squelette et les crânes du plus
grand nombre des espèces connues^
PREMIÈRE SECTION.
a - QUEUE M E N A N T E , MAIS COUVERTE E N TOUT OU E N GRANDE PARTIE DE POILS,
LES OREILLES LONGUES E T DROITES. '
PHALANGER RENARD. — P II AL A N GIS TA VULPINA.
Taille de l’adulte, plus forte qu’un Raton ( Procyon lotor) ; queue,
longueur du corps et moitié de la nuque, couvertes d un poil abondant
dans toute leur étendue, excepté dans un sillon placé en dessous
, qui S’étend du milieu jusques au bout ; oreilles longues, droites
et pointues; museau comprimé; lèvre supérieure tres-fendue. A la
mâchoire supérieure une canine distincte, quoique peu longue, puis
une fausse canine plus petite, une grosse molaire à facettes et cinq
molaires ordinaires ; à la mâchoire inférieure seulement deux petites
dents obtuses, à peine visibles. Je n’ai vu que des parties de mâchoire
de l’adulte. La tête du jeune Phalanger renard offre trois
petites dents obtuses et rudimentaires à la mâchoire inférieure, et
deux correspondantes à la mâchoire supérieure qui sont plus grandes
; celle qui suit la canine que je viens de désigner dans l’adulte,
comme fausse canine, est la plus forte, et paraît en effet former
une seconde petite canine. Les molaires sont comme dans tous les
autres Phalangers de la division Couscous.
Les poils cotonneux forment la presque totalité du pelage, et
les poils soyeux sont rares et disposés à claire-voie ; la base de tous
ces poils est plus ou moins grise, puis roussâtre, et leur pointe
paraît couverte d’un certain lustre ou reflet argentin : les poils soyeux
sont noirs. Il résulte de ce mélange que les parties supérieures du
corps, les flancs et la face externe des membres sont d’un fauve
roussâtre, ou brunâtre sous certains jours, et d’un fauve jaunâtre
argentin sous d’autres; les lèvres supérieures et inférieures, le tour
des yeux et la moitié de la queue, vers son extrémité, sont d’un noir
parfait. La base de la queue est d’un brun marron; les joues, lu