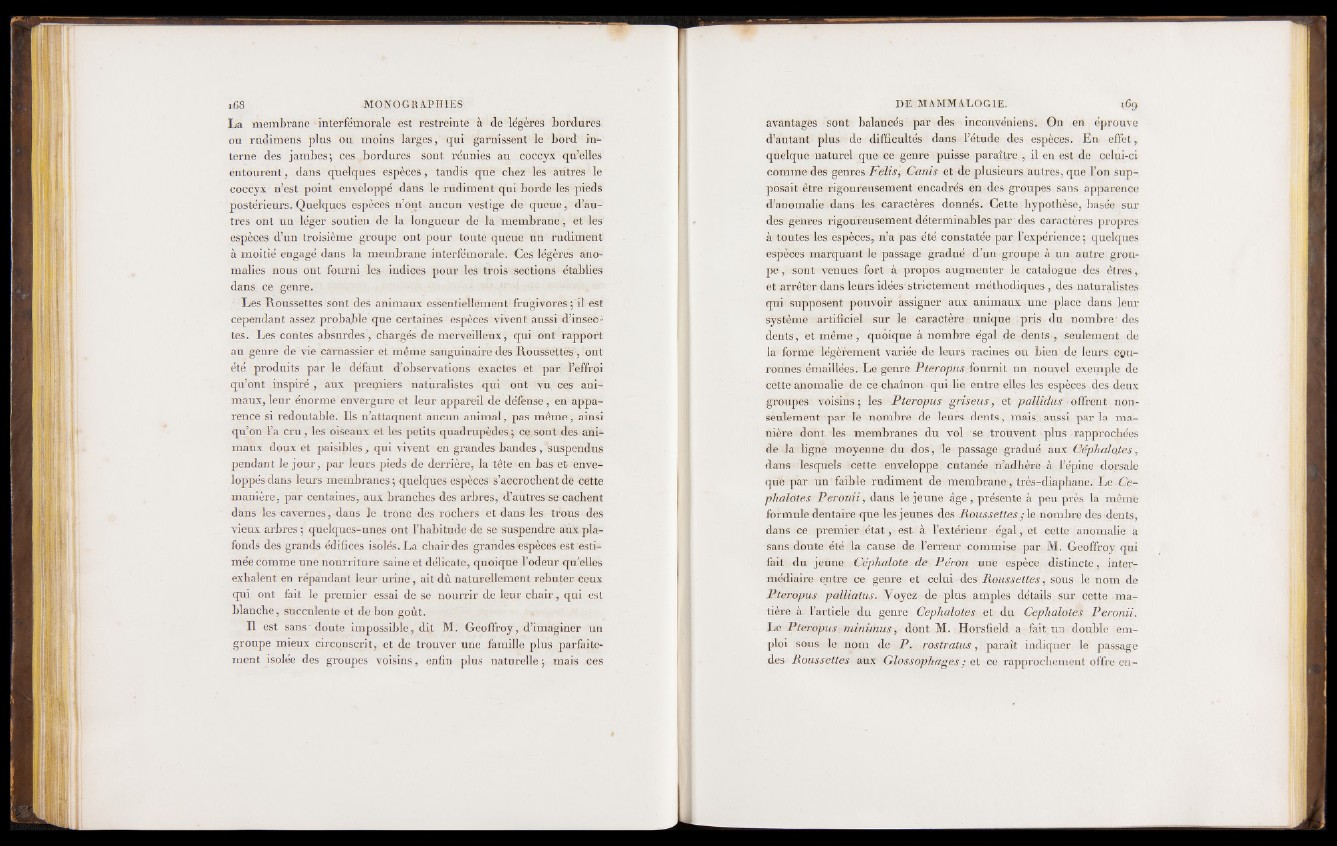
La membrane interfémorale est restreinte à de légères bordures
ou rudimens plus ou moins larges, qui garnissent le bord interne
des jambes; ces bordures sont réunies au coccyx qu’elles
entourent, dans quelques espèces, tandis que chez les autres le
coccyx n’est point enveloppé dans le rudiment qui borde les pieds
postérieurs. Quelques espèces n’ont aucun vestige de queue, d’autres
ont un léger soutien de la longueur de la membrane, et les
espèces d’un troisième groupe ont pour toute queue un rudiment
à moitié engagé dans la membrane interfémorale. Ces légères anomalies
nous ont fourni les . indices pour les trois sections établies
dans ce genre.
Les Roussettes sont des animaux essentiellement frugivores ; il est
cependant assez probable que certaines espèces vivent aussi d’insectes.
Les contes absurdes’, chargés de merveilleux, qui ont rapport
au genre de vie carnassier et même sanguinaire des Roussettes , ont
été produits par le défaut d’observations exactes et par l’effroi
qu’ont inspiré , aux premiers naturalistes qui ont vu ces animaux,
leur énorme envergure et leur appareil de défense, en apparence
si redoutable. Ils n’attaquent aucun animal, pas même, ainsi
qu’on l’a cru, les oiseaux et les petits quadrupèdes ; ce sont des animaux
doux et paisibles, qui vivent en grandes bandes, suspendus
pendant le jour, par leurs pieds de derrière, la tête en bas et enveloppés
dans leurs membranes ; quelques espèces s’accrochent dé cette
manière, par centaines, aux branches des arbres, d’autres se cachent
d'ans les cavernes, dans le tronc des rochers et dans les trous des
vieux arbres ; quelques-unes ont l’habitude de se suspendre aux plafonds
des grands édifices isolés. La chair des grandes espèces est estimée
comme une nourriture saine et délicate, quoique l’odeur qu’elles
exhalent en répandant leur urine, ait dû naturellement rebuter ceux
qui ont fait le premier essai de se nourrir de leur chair, qui est
blanche, succulente et de bon goût.
Il est sans doute impossible, dit M. Geoffroy, d’imaginer un
groupe mieux circonscrit, et de trouver une famille plus parfaitement
isolée des groupes voisins, enfin plus naturelle ; mais ces
avantages sont balancés: par des inconvéniens. On en éprouve
d’autant plus de difficultés dans l’étude des espèces. En effet,
quelque naturel que ce genre puisse paraître , il en est de celui-ci
comme des genres Félisj Canis et de plusieurs autres, que l’on supposait
être rigoureusement encadrés en des groupes sans apparence
d’anomalie dans les, caractères donnés. Cette hypothèse, basée sur
des genres rigoureusement déterminables par des caractères propres
à toutes les espèces, n’a pas été constatée par l’expérience; quelques
espèces marquant le passage gradué d’un groupe à un autre groupe,
sont venues fort à-propos augmenter le catalogue des êtres,
et arrêter dans leurs idées'strictement méthodiques , des naturalistes
qui supposent pouvoir assigner aux animaux une place dans leur
système artificiel sur le caractère unique pris du nombre'des
dents, et même, quoique à nombre égal de dents , seulement de
la forme légèrement variée de leurs racines ou bien de leurs couronnes
émaillées. Le genre Pteropus fournit un nouvel exemple de
cette anomalie de ce chaînon qui lie entre elles les espèces des deux
groupes voisins ; les Pteropus griseus, et pallidus offrent non-
seulement par. le nombre de leurs dents, mais ;aussi par la manière
dont lès membranes du vol se trouvent plus rapprochées
de la ligne moyenne du dos, le passage gradué aux (MphaloJ.es,
dans lesquels -cette enveloppe cutanée n’adhère à l’épine dorsale
que par un faible rudiment de membrane-, très-diaphane. Le Ce-
phalotes Peronii, dans le jeune âge, présente à peu près la même
formule dentaire que les jeunes des Roussettes ; le nombre des dents,
dans ce premier'état, est à l’extérieur égal, et cette anomalie a
sans doute été la cause de l’erreur commise par M. Geoffroy qui
fait du jeune Céphalote de Pérou une espèce distincte, intermédiaire
entre ce genre et celui des Roussettes, sous le nom de
Pteropus palliatus. Voyez de plus amples détails sur cette matière
à l’article du genre Cephalotes et du Cephalolès Peronii.
Le Pteropus miniihus, dont M. Horsfield a fait, un double emploi
sous le nom de P. rostralus, paraît indiquer le, passage
des Roussettes aux Glossopkages; et ce rapprochement offre en