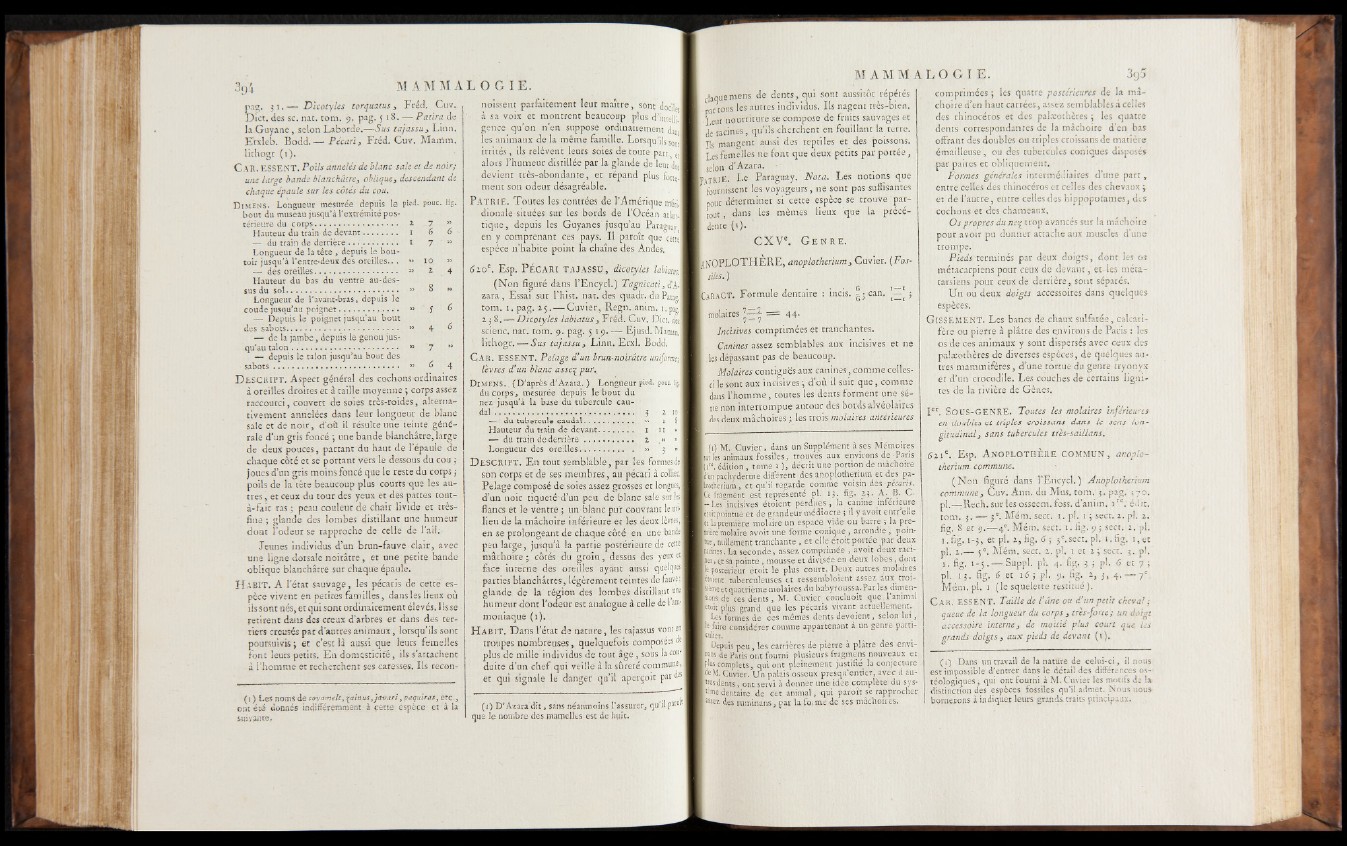
^ ) 4 m a m m a l o g i e .
p a g . 3 1 . — D i c o ty l e s torquatus , F r é d . C u v .
D ie r . d es sc. n a t. tom . 9. p a g . 5 1 8 . —— P a t ir a de
la G u y a n e , s e lo n L a b o r d e .— S u s ta ja s s u , L in n .
E r x le b . B o d d .— P é c a r i , F r é d . C u v . M a ir im .
lichogr (1 ).
C A R . ESSENT. P o i l s annelés de b la n c sa le et de no ir ;
une large bande blanchâtre, o b liq u e , descend ant de
ch aqu e épaule su r le s cô tés du cou .
D im e n s . Longueur mesurée depuis le pied,
bout du museau jusqu'à l'extrémité postérieure
du corps....... ........................ 2.
pouc. lig.
76 6
7
10 ?»
2 . 4
8 »
Hauteur du train de devant.............. 1
— du train de derrière ................ 1
Longueur de la tête ,• depuis le boutoir
jusqu'à l'entre-deux des oreilles... «
— des oreilles........................ »»
Hauteur du bas du ventre au-des?
sus du sol........ ................. . • • • »?
Longueur de l'avant-bras, depuis le
coude jusqu'au poignet.................. *»
— Depuis le poignet jusqu'au bout
des sabots.......................................... 33
S 6
4 6
— de la jambe, depuis le genou jusqu’au
talon............ ........................ 93 7 »*
— depuis le talon jusqu’au bout des
sabots ......................................... *» o 4
DE SC R IPT . A s p e c t g é n é ra l d es co c h o n s ord in a ires
à o re ille s d r o ite s e t à ta ille m o y e n n e 3 co rp s assez
r a c c o u r c i, c o u v e rt d e so ies tr è s-ro id e s, a lte r n a tiv
em e n t a n n e lé e s d an s le u r lo n g u e u r d e b la n c
sa le e t d e n o ir , d ’o ù il résu lte u n e te in te g é n é ra
le d ’un g ris fo n c é ; u n e b a n d e b la n c h â tre , la rg e
d e d eu x p o u c e s , p a rta n t d u h a u t d e l ’ép a u le de
c h a q u e c ô té e t se p o rta n t v e rs lé dessous du co u 3
jo u e s d ’un g ris m o in s fo n c é q u e le reste d u corp s j
p o ils d e la tête b e a u c o u p plus co u rts xpie le s a u t
r e s , e t ceu x du to u r des y e u x e t d es p attes to u t-
si-fait ras 5 p eau c o u le u r d e c h a ir liv id e e t trè s-
fin e ; g la n d e d es lom b e s d istilla n t u n e h um e u r
d o n t l ’o d e u r se ra p p ro c h e d e c e lle d e l ’a il;
J eu n es in d iv id u s d ’u n b ru n -fa u v e c la ir , a v e c
u n e lig n e d o rsa le n o ir â tr e , e t u n e p e tite b a n d e
o b liq u e b la n c h â tre sur c h a q u e ép a u le.
H a b i t . A l ’é ta t s a u v a g e , les p écaris d e c e tte esp
è c e v iv e n t en p e tite s f am ille s , d an s les lieu x o ù
ils so n t n és, e t q u i so n t o rd in a irem e n t é le v é s . 1 1s se
re tir e n t dans des creu x d ’a rb res e t d an s d es te rriers
creusés p a r d ’au tres a n im a u x , lo rsq u ’ils so n t
p o u rsu ivis j e t c ’est là au ssi q u e leurs fem e lle s
fo n t leurs p etits. E n d om e s tic ité , ils s'a tta c h e n t
à l ’h om m e e t re c h e rc h e n t ses caresses. I ls recon -
(l ) Les noms de coyamelc, i^ainus,‘ja va ri3 paquiras, etç.,
ont été donnés indifféremment • à cette espèce et à la
sub'îtme,
n o is se n t p a rfa item e n t le u r m a îtr e , sont docile,
à sa v o ix e t m o n tr e n t b ea u co u p plus d’intellî
g e n c e q u ’o n n ’e n su p p ose o rd in airem en t dan,
le s a n im a u x d e la m êm e fam ille . L o rs q u ’ils sont
ir r it é s , ils re lè v e n t leurs so ies d e tou te part, et
alors l ’h um e u r d istillé e par la g la n d e de leur dos
d e v ie n t tr è s -a b o n d a n te , e t rép a n d plus forte-
m e n t so n o d e u r d é sag ré a b le .
P a t r i e . T o u te s les co n tré e s d e l ’Am é riq u e itféri.
d io n a le situ ées su r les b o rd s d e l’O céa n atlant
iq u e , d ep u is les G u y a n e s ju sq u ’au Paraguay]
en y com p re n a n t ces p ays. I l p aro ît que cette
esp èce n ’h a b ite p o in t la ch a în e des Andes.
6 2 0 e. E s p . PÉCARI TAJASSU, dicoty les labiatusl
(N o n fig u ré d an s l ’E n c y c l.) T a g n ica ti, d’A-
z a r a , E s sa i sur l ’h ist. n a t. des q u ad r. du Para»,
tom . 1 . p a g . 2 5 . — C u v ie r , R e g n . an im . i.pag,
2 3 8. — D i c o ty l e s labia tù s , F r é d . C u v . Dict.des
sc ien c. n a t. tom . 9 . p ag. 5 1 9 . — - E ju sd . MamtnJ
' lith o g r . — S u s ta ja s s u , L in n . E r x l. Bodd.
C A R . ESSENT. P e la g e d’ un brun-noirâtre uniforme;]
lèvres d ’ un b la n c asse% p urK
D im e n s . . (D ’après d’ A zara. ) L ongueu r pied. pouc. lig.
du c o r p s, mesurée depuis le b ou t du
n ez jusqu’ à 1a base du tu bercu le cau dal
.........y.. , . . . 3 2 10
— du tubercule caudal.......... . . . » 1 8
Hauteur du train de devant............ 1 • 11 «
— du train de derrière . . . . . . . . . . . 2 .» »
Longueur des oreilles......... v > » 3 »
DESCRIPT. E n to u t s em b la b le , par les formes de
so n co rp s et d e ses m em b r e s , au p é ca ri,à collier.
P e la g e com p o sé d e soies assez grosses et longues,j
d ’u n n o ir tiqueté^d’un p e u d e b la n c sale sur les
flancs e t le v e n tr e 3 un b la n c pu r cou vran t lemi-j
lie u d e la m â ch o ire in fé rie u r e e t les deux lèvres,
en s e p ro lo n g e a n t d e c h a q u e c ô té e n une bande
p e u la r g e , ju sq u ’à la p a rtie p o stérieu re de cette
m â c h o ire 3 cô tés du g r o in , dessus des yeux et
fac e in te rn e d ès o re ille s a y a n t aussi quelques
p arties b la n c h â tre s , lé g è r em e n t te in te s de fauve;
g la n d e d e la ré g io n des lom b e s distillan t une
h um e u r d o n t l’o d e u r est a n alo g u e à celle de 1 amm
o n ia q u e ( 1 ) .
H a b i t . D a n s l ’é ta t d e n a tu r e , les tajassus vont en
trou p es n om b r e u s e s , q u e lq u e fo is composées de
p lu s d e m ille in d iv id u s d e to u t â g e , sous la cond
u ite d ’un c h e f q u i v e ille à la sû reté commune,
e t q u i s ig n a le le d a n g e r q u ’il a p e rç o it par des
( 0 D’Azara dit, sans néanmoins l'assurer, qu'ilparou
que le nombre des maipelles est de huit.
claque m en s d e d e n ts , q u i so n t au ssitô t rép étés
partons les autres in d iv id u s. Ils n a g e n t très-b ien .
Leur n o u rritu re se com p o se d e fru its sau vages et
de racin es, q u ’ils c h e rch e n t en fo u illa n t la terre.
Ils m an gen t aussi des re p tile s e t d es p o isso n s.
I Les fem elles ne fo n t q u e d eu x p e tits p a r p o r t é e ,
| selon d ’A za r a . •
L TRI£ . L e P a rag u a y . N o ta . L e s n o tio n s q u e
j fournissent les v o y a g e u r s , n e so n t pas su ffisantes I pour d é te rm in er si c e tte esp èce se tr o u v e p a r- I tou t, dans les m êm e s lie u x q u e la p r é c é dente^!)*
C X V e. G e n r e .
A N O P L O T H E R E , anoplotherium , C u v ie r . ( F o s siles;
j
CaRa CT. F o rm u le d e n ta ire : in cis. - 3 can . * 3
molaires | g | = 4 4 -
Incisives com p rim é e s e t tra n c h an te s.
Canines a ssez sem b la b le s aux in c is iv e s e t n e
les dépassant pas d e b eau co u p .
Molaires c o n tig u ë s au x c a n in e s , c om m e celles-
ci le sont au x in c is iv e s 3 d ’o ù il su it q u e , c om m e
dans l’h o m m e , to u tes les d en ts fo rm e n t u n e sé rie
non in te rrom p u e au tou r d es b ord s a lv é o la ire s
des deux m â ch o ire s 3 les tro is molaires antérieures * I
(1) M. Cuvier, dans un Supplément à ses Mémoires
sur les animaux fossiles, trouvés aux environs de-Paris
(ire. édition, tome \ % décrit Une portion de mâchoire
d’un pachyderme différent des anoplotherium et des paléothérium,
et qu’il regarde comme voisin des pécaris.
Le fragment est représenté pl. 13. 23* A. B. C-
- Les incisives étoient perdues , la canine inférieure
étoitpointue et de grandeur médiocre y il y avoit entr elle
et la première molaire un espace vide ou barre ; la première
molaire avoit une forme conique, arrondie, pointue,
nullement tranchante , et elle étoit portée par deux
racines. La seconde, assez comprimée , avoit deux racines,
çt sa pointe , mousse et divisée en deux lobes, dont
le postérieur étoit le plus court. Deux autres molaires
Soient tuberculeuses et ressembloient assez aux troisième
et quatrième molaires du babyroussa.Par les dimensions
de ces dents, M. Cuvier concluoit que J'animai
étoit plus grand que les pécaris vivant actuellement.
I Les formes de ces mêmes dents dévoient, selon lui,
fie faire considérer comme appartenant à un genre parti-
ctilier. .
Depuis peu, les carrières de pierre à plâtre des environs
de Paris ont fourni plusieurs fragmens nouveaux et
plus complets, qui ont pleinement justifié la conjecture
de M. Cuvier. Un palais osseux presqu entier, avec d autres
dents, ont servi à donner une idée complète du sys-
j terne dentaire de cet animal, qui paroît se rapprocher
assez des ruminans, par la loi me de ses mâchoires.
c om p rim é e s 3 les q u a tre posté rieures d e la m â c
h o ir e d ’en h au t c a rr é e s , a ssez sem b la b le s d ce lle s
des rh in o c é ro s e t d e s p alæ ot hères 3 les q u a tre
d e n ts co rre sp o n d a n te s d e la m â ch o ire d ’en bas
o ffr a n t des d o u b le s ou trip le s cro is sa n sd e m a tiè re
ém a ille u s e , ou d es tu b ercu les co n iq u e s disposé»
par paires et o b liq u em e n t.
F o rm e s générales in te rm é d ia ire s d ’u n e p a r t ,
e n tre ce lle s d es rh in o céro s e t c e lle s d es c h e v a u x 3
e t d e l’a u t r e , e n tre ce lle s d es h ip p o p o tam e s , d e s
co c h o n s e t des ch am e a u x .
O s propres d u n e £ tro p avan cés su r la m â ch o ire
p o u r a v o ir p u d o n n e r a tta ch e aux m u scles d ’u n e
tr om p e .
P i e d s te rm in é s par d eu x d o ig t s , d o n t les os
m é tac a rp ie n s p o u r ceu x d e d e v a n t, e t les m é ta tarsiens.
p o u r ceu x de d e r r iè r e , so n t séparés.
U11 o u d e u x d oig ts accessoires d an s q u e lq u e s
espèces.
GlSSEMENT. L e s bancs d e ch a u x s u lfa t é e , ca lc ari-
fè re ou p ierre à p lâ tre des e n v iro n s d e P a ris : les
os d e ces a n im a u x y so n t dispersés a v e c ceu x d es
p a læ o t h ères d e d iv erses e sp è c e s, d e q u elq u es a u -,
très m am m ifè r e s , d ’u n e ro rtu e du g e n re c r y o n y x
e t d ’un c r o co d ile . L e s co u ch e s d e certa in s lig n i-
tes d e la riv iè re d e G è n e s .
I er. SOUS-GENRE. T o u te s les m o la ir e s inférieures
en d oubles et tr iples c r o is so n s dans le sen s lo n g
itu d in a l, sa n s tubercules très-s a illa n s .
6 z i c. Esp. ANOPLOTHERE COMMUN, a n o p lo -
. therium commune-
( N o n fig u ré dans l ’E n c y c l. ) A n o p lo th e r ium
- c om m u n e , C u v . A n n . du M u s . tom . 3. p a g . 3 70 .
p l.— ;R e c h .s u r les o ss e em .fo ss . d ’a n im . i re; é d it,
tom . 3 . — 5 e. M ém . sect; 1 . p l. 13 se c t. 2. pl. 2.
fie , 8 e t o .— 4 e. M ém . sect. 1. fig . 9 3 secr. 2. pl.
i .f i g . 1-3 , et p l. 2 , fig . d 3 3e.s e c t. p l. 1 . fig . 1, e t
p l. 2 .— $e. M ém . se c t. 2. p l. 1 et 2 3 sect. 3. p l.
1 . fig. 1 - 5 .— .S u p p l, pl-. 4 . fig. 3 3 p l. 6 e t 7 j
p l. 1 3 . fig . 6 e t 1 6 ; p l. 9 . % 2 , 3 , 4* 7 e-
M ém . p l. 1 ( le sq u e le tte re s titu é ).
C a K. E S SEN T . T a i lle de l ’ â n e ou d’ un p e t it ch e v a l y
queue de la longueur du corps , très -fo r te; un d oigt
ac cessoire in te rn e , de m o it ié p lu s court que. Les
grands d oig ts , a u x p ied s de d eva nt (1 ).
(1) Dans un travail de la nature de celui-ci, il nous
est impossible d’entrer dans le détail des différences os-
téologiques, qui ont fourni à M. Cuvier les motifs de la
distinction des espèces fossiles qu’il admet. Nous nous
bornerons à indiquer leurs grands traits principaux.