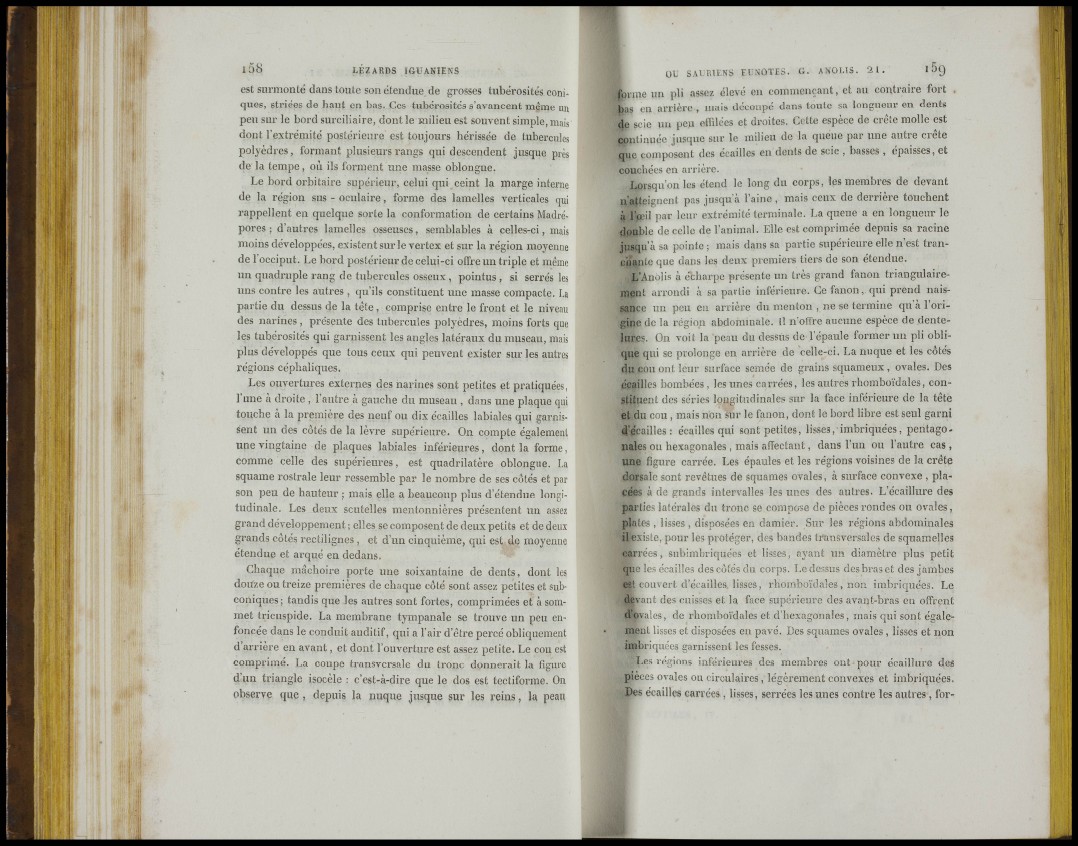
t
i58 LEZARDS IGUANIENS
•v:
est surmonté dans touLe son etendue de grosses tubérosités coniques,
striées de liant en bas. Ces tubérosités s'avancent même un
peu sur le bord surciliaire, dont le milieu est souvent simple, mais
dont l'extrémité postérieure est toujours hérissée de tubercules
polyèdres, formant plusieurs rangs qui descendent jusque près
de la tempe, où ils fondent une masse oblongue.
Le bord orbi taire supérieur, celui qui ceint la marge interne
de la région sus - oculaire, forme des lamelles verticales qui
rappellent en quelque sorte la conformation de certains Madrépores
; d'autres lamelles osseuses, semblables à celles-ci, mais
moins développées, existent sur le vertex et sur la région moyenne
de l'occiput. Le bord postérieur de celui-ci offre un triple et même
un quadruple rang de tubercules osseux, pointus , si serrés les
uns contre les autres , qu'ils constituent une masse compacte. La
partie du dessus de la tête, comprise entre le front et le niveau
des narines, présente des tubercules polyèdres, moins forts que
les tubérosités qui garnissent les angles latéraux du museau, mais
plus développés que tous ceux qui peuvent exister sur les autres
régions cépbaliques.
Les ouvertures externes des narines sont petites et pratiquées,
l'une à droite , l'autre à gauche du museau , dans une plaque qui
touche à la première des neuf ou dix écailles labiales qui garnissent
un des côtés de la lèvre supérieure. On compte également
une vingtaine de plaques labiales inférieures, dont la forme,
comme celle des supérieures, est quadrilatère oblongue. La
squame rostrale leur ressemble par le nombre de ses côtés et par
son peu de hauteur ; mais elle a beaucoup plus d'étendue longitudinale.
Les deux scutelles mentonnières présentent un assez
grand développement ; elles se composent de deux petits et de deux
grands côtés rectilignes , et d'un cinquième, qui est de moyenne
étendue et arqué en dedans.
Chaque mâchoire porte une soixantaine de dents, dont les
douze ou treize premières de chaque côté sont assez petites et subconiques;
tandis que les autres sont fortes, comprimées et à sommet
tricuspide. La membrane tympanale se trouve un peu enfoncée
dans le conduit auditif, qui a l'air d'être percé obliquement
d'arrière en avant, et dont l'ouverture est assez petite. Le cou est
comprimé. La coupe transversale du tronc donnerait la figure
d'un triangle isocèle : c'est-à-dire que le dos est tectiforme. On
observe que , depuis la nuque jusque sur les reins, U peau
OL SAliEIENS FI NOTES, (i. ANOLiS. 21. I OQ
forme un pli assez élevé en commençant, et au contraire fort .
bas en arrière , mais découpé dans toute sa longueur en dents
de scie un peu effilées et droites. Cette espèce de crête molle est
continuée jusque sur le milieu de la queue par ime autre crête
que composent des écailles en dents de scie , basses , épaisses, et
couchées en arrière.
Lorsqu'on les étend le long du corps, les membres de devant
n'atteignent pas jusqu'à l'aine , mais ceux de derrière touchent
à l'oeil par leur extrémité terminale. La queue a en longueur le
double de celle de l'animal. Elle est comprimée depuis sa racine
jusqu'à sa pointe ; mais dans sa partie supérieure elle n'est tranchante
que dans les deux premiers tiers de son étendue.
L'Anùlis à écharpe présente un très grand fanon triangulairement
arrondi à sa partie inférieure. Ce fanon, qui prend naissance
un peu eu arrière du. menton , ne se termine qu'à l'origine
de la région abdominale. 11 n'offre aucune espèce de dentelures.
On voit la peau du dessus de l'épaule former u n pli oblique
qui se prolonge en arrière de celle-ci. La nuque et les côtés
du cou ont leur surface semée de grains squameux , ovales. Des
écailles bombées, les unes carrées, les autres rhomboïdales, constituent
des séries longitudinales sur la face inférieure de la tête
et du cou , mais non sur le fanon, dont le bord libre est seul garni
d'écaillés: écailles qui sont petites, lisses, imbriquées, pentagonales
ou hexagonales , mais affectant, dans l'un ou l'autre cas ,
une figure carrée. Les épaules et les régions voisines de la crête
dorsale sont revêtues de squames ovales, à surface convexe , placées
à de grands intervalles les unes des autres. L'écaillure des
parties latérales du tronc se compose de pièces rondes ou ovales,
plates , lisses , disposées en damier. Sur les régions abdominales
il existe, pour les protéger, des bandes transversales de squamelles
carrées, subimbriquées et lisses, ayant un diamètre plus petit
que les écailles des côtés du corps. Le dessus des bras et des jambes
est couvert d'écaillés lisses, rhomboïdales, non imbriquées. Le
devant des cuisses et la face supérieure des avant-bras en offrent
d'ovales, de rhomboïdales et d'hexagonales, mais qui sont également
lisses et disposées en pavé. Ces squames ovales , lisses et non
imbriquées garnissent les fesses.
Les régions inférieures des membres ont pour écaillure des
pièces ovales ou circulaires, légèrement convexes et imbriquées.
Des écailles carrées , lisses, serrées les unes contre les autres, for-
M
i p il
i ; il 1"
¡f'i • '
[Ei i