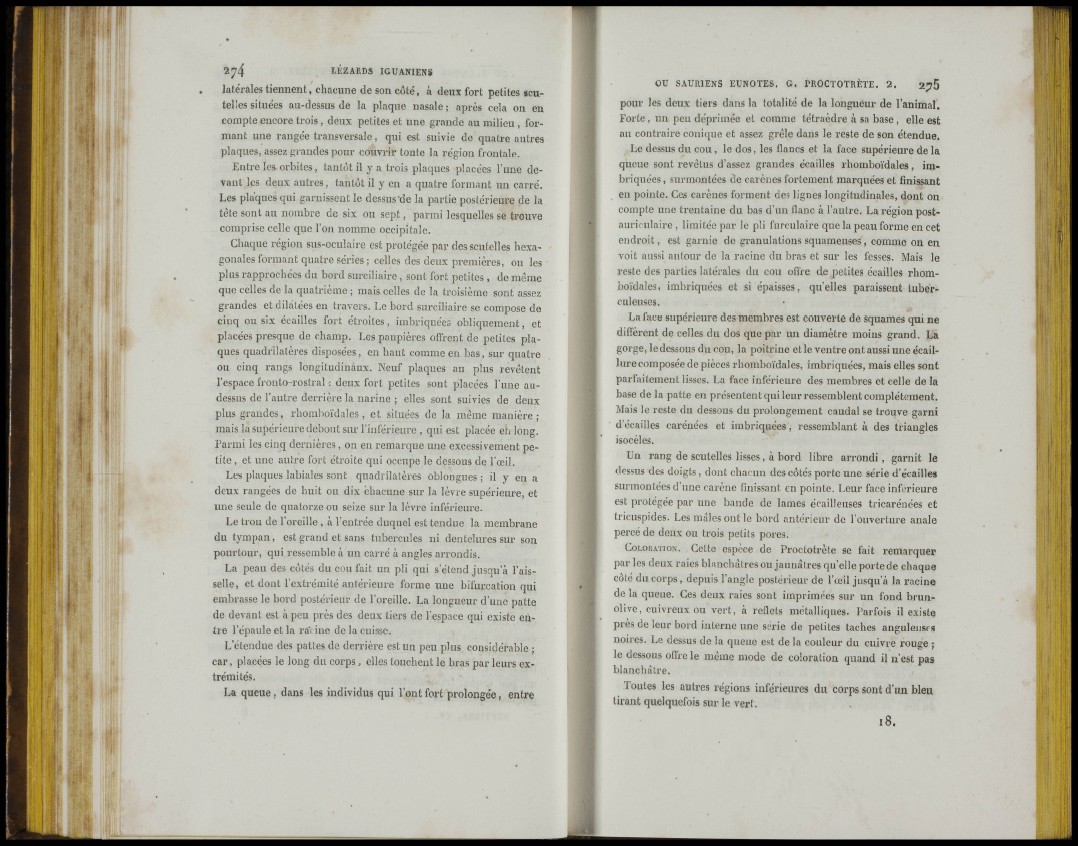
r
t!
•I al
1 i.
i
ti
M
i jlM
;
/ j sf'
.iiXf' ••
LÉZARDS IGUANIENS
laterales tiennent, chacune de son côté, à deux fort petites scutelles
situées au-dessus de la plaque nasale ; après cela on en
compte encore trois, deux petites et une grande au milieu , formant
une rangée transversale, qui est suivie de quatre autres
plaques, assez grandes pour couvrir toute la région frontale.
Entre les orbites, tantôt il y a trois plaques placées l'une devant
les deux autres, tantôt il y en a quatre formant un carré.
Les plaques qui garnissent le dessus'de la partie postérieure de la
tète sont au nombre de six ou sept, parmi lesquelles se trouve
comprise celle que l'oji nomme occipitale.
Chaque région sus-oculaire est protégée par des scutelles hexagonales
formant quatre séries ; celles des deux premières, ou les
plus rapprochées du bord surciliaire, sont fort petites , de même
que celles de la quatrième ; mais celles de la troisième sont assez
grandes et dilatées en travers. Le bord surciliaire se compose de
cinq ou six écailles fort étroites, imbriquées obliquement, et
placées presque de champ. Les paupières offrent de petites plaques
quadrilatères disposées, en haut comme en bas, sur quatre
ou cinq rangs longitudinaux. Neuf plaques au plus revêtent
l'espace fronto-rostral : deux fort petites sont placées l'une audessus
de l'autre derrière la narine ; elles sont suivies de deux
plus grandes, rhomboïdales , et situées de la même manière;
mais la supérieure debout sur l'inférieure , qui est placée eu long.
Parmi les cinq dernières, on en remarque une excessivement petite
, et une autre fort étroite qui occupe le dessous de l'oeil.
Les plaques labiales sont quadrilatères oblongues ; il y en a
deux rangées de huit ou dix chacune sur la lèvre supérieure, et
une seule de quatorze ou seize sur la lèvre inférieure.
Le trou de l'oreille , à l'entrée duquel est tendue la membrane
du tympan, est grand et sans tubercules ni dentelures sur son
pourtour, qui ressemble à un carré à angles arrondis.
La peau des côtés du cou fait un pli qui s'étend jusqu'à l'aisselle,
et dont l'extrémité antérieure forme une bifurcation qui
embrasse le bord postérieur de l'oreille. La longueur d'une patte
de devant est à peu près des deux tiers de l'espace qui existe entre
l'épaule et la racine de la cuisse.
L'étendue des pattes de derrière est un peu plus considérable ;
car, placées le long du corps, elles touchent le bras par leurs extrémités.
La queue, dans les individus qui l'ont fort prolongée, entre
o u SAURIENS EUNOTES. G. PROCTOTRÈTE. 2. 2^5
pour les deux tiers dans la totalité de la longueur de l'animal.
Forte , un peu déprimée et comme tétraèdre à sa base , elle est
au contraire conique et assez grêle dans le reste de son étendue.
Le dessus du cou, le dos, les flancs et la face supérieure de la
queue sont revêtus d'assez grandes écailles rhomboïdales, imbriquées
, surmontées de carènes fortement marquées et finissant
en pointe. Ces carènes forment des lignes longitudinales, dont on
compte une trentaine du bas d'un flanc à l'autre. La région postauriculaire
, limitée par le pli furculaire que la peau forme en cet
endroit, est garnie de granulations squameuses, comme on en
voit aussi autour de la racine du bras et sur les fesses. Mais le
reste des parties latérales du cou oflre de petites écailles rhomboïdales,
imbriquées et si épaisses, qu'elles paraissent tuberculeuses.
La face supérieure des membres est couverte de squames qui ne
diffèrent de celles du dos que par un diaiuètre moins grand. La
gorge, le dessous du cou, la poitrine et le ventre ont aussi une écaillure
composée de pièces rhomboïdales, imbriquées, mais elles sont
parfaitement lisses. La face inférieure des membres et celle de la
base de la patte en présentent qui leur ressemblent complètement.
Mais le reste du dessous du prolongement caudal se trouve garni
d'écaillés carénées et imbriquées, ressemblant à des triangles
isocèles.
Un rang de scutelles lisses, à bord libre arrondi, garnit le
dessus des doigts, dont chacun des côtés porte une série d'écaillés
surmontées d'une carène finissant en pointe. Leur face inférieure
est protégée par une bande de lames écailleuses tricarénées et
tricúspides. Les mâles ont le bord antérieur de l'ouverture anale
percé de deux ou trois petits pores.
COLORATION. Cette espèce de Proctotrète se fait remarquer
par les deux raies blanchâtres ou jaunâtres qu'elle porte de chaque
côté du corps, depuis l'angle postérieur de l'oeil jusqu'à la racine
de la queue. Ces deux raies sont imprimées sur un fond brunolive,
cuivreux ou vert, à reflets métalliques. Parfois il existe
près de leur bord interne une série de petites taches anguleuses
noires. Le dessus de la queue est de la couleur du cuivre rouge ;
le dessous offre le même mode de coloration quand il n'est pas
blanchâtre.
Toutes les autres régions inférieures du corps sont d'un bleu
tirant quelquefois sur le vert.
i8.
H
r
.iiii-,
m i
H'
k'i'
JJ