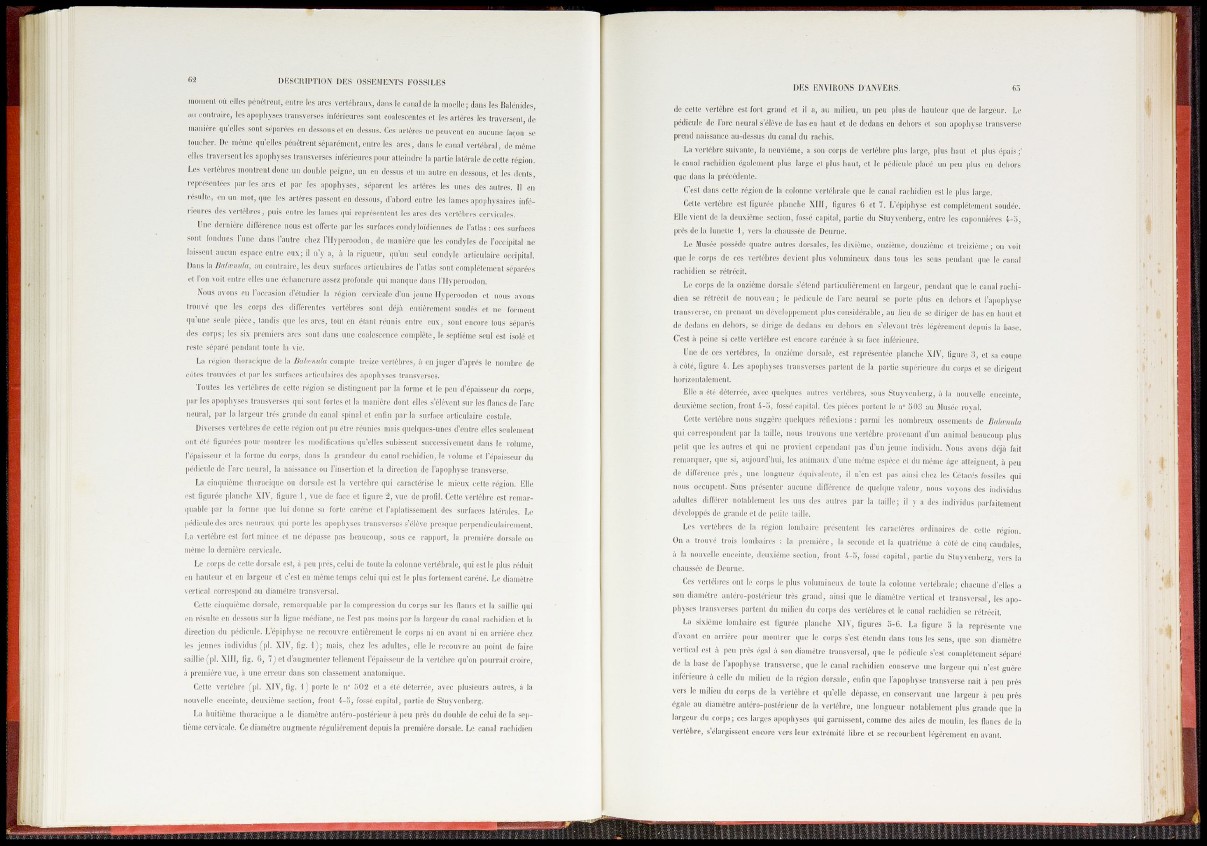
•H:
DtiSCaiPTION DliS OSvSKMKNTS FOSSILES
iiioiiieiil où (îllcs pónètroiil, oiKro les arcs vcrfóbraux, (inns Io ciinal de in moi'llo; dans les JJaléniiies,
ail coiurairc , les apopliyscs traiisvei'sfs iiilorieiii'es soni coalcsceiites el les firtcres les iraverseiK, de
manière qu'elles soni sóparées en dessous et en dessus. Ces arlèi-es ne j)eiivent en aucune faveti se
(oucliei'. De mémo, qu'elles péiièiront s é p a r éme n t , eni r e les a r c s , dans le eanal v e r t é b r a l , de mémo
elles t r ave r s ent ios apophys e s i r ansve r s e s ¡nierienres pour aitoindre la partie laiérale de cetle région.
Les ^e r l èbr c s mont r en t donc un double peigne, un eu dessus et un nuire on dessous, et les dent s ,
représentées par les a r e s et pnr les apophys e s , s épa r enl les artères les une s des auli'es. Il en
résulte, on un mot, que les a r t è r es passent en dessous, d'abord entre les lames a p o p i n s a i r o s inférieures
des v e r l è b r e s , puis eul r e les lames (pii r epr é s enl eni les arcs des ve r t èbr e s (•er\ icnlos.
Une dernière diiïérence nous est oiïerte par les surfaces coiidyloïdiennes de l'adas : ces surfaces
soni fondues l'une dans i ' amr e chez Tl lype roodon , de mani è re que les condyles de l'occipilal ne
laissent aucun espace eniro e u x ; il n'y a, à la r igueur, qu'un seul condyl e arliculaire oecipilal.
Dnns la i i a /oei n d a , au contraire , les deux surfaces articulaires de l'atlas sont complélemeiit séparées
et l'on voit ent r e elles un e é cbanc rur e assez profonde qui ma n q u e dans lHy p e r o o d o n .
Nous avons eu l'occasion d'étudier la région cervicale d'un j e u n e i lype roodon el nous avons
trouvé (|ue les cor|)S des différentes verlèbre s sont déjà ent i è r ement soudés e( ne forment
liu'une seule pi è c e , tandis que les a r e s , tout en étant r éuni s ent r e e u x , sont encore tous séparés
des c o r p s ; les six pr emi e r s a r c s sont dans une coalescence compl è t e , le septième seul est isolé el
l'esté séparé pendani toute la \ i e .
La région tbor a c ique de la Baln-nula compt e treize verlèbres, à en j u g e r d'après le n omb r e de
cotes t rouvé e s et par les surfaces articulaires des apophys e s (ransverses.
Toutes les vertèbres de eeite région se dislinguent par la forme el le peu d'épaisseur du corps
par les a p o p i n s e s t r ansve r s e s qui sont fortes et In mnnière dont elles s'élèvent sur les (laiies do l'arc
neural, |)nr la largeur très g r a n d e du canal spinal et enfin par la surface arlieulaire costale.
Diverses vertèbre s de cetle région ont pu être réunies ma i s que lque s -une s d' ent r e elles s eul ement
ont été l lgur é e s pour mont r e r les modifications qu'elles subissent successivement dans le volume,
répaissenr el la forme du corps, dans la g r a n d e u r du canal r a cbidi en, le volume el l'épaisseur du
pédicule de l'arc neural, la naissance ou l'insertion et la direction de l'apophys e transverse.
La c inqui ème tfiorncique ou dorsale est la ve r t èbr e qui caractérise le mi eux celle région. Elle
est figurée pl anche XIV, figure I, vue de face et ligure "1, vue de profil. Celte vertèbre esl r ema r -
quable par la forme que lui donne sa forte carène et l'aplalissenient des surfaces hiléralos. Lo
pédicule des a r c s n e u r a u x qui ¡lorte les apophys e s t r ansve r s e s s'élève pr e sque pe rpendi cul a i r ement .
La vertèbre esî fori mi n c e el ne dépasse pa.s be aucoup, sous ce r appor t , la pr emi è r e dorsale on
même la de rni è r e cervicale.
Le corps de cetle dorsale est, à ])eu |)rès, celui de toute la colonne ve r t ébr a l e , qui est le plus réduit
eu haut eur et en largeui' et c'est en même temps celui qui est le plus l'ortemenl c a r éné . Le di amè t r e
\erlicat correspond au di amè t r e transversal.
Celle c inqui ème dorsale, r ema r q u a b l e par la compression du corps sur les flancs et la saillie qui
en résulte en dessous s u r la ligne médi ane , ne l'est pas moins |iar la larifeiiî' du canal r a chidi en el In
direction du pédicule. L'épipliyse ne r e couvr e ent i è r ement le corps ni en avanl ni eu a r r i è r e chez
les j e u n e s individiis (pl . XIV, lii;. 1 ) ; mais, chez les a d u l t e s , elle le rci'ouvre au ])oinl do faire
saillie (pl. Xl l l , fig. 6, " j e t d ' a u gme n t e r tellement l'épaisseur de la vertôhre qu'on pourrait croire,
à pr emi è r e vue, à une e r r e u r dans son c l a s s emenl ana tomique .
Celle ve r t èbr e (|)1. XIV, fig. 1) porle le n° o 0 2 el a été déterrée, avec plusieurs aut r e s , à hi
nouvelle enceinte, deuxi ème section, front /i-o, fossé c api t a l, partie do Sluyvenbc rg.
La huitième thor a c ique a le di amè t r e anl é ro-pos l é r i eur à |)eu près du double de celui de la s eptième
cervicale. Ce di amè t r e a u gme n l e r égul i è r ement depuis la pr emi è r e dorsale. Le canal rachidien
\)ES liIN'VJRONS D'AINVEUS. (iô
de celle vertèbre esl fori gr and et il a, nu milieu, un peu plus de h a u t e u r (jue de l a rgeur . Le
pédicule de l'arc neural s'élève de bas en haut el de dedans en dehor s el son apophys e Iransversc
prend naissance au-dessus du canal du rachis.
La vertèbre suivante, la neuvième, a son corps de ve r t èbr e plus large, plus haut et |)lus é))ais;'
le canal racbidien égalemonl plus large et plus haut , el le pédicule placé un peu plus en dehor.«
(jue dans la précédente.
C'est dans cetle région de la colonne vorlèbrale que le canal rachidien est le plus large.
Cette ve r t èbr e est figurée pl anche XI I I , figures 6 et 7. L'épiphyse est compl è t ement .soudée.
Elle vient de la deuxièine section, fossé capital, partie du Sl i iyvenbcrg, ent r e les caponnière s 4 - 3 ,
prés d e l à luuolle 1, ve rs la chaussée de Deurne .
Le Musée possède qua t r e autres dorsales, les dixième, onzième, douzième el t r e i z i ème ; on voit
que le corps de ces vertèbre s devient plus volumineux dans tous les s ens pendant que le canal
rachidien se rélrécil.
Le corps de la onzième dorsale s'étend particulièrement en l argeur , pendant (|ue le canal r a c h i -
dien se rélrécil de n o u v e a u ; le pédicule de l a r e neural se porte plus en dehor s et r apoj )hys e
transverse, en pr enan t un développement plus cons idé r abl e , au lieu de se di r ige r de lias eu iiauf el
de dedans en dehors, se dirige de dedans en dehor s en s'élevani irès légèrement depui s la base.
C'est à peine si celle vertèbre est encore carénée à sa face inférieure.
l u e de ces vertèbres, la onzième dorsale, est r epr é s ent é e pl anche XIV, figure lì, el sa coupe
à còlè, figure Les apophys e s Iraiisverses jinrlenl de la partie supé r i eure du corps et se dirigent
borizoutalemenl.
Elle a été déterrée, avec quelques aut r e s vertèbres, sous Sl u y v e n b e r g , à la nouvelle cnceinle
deuxième section, froni i - o , fossé capital. Ces pièces porleiit le n" 5 0 3 au Musée royal.
Coite ve r t èbr e nous suggère quelques rénexioiis : pa rmi les n omb r e u x os s ement s de Buhmula
qui correspoiideni par la taille, nous Irouvons une vertèbre provenant d'un animal be aucou p plus
petit que les autres et qui ne provient cependant pas d'un j e u n e individu. Xous avons déjà l'ait
remarquer, (|ue si, a u j o u r d ' h u i , les a n ima u x d'une même espèce el du même âge al t eigneul , à peu
de diiïérence p r è s , une longueur équivalonie, il n'en est pas ainsi chez les Cétacés fossiles qui
nous occupenl . Sans prés ent e r aucune différence de que lque va l eur , nous voyons des individus
adultes dilî'érer notahlemeul les uns des aut r e s par la taille; il \ a des individus parlailemeni
développés de g r a n d e el de petite taille.
Les ve r l èbr e s de la région lombaire préseiileni les caractères ordinai re s do cetle région.
On a trouve trois lombaires : la p r emi è r e , la seconde el la qua t r i ème a còlè de cinq caudales,
à lu nouvelle cnceinio, deuxi ème section, front 4 - 5 , fossé capi t al, partie du Sl uyvenbe rg, ve r s In
chaussée de Dc u r n e .
Ces vertèbres ont lo corps le plus volumineux de toute In colonne \ci'téhrnle; cha cune d'elles a
sou diamètre anl é r c -pos l é r i eur Irès g r a n d , ainsi (|ue le di amè t r e vertical et t r ansve r s a l, les a p o -
physes !rans\ erses parlent du milieu du corps des vertèbre s el le canal racliidien se rétrécit.
La sixième lombaire est figurée pl anche Xl \ ' , ligures 5 - 6 . La ligure 3 la r epr é s ent e vue
d'avanl en arrièr e pour moni r e r (|ue le corps s'est é t endu dans lous les sens, que son di amè l r e
vortical est i. peu [irès égal à son di amè t r e transversal, que le pédicule s'est c omp l é l eme nl séparé
de la bnse do l'apoiibyse ti'ansversc, que Io canal r a chidi en cons e rve un e l a rgeur qui n'est guè r e
inférieui'c à celle du milieu de In l'égion dor.saIe, enfin que l ' apophys e t ransver se naît p e u ' p r è s
vers le milieu du corps de la ve r t èbr e el qu'elle dépasse, en cons e rvant une l a rgeur à peu près
égale au diamètre anl é ro-pos l é r i eur de In ve r t èbr e , une l ongueur noi abl ement plus g r a n d e que la
largeur du corps ; ces larges apophys e s qui garni s s ent , c omme des ailes de moul in, les flancs de la
vertèbre, s'élargissent encore vers l eur ext r émi t é libre el se r e c o u r b e n t l égè r ement en avant.