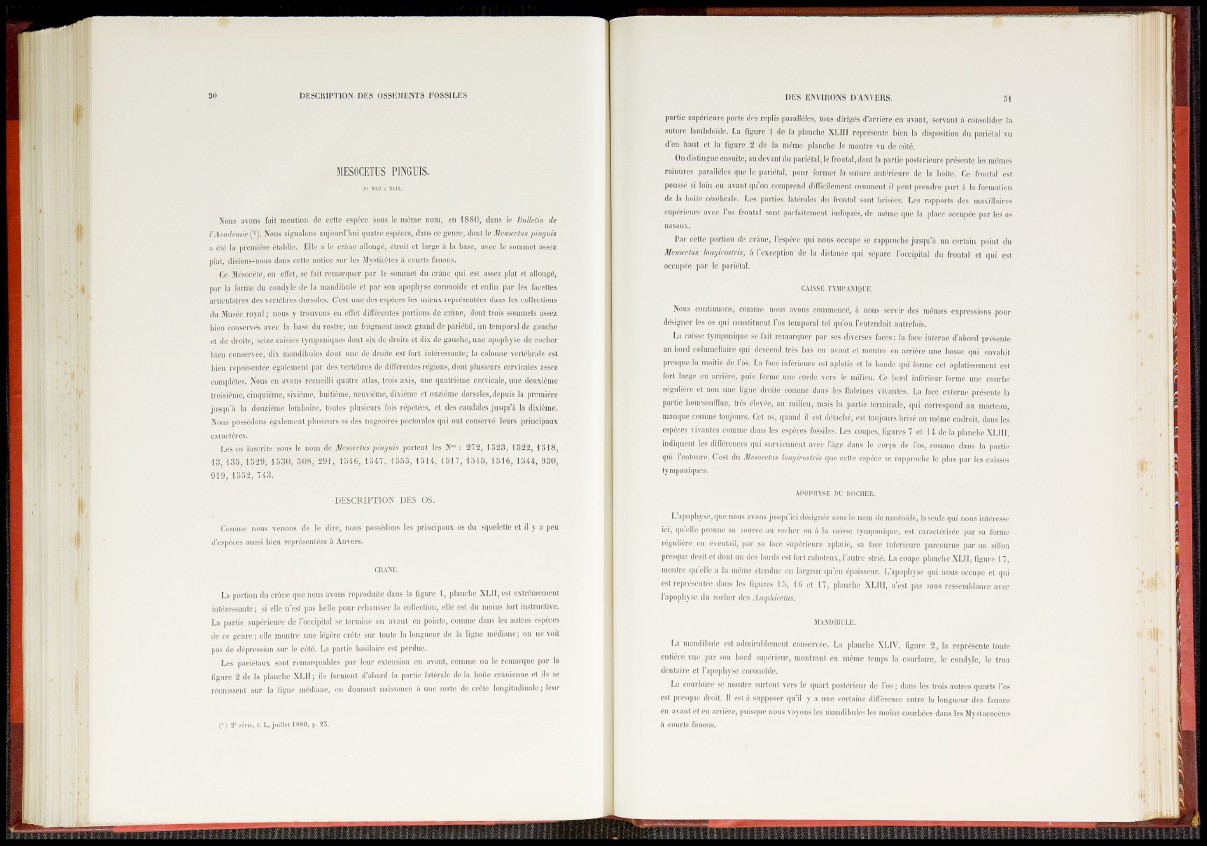
5(1 D E S C R I P T I O N t)F.S O S S I i M l - N T S F O S S I L E S
MESOCETUS PINGUIS.
Mous avons fait ment ion de cetle espèec sous le même nom, en i 8 8 0 , dans le IhiUciin de
l'Académie ( ' ) . N o u s s i gnalons aujourd' lui i quatre espèces, dans ce genre, dont ic IfJcsoceliis piiiguis
a été la première établie. El le a le crùnc al longé, étroit et large à la base, avec le sommet assez
plat, di s i ons -nous dans cette notice sur les Jlys l icùtcs à courts fanons.
Ce .Mésocèle, en elîel, se fail r ema rqu or par le sommet du crâne qui est assez plat et al longé,
par la foi'me du condy le de la mandibul e et par son apophy se coronoïde et enf in par les facettes
articulaires des ver tèbres dorsales. C'est une des espèces les mieu x représentées dans les colleclions
d u Musée r o y a l ; nous y t rouvons en eiïet différentes por t ions de crâne, donl trois sommet s assez
bien conservés avec la base du rostre, un fi'agment assez g r a n d de pariétal, un temporal de gauche
et de droite, seize caisses t ympaniques dont s ix de droite et d i \ de g auche, une apoph y s e de rocher
bien conservée, dix mandibules dont une de droi le esl fort intéressante; la colonne vertébrale est
bien représentée également par des vertèbres de différentes régions , doni plus ieur s cervicales assez
complètes. ¡Sous en a v o n s recueilli quatre atlas, trois axi s , une quat r ième cei'vicale, une deuxième
troisième, cinquième, s ixième, liuitième, neuvième, dixième et onzième dorsales, depui s la premièr e
jusqu'à la douzième lombai re, toutes plus ieur s fois répétées, et des caudales jusqu' à la dixième.
Nous pos sédons également plus ieur s os des nageoi res pectorales qui ont conservé leurs pr inc ipaux
caractères.
Les os inscr i t s sons le n om de iVe.iocetvs phigvis portent ies N " : 2 T 2 , 1 5 2 3 , 1 5 2 2 , i S ' 1 8 ,
13, 1 3 5 , 1 3 2 9 , 1 5 3 0 , 3 0 8 , 2 9 1 , 1 3 4 6 , 1 5 A T , 1 3 5 3 , 1 3 1 4 , 1 3 1 7, 1 3 1 5 , 1 5 1 6 , 1 3 4 4 , 9 3 0 ,
9 Î 9 , 1 3 5 2 , 7 4 3 .
DESCRIPTION DES OS.
Comme nous v e n o n s de le di re, nous pos sédons les pr inc ipaux os du squelette et il y a peu
d'espèces aus s i bien re|)résentées à A n v e r s .
CIlAMi.
L a por t ion du crâne que nous avons reprodui te dans la l igure 1, planche X L I I , est ext rêmement
intéressante; si elle n'est pas belle poin' rnbaus ser la collection, elle est du mo i n s fort instructive.
L a partie supér ieure de rocci|)ital se termine en avant en pointe, c omme dans les autres espèces
de ce g e n r e ; elle mont re une légère crête sur toute la longueur de la l igne médiane; on ne voit
pas de dépres s ion s u r le côté. La partie basilaire est perdue.
Les par iétaux sont remarquables par leur extens ion en avant , c omme on le r ema r q u e par la
figure 2 de la planche X L l l ; ils forment d'abord la partie latérale de la boite crânienne cl ils se
réunissent s u r la l igne médiane, eu donnant nai s sance à une sorte d é c r é t é long i tudinale; leur
(1) 2- série, t. L, juillet 1880, |)-23.
I f s U ^ a H f
D E S E N V I R O N S D A N V E R S . Si
partie supér ieure porte di's repl i s parallèles, tous di r igés d'ar r ière en avant , servant à consol ider la
suture lambdoide. La figure 1 de la planche X L I I I représente bien la di spos i t ion du pariétal vu
d'en haut et la figure 2 de la même planche le mont re vu de côté.
O n di s t ingue ensuite, au devant du pariétal, le frontal, dont la partie pos tér ieure présente les même s
rainures parallèles que le pariétal, pour former la suture antér ieure de la boite. Ce fronlai est
poussé si loin en avant qu'on comprend diflicilement conmient il peut prendre part à la format ion
de la boite cérébrale. L e s parties latérales du frontal sont brisées. L e s rappor t s des max i l lai res
supérieurs avec l'os frontal sont parfaitement indiqués , de même que la place occupée par les os
nasaux.
Par cette por t ion de crâne, l'espèce qui nous occupe se rapproche jusqu' à un certain point du
Mesocelus lotif/iros/ris, à l 'except ion de la distance qui sépare l'occipital du frontal et qui est
occupée par le pariétal.
C.-VISSE TVMt'AXIQCE.
Nous cont inuons , c omme nous avons commencé, à nous ser v i r des mêmes expres s ions pour
désigner les os qui constituent l'os temporal tel q u ' o n l'entendait autrefois.
La caisse t ympan ique se fait rema rquer par ses diver ses faces ; la face in lerne d' abord présente
un bord columel lai re qui descend très ba s en avant et monti'e en ar r ière une bos se qui envahi t
pres(|ue la moitié de l'os. La face inférieure est aplatie et la bande qui forme cet aplatissement est
fort large en arrière, pui s forme une corde ver s le mi l ieu. Ce bord infér ieur ioi'me une courbe
régulière et n o n une l igne droite c omme dans les Baleines vivantes. La face externe présente la
partie bour soudlue, très élevée, au mi l ieu, mai s la partie terminale, qui cor respond au mar teau,
manque c omme toujours. Cet os, q u a n d il est détaché, est toujour s br i sé au même endroi t , dans les
espèces vivantes c omme dans les espèces fossiles. Les coupes, figures 7 et 14 de la planche X L I I I .
indiquent les différences (|ui sur v iennent avec l'âge dans le corps de l'os, c omme da n s la partie
qui l'entoure. C'est du Mesocelus lon^irosùis que cette espèce se rapproche le plus par les caisses
tympaniques.
APOPHYSE t)i: ROCHER.
L'apophyse, que nous avons jusqu' i c i dés ignée sous le n om de mas toïdc, la seule qui nous intéresse
ici, qu'el le prenne sa source nu rocher ou à la caisse tyinpanique, est caractérisée par sa forme
régulière en éventail, par sa face supér ieure aplatie, sa face inférieure par courue par im s i l lon
presque di 'oi tct dont un des boi'ds est fort raboteux, l'autre strié. La coupe planche X L l l , figure 17,
monti'c qu'el le a la même étendue en lai'geui' qu'en épaisseiu'. L ' a p o p h y s e qui n o u s occupe et qui
est représentée dans les l igures 1 3 , Ui et 1 7 , planche X L I I I , n'est pas sans res semblance avec
l'apophyse du roclier îles Anipliicpius.
L a mandibul e esl admi rablement conservée. La planche X L I V , figure 2 , 1 a représente toute
entière v u e par son bord supér ieur , mont rant en même temps la courbure, le condy le, le t rou
dentitii'c et l 'apophy se coronoïde.
L a courbure se nnnitre sur tout ver s le quar t postérieur de l'os ; dans les trois autres quar t s l 'os
est pi'esquc droil. Il e s t a supposer qu' i l y a une certaine diliérence entre la longueur des fanons
en avant et en arrière, pui sque n o u s v o y o n s les mandibules les mo i n s courbées da n s les Jlystacocètes
à cour t s fanons.