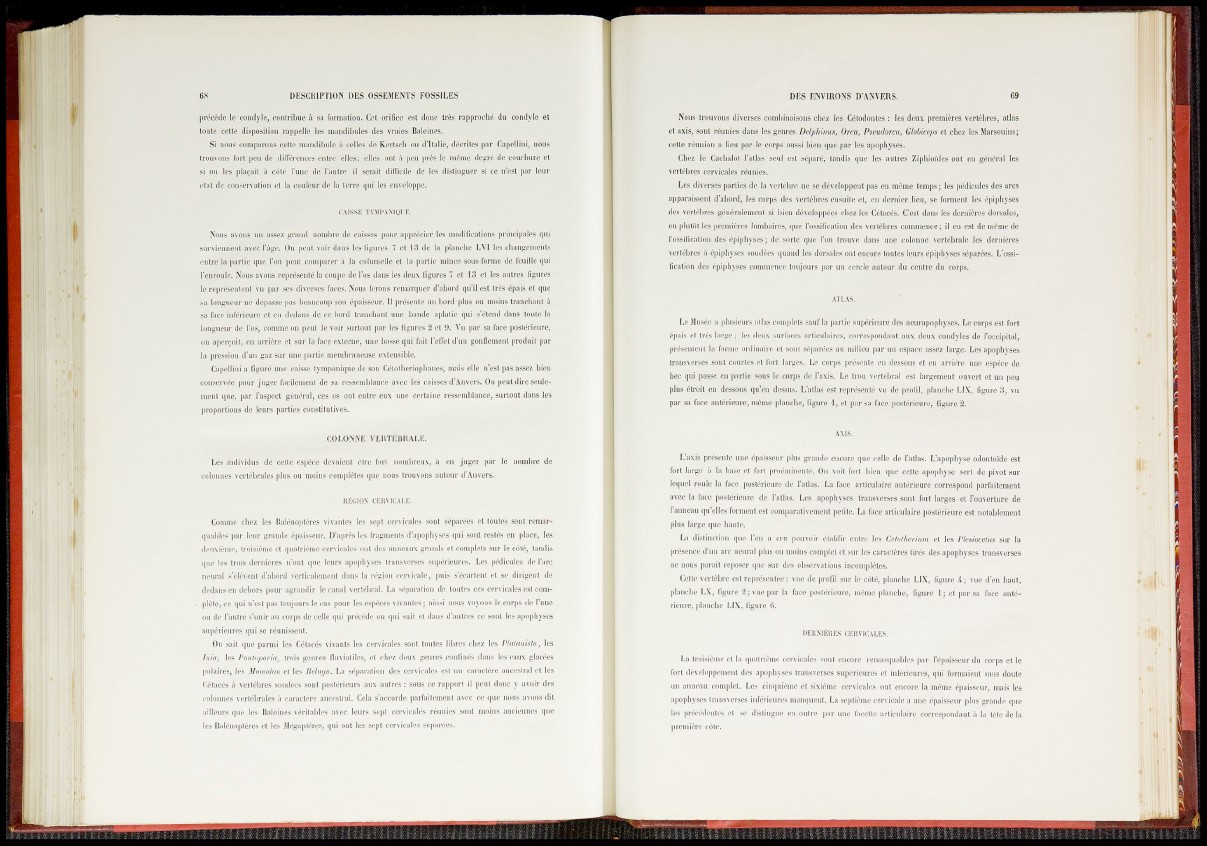
m
«S DBSCHU'TION DES OSSEMENTS FOS S ILES
précède le condyl e , cont r ibue à sa formiilion. Cet orifice esl donc très r approch é du condyl e et
toute cette disposition r appe l l e les mandi bul e s des vraies Baleines.
Si rions compa rons celte maïKlibule à celles do Kerlsch ou d'Italie, décriles par Capellini, nous
trouvons fort peu do dilTéreiiees ent r e elles; elles ont è peu près le même deiiré de c o u r b u r e et
si on les plaçait ù côté Tune de l'aiilre il serait diflicilc de les distinguer si ce iiV.st par leur
óiat de conserva lion et la couleur de la i e r r e cpii les enveloppe.
CAISSE TYMÌ'AMUH'F:.
Nous avons un assez g r a n d n omb r e de caisse.s pour appr é c i e r les modifications principales qui
siirvieiment avec l'âge. Ou peut voir dans les figures 7 et 13 de la pl anche LVl les c b a n g eme n i s
entre la paUie (¡ue l'on |)cul c omp a r e r la columelle cl la partie minc e sous forme de feuille qui
l'enroule. Nous avons r epr é s ent é la coupe de l'os dans les deux ligures 7 et 13 et les autres ligures
le l'opi'ésenient vu jiar ses diverses faces. . \ous ferons l'oniai'quer d'aboi'd qu'il est Irès épais et que
sa longueur ne dé|)asse pas be aucoup son épa i s s eur . Il présente nu bord plus ou moins t r anchant à
sa face inf é r i eur e et eu dedans de ce boi'd ti'ancbant une i)ande aplatie qui s'étend dans toute la
longueur de Tos, c omme on peut le voir sur tout par les f igur e s 2 et 9. Vu par sa face posle>icure,
on apei'ooit, eu a r r i é r e et s u r la face ext e rne , une bosse qui fait l'eliet d'un gonf l ement produit par
la pression d' an gaz sur une partie membi ' aneus e extensible.
Capellini a figuré un e caisse t ymp a n i q u e de son Cétothei'iophanes, mais elle n'est pas assez bien
conservée pour j u g e r facilement de sa r e s s embl anc e ave c les caisses d'Anvers. On peut di r e seulement
que, |)ar l'aspect géné r a l , ces os ont enti'c eux une certaine r e s s embl anc e , sur tout dans les
propoi'tions de leurs partie s constitutives .
COLOxNiMC \ " E i r r É B nAL E .
Les individus do celle espèce devaient être fori n omb r e u x , à en j u g e r par le n omb r e de
colonnes ve r t ébr a l e s plus ou moins complètes que nous t rouvons autour d'Anve r s .
HEGION CEHVIC.VLi:.
Conime chez les na l énopt è r es viviintes les sept cervicales sont séparées et (outes sont r ema r -
quables |)ai' leur g r a n d e é|)a!6seur. D' apr ès les f r agmeni s d' apophys e s qui sont restés en [ilace, les
deiixièini-, ti'oisiéine et qua t r i ème cervicales ont des a n n e a u x g r a n d s et complels sur le côté, tandis
(pie les trois de rni è r e s n'ont que leurs apophys e s transverses supé r i eur e s . Les pédicules de l'arc
neural s'élèvent d'ahoi'd ve r t i c a l ement dans la l'égioii c e rvi c a l e , puis s'écai'ient et se. dirigent de
dedans en dehor s |)oui' agr andi r le canal vertébral. La séparalion de (outes ces cervicales esl c omplète,
ce qui n'e.«t pas toujour s le cas pour les espèces vivanles ; ainsi nous voyons le cor|)s de l'une
ou de l'autre s 'uni r au corjis de celle qui précède ou (¡ui suit et dans d' aul r e s ce sont les a)>o|)byses
supérieures qui se réunissent.
On sait (|uo pa rmi les Cétacés vivants les cervicales sont toutes libres chez les l'Iaianisiu, les
hiia, les l'onhiporia, trois g e n r e s fluvialiles, et chez deux g e n r e s conl lné s d a n s les eaux glacées
polaii'os, les Momdon et les Beluga. La séparation des cervicales est un cai'actère ancesiral et les
Célacés à ve r l éhr e s soudées sont posIérieui'S aux a u t r e s : sous ce rapjiort il peut donc y avoir des
colonnes ve r t ébr a l e s à c a r a c t è r e ancestral. Cela s'accorde pa r f a i t ement avec ce (|ue nous avons dit
iiilleurs que les Baleines véritables ave c l eur s sept cervicales l'éunies sont moins anc i enne s (|ue
les Balénoptères et les Mégaptères, qui ont les s ept cervicales séparée.s.
DES ENVIRONS D'ANVERS. 6 9
Nous t rouvons diverses combina i sons chez les Cétodontes : les deux premi ères vertèbres, atlas
et axis, sont r éuni e s d a n s les genr e s Delphimis, Orca, Pscudorcu, Globiceps et chez les Marsouins ;
cette réunion a lieu par le corps aussi bien que par les apophys e s .
Chez le Caclialol l'allas seul est séparé, tandis que les aut r e s Zipliioïdes ont en général les
vertèbres cervicales réunies.
Les diverses parties de la ve r t èbr e ne se déve loppent pas en même t emp s ; les pédicules des arc s
apparaissent d' abord, les corps des ve r t èbr e s ensui t e et, en de rni e r lieu, se forment les epiphys es
des vertè!)rcs g é n é r a l eme n t si bien développées chez les Cétacés. C'est dans les de rni è r e s dorsales,
ou jihitot les premi ères lombaires, que l'ossilicalion des ve r t èbr e s c omme n c e ; il en est de même de
rossilication des é p i p b y s e s ; de sorte que l'on trouve dans un e colonne ve r t ébr a l e les dernière s
vertèbres à épiphys es soudées quand les dorsales ont encore toutes leurs épipbys e s séparées. L'ossification
des épipbys e s c omme n c e toujour s par un cercle autour du c e n t r e du corps.
Le Musée a plusieurs allas complels sauf la pariie supé r i eur e des n e u r a p o p h y s e s . Le corps est fort
épais et Irès l a r g e : les d e u \ surfaces arliculaii'es, cor r e spondan t aux deux condyl e s de l'occipital,
prose m en I la foj'nie oi'dinairo et soni s épa r é e s au milieu par un espace assez large. Les apophys e s
transverses sont cour t es et fort larges. Le corps [irèsente en dessous et en a r r i è r e une espèce de
bec (¡ui passe en partie sous le corps de l'axis. Le trou vertébi'al est l a r g eme n t ouve r t et un pe u
plus étroit en dessous qu'en dessus. L'allas est veprésenlé vu de prolil, pl anche LIX, ligure 3, vu
par sa face antérieui'C, même pl anche , figure 1, et par sa face postérieure , figured.
L'axis pr é s ent e un e épaisseur plus g r a n d e encor e qu e celle de l'atlas. L' a p o p h y s e odontoïde est
fort large à la base et foit proéminente. On %oit fort bien que cette apoi)hyse sert de pivot sur
lequel roule la face postérieure de l'atlas. La face ar t i cul ai r e a n t é r i e u r e cor r e spond pa r f a i t ement
avec la face postérieure de l'atlas. Les apophys e s t r ansve r s e s sont fori larges et l 'ouve r tur e de
l'anneau qu'elles forment est c omp a r a t i v eme n t pelile. La face ar t i cul ai r e pos t é r i eur e est not abl ement
plus large que baule.
La distincliou (¡ue l'on a crn [iouvoir établir ent r e les CcMhemim et les l'Iesioceliis sur la
présence d'un arc neui'al plus ou moins conqilet et sur les c a r a c t è r es tirés des a p o p h y s e s
ne nous parait reposer que s u r des obs e rva t ions incomplètes.
Celte veiièbi'o est r epr é s ent é e : vue de prolil sur le còlè, pl anche LIX, ligure 4; vue d'en haut
planche LX, ligure 2 ; vue par la face postérieure, même pl anche , ligure I ; et par sa face a
rieure, pl anche LIX, figure (i.
DI'liMÈliES CEtiVICALES.
La troisième et h (]ualriêine cervicales soni encor e l'emariiuables par l'épaisseur du corps et le
fori dévoloppemenl des apophys e s Iransverses supé r i eur e s et inféi'ieures, (¡ui forma i ent sans doute
un anne au compiei. Les cinqui ème et s ixi ème cervicales onl encor e la même épaisseur, ma i s les
apophyses Iransverses inférieures nuin([uent. La se|)lièine cervicale a une épaisseur plus g r a n d e que
les i)récê(lentcs et se distingue en outi'o par une facelle ar l i cul ai r e cor r e spondan t à la tète de la
l'emière còte.