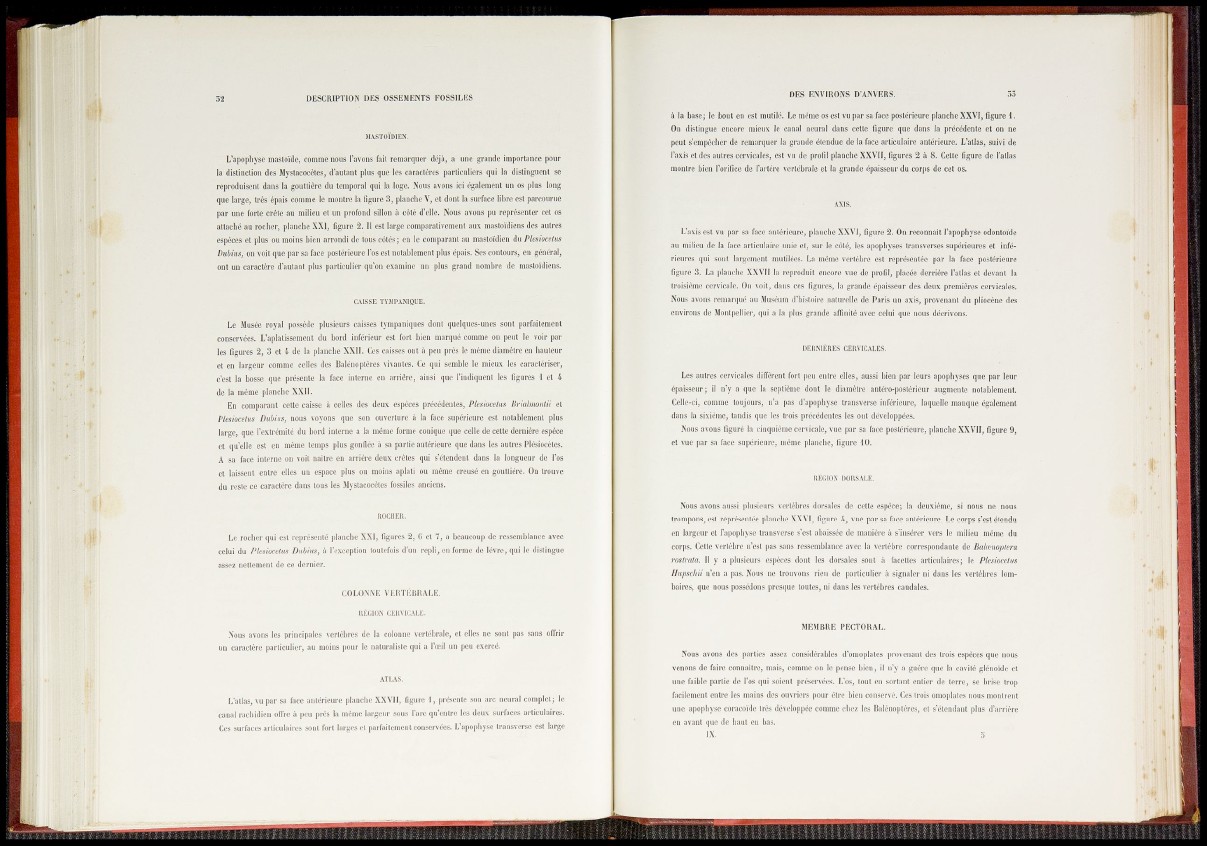
32 DESCRIPTION DES OSSEMENTS FOSSILES
L'apopliyse masioïde, comme nous r avoûs fait r ema r q u e r déjù, a une gi-iiiidc impor t ance pour
la distinction des Mystacocètes, d' aut ant plus que les caraclères parliciilicrs qui la dislingucnl se
reproduisent dans la gouttière du temporal qui la-loge. Nous avons ici éga l ement un os plus long
que large, très épais c omme le mont r e la ligure 3, planche V, et dont la surface libre est pa r courue
par une forte crcte au milieu et un profond sillon à côté d'elle. Nous avons pu r epr é s ent e r cet os
attaché au r o c h e r , pl anche XXl , figure 2. Il est large compa r a t ivement aux mastoïdiens des autres
espèces et plus ou moins bien arrondi do tous côt é s ; en le compa r ant au mastoïdien du Plesiocctus
IhibiuB, on voit qu e par sa face poslorieure l'os est notablement plus épais. Ses contours, en général,
ont un caractère d'autant plus particulier qu'on examine uu plus grand nombr e de mastoïdiens.
CAISSE TY.MPANIQLE.
Le Musée royal possède plusieurs caisses tympanique s dont (juelques-unes sont parfaitement
conservées. L'aplatissement du bord inf é r i eur est fort bien ma rqué comme on peut le voir par
les figures 2, 3 et 4 de la p l a n c h e XXl l . Ces caisses ont à peu prés le même di amè t r e en haut eur
et en l a rgeur c omme celles des Ba l énopt è r e s v i \ a n t e s . Ce qui semble le mieux les caractériser,
c'est la bosse que présente la face int e rne en a r r i è r e , ainsi que l'indiquenl les figures I et i
de la même pl anche XXl l .
En c omp a r a n t cette caisse à celles des deux espèces précédentes, Plesioceliis Uriulmontii et
Plesiocetus Dubius, nous voyons que son ouverture à la face supé r i eure est notahlemenl plus
large, que l ' ext r émi té du bord int e rne a la même forme conique que celle de cette dernière espèce
et qu'elle est en même t emp s plus gonllèe à sa partie ant é r i eur e que d a n s les autres Plésiocètes.
A sa face interne on voit naître en aixière deux crêtes qui s'étendent d a n s la longueur de l'os
et laissent ent r e elles uu espace plus ou moins aplati ou mémo creusé en gouttière. On trouve
du reste ce caractère dans tous les Mystacocètes fossiles anciens.
Le roche r qui est r epr é s ent é pl anche XXI , figures 2, C et 7, a beaucoup de r e s s embl anc e avec
celui du Plesiocetuit Diiblus, à l'exception toutefois d'uti r epl i , eu forme de lèvre, qui le distingue
assez ne t t ement de ce de rni e r .
COLO-NiNE VhKTEIiR/VLE.
IlECIOX CEItVICALE.
.Nous avons les principales vertèbre s de la colonne ve r t ébr a l e , et elles ne sont pas s ans offrir
uu caractère particulier, au moins pour le naturaliste qui a l'oeil un peu exercé.
L'atlas, vu par sa face antérieuj'e pl anche XXVI I , figure 1, présente son a r c neural c omp l e t ; le
canal raciiidien olire à peu près la même largeur sous l'arc ((ifentro les deux surfaces articulaires.
Ces surfaces articulaires sont fort larges et pa r f a i t ement conservées. L'apo[)liyse t r ansve r s e est large
DES ENVIRONS D'ANVERS. 53
à la base; le bout en est mutilé. Le même os est vu par sa face postérieure pl anche XXVI , figure 1.
On distingue encore mi eux le canal neural dans cette figure que dans la pr é c édent e et on ne
peut s'cmpêchcr de r ema rque i' la gr ande é t endue de la face articulaire ant é r i eur e . L'atlas, suivi de
l'axis et des autres cervicales, est vu de profil pl anche XXVI I , figures 2 à 8. Cette figure de l'atlas
montre bien l'orifice de l'artère vertébrale et la g r a n d e épaisseur du corps de cet os.
L'axis est vu par sa face antérieui'e, pl anche X.WI , ligure 2. On reconnaît l ' apophys e odontoide
au milieu de la face articulaire unie el, sur le côté, les apophys e s transverses supé r i eur e s et inférieures
qui sont largement mutilées. La même ve r t èbr e est r epr é s ent é e par la face pos t é r i eure
figure 3. La planche XXVII la reproduit encore vue de profil, placée de r r i è r e l'atlas el devant la
troisième cervicale. Ou voit, dans ces figures, la g r a n d e épaisseur des deux premi ères cervicales.
Nous avons r ema r q u é au .Muséum d'hisloirc naturelle de Paris un axis, provenant du pliocène des
environs de Montpellier, qui a la plus g r a n d e alfiiiité avec celui que nous décrivons.
DEHNIÈRES CERVtCALES.
Les autres cervicales diffèrent fort peu ent r e elles, aussi bien par leurs apophys e s que p a r leur
épaisseur; il n'y a que la septième dont le diamètre antéro-postéricur augment e not abl ement.
Celle-ci, c omme toujours, n'a pas d' apophys e t ransver s e inf é r i eur e, laquelle ma n q u e éga l ement
dans la sixième, taudis (¡ue les trois précédentes les ont développées.
Nous avons figuré la ciiupiième cervicale, vue par sa face postérieure, pl anche XXVII, figure 9,
et vue par sa face supé r i eur e , même pl anche, figure iO.
RÉGION DORSALE.
Nous avons aussi plusieurs vertèbres dorsales de cette e spè c e ; la deuxi ème , si nous ne nous
trompons, est représentée pl anche XXVI , figure 4, vue par sa face ant é r i eur e . Le corps s'est éiendu
en largeur et l'apophyse transverse s'est abaissée de mani è re à s'insérer vers le milieu môme du
corps. Celte vertèbre n'esl pas sans res s embl anc e avec la ve r t èbr e cor r e spondant e de BaUvnopicra
roslrala. Il y a plusieurs espèces dont les dorsales sont à facettes a r t i cul a i r e s ; le Plesiocctus
Hupschu n'en a pas. Nous ne t rouvons rien de particulier à signaloi' ni dans les ve r t èbr e s lombaires,
que nous possédons pr e sque toutes, ni dans les vertèbre s caudales.
MEMBRE PECTORAL.
Nous avons des parties assez considérables d'omoplates provenant des trois espèces que nous
venons de faire connaître, mais, comme on le pcjise bi en, il n'y a guè r e que la cavité glénoïde et
une faible partie de l'os qui soient préservées. L'os, tout en sortant entier de t e r r e , se brise trop
facilement ent r e les mains des ouvriers pour être bien conservé, (les trois omoplates nous mo n t i e n t
une apophys e coracoïde très développée comme chez les Balénoptères, et s ' é t endant plus d' a r r i è r e
en avant que de haut en bas.
IX. 3