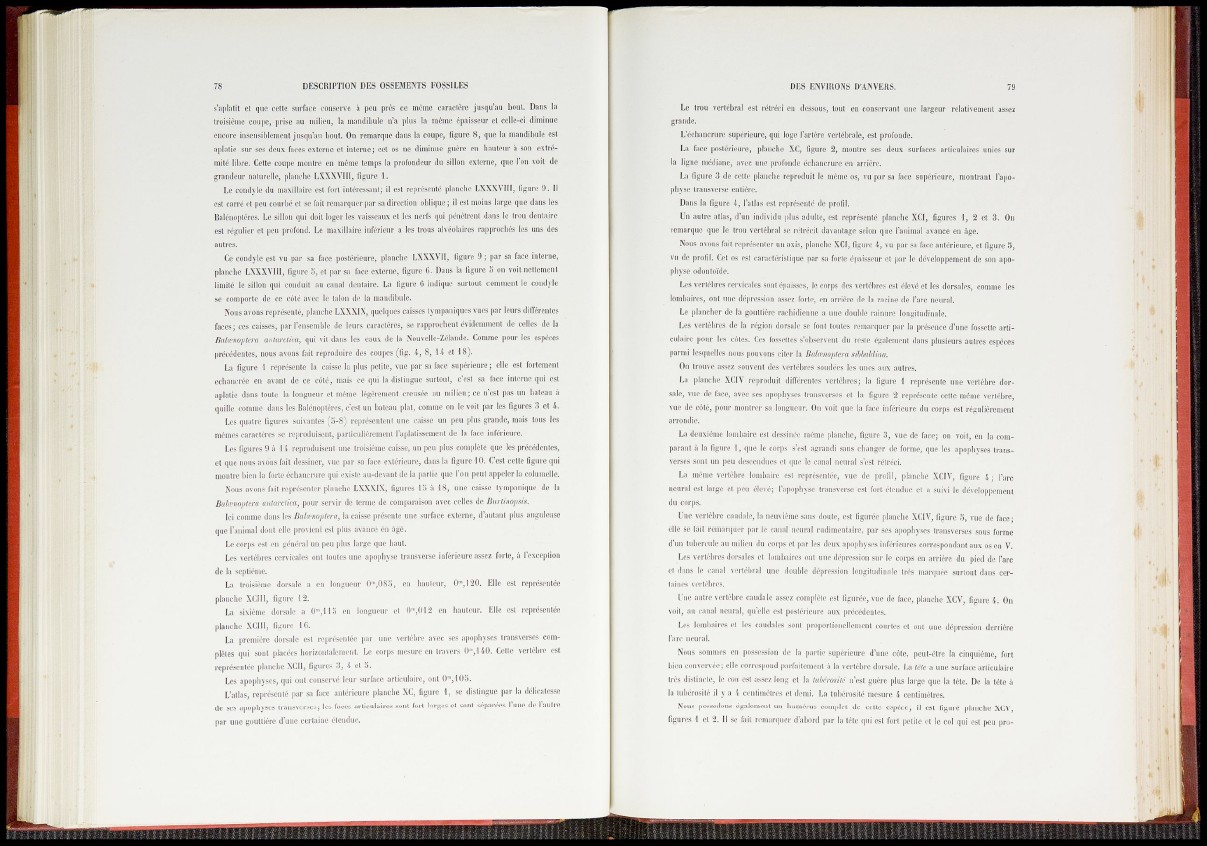
78 D E S C R I P T I O N D E S O S S E M E N T S F O S S I L E S
s'aplntit et que celle surface conserve à peu près ce même earaclère j u s q u ' a u boul. D a n s la
troisième coupe, pr i se au mi l ieu, la mandibule n'a plus la même épai s seur el celle-ci dimi n ue
encore insens iblement jusqu' au bout . On remarque dans la coupe, l igure 8, que la mandibule est
aplatie sur ses deux faces externe et interne; cet os ne dimi n ue guère en luni leur à son extrémité
libre. Cette coupe mont re en même temps la profondeur du sillon externe, que l'on voit de
grandeur naturelle, planche L X X X V I I I , l i gure 1.
L e condyle du maxi l lai re est fort intéressant; il est reprcsenlé planche L X X W I I I , figure 9. Il
est carré et peu courbé et se l'ait remarquer par sa direction obl ique ; il est mo i ns large que dans les
Balénoptères. Le sillon qui doit loger les vai s seaux et les nerfs (|ai pcnètrenl dans le trou dentaire
est régul ier et peu profond. Le maxi l lai re inférieur a les trous alvéolaires rapprochés les uns des
autres.
Ce condy le est vu par sa face postérieure, planche L X X X V l l , l igure 9 ; par sa face interne,
planche L X X X V I I I , (ignrc o, et par sa face externe, figure 6. D a n s la l igure Ö on voit nettement
limité le sillon qui condui t au canal dentaire. La (igure 0 indique surtout c omme n t le condyl e
se compor te de ce côté avec le talon de la mandibule.
Nous avons représenté, planche L X X X I X , quelques caisses t ympaniquc s vues par leurs dilTércntes
faces; CCS caisses, par l 'ensemble de leur s caractères, se rapprochent évidemment de celles de la
Bala'iio / Jtem anlarclica, qui vil dans les eaux de la Nouvel le-Zélani le. Comme pour les espèces
précédentes, nous avons fait reprodui re des coupes ( i lg. 8, et 18) .
L a f igure 1 représente la caisse la plus petite, vue par sa face supér ieure; elle est fortement
echancrée en avant de ce côté, mai s ce qui la di s t ingue surtout, c'est sa face interne qni est
aplatie dans toute la longueur et même légèrement creusée au mi l ieu; ce n'est pas un bateau à
quille comme dans les Balénoptères, c'est un bateau plat, comme on le voit par les figures 3 et 4.
Les quatre f iguies suivantes ( 3 - 8 ) représentent une caisse un peu plus grande, mai s tous les
mornes caractères se reprodui sent , particulièrement l 'aplat i s semenl de la face inférieure.
Les figures 9 à 14 reprodui sent une troisième caisse, un peu plus comi)!èle que les précédentes,
et que nous a \ o n s fait des s iner, vue par sa face extérieure, dans la figure 10. C'est cette figure qui
montre bien la forte échanc rure qui existe au-devant de la partie que l ' o n peut appeler la coluuielle.
Nous avons fait représenter planche L X X X I X , figures 15 à 18, u n e caisse t ympaniquo de la
Buloenoptera unlarct k a, pour servi r de terme de comparai son avec colles de Ihirlinojms.
Ici c omme dans les Bulwnoptera, la caisse présente une surface externe, d'au la ni plus anguleus e
que l 'animal dont elle provient est plus avancé en âge.
L e corps est en général un peu plus large que haut.
Les vertèbres cervicales ont toutes une apoi )hyse transverse inférieure assez foi'te, à l'exception
de la septième.
L a troisième dor sale a en longueur 0 " ' , 0 8 o , eu bauicui
planche X C I I I , figure 12.
L a s ixième dor sale a O - ^ J H d en longueur et 0 " ' , 0 1 2 c
planche X C I I l , figure K i .
0 " > , I 2 0 . El le est représentée
hauteur. Elle est renrésentéo
L a première dorsale est représentée par une \ertèi)rc avec ses
plèles qui so ni placées horizontal eine ri t. Le corps mesur e
représentée planche X C I l , l igures 3, 4 et 5.
|)hyses t ransver ses c omtravers
0" ' ,1 4 0 . Cotte vertèbre est
Les apophy ses , qui ont conservé leur surface artii^uiaire, ont Ü" ' , 1Ü5 .
L'atlas, reiircsenté par sa face antéricui'c idanclie X C , l igure 1, se di s t ingue par la délicatesse
de ses apophy ses t ransver ses ; les faces ar t iculai res sont fort larges el sont séparées l'une de l'autre
par uue gouttière d'une certaine étendue.
D E S E N V I R O N S D ' A N V E R S .
L e trou vertébral est rétréci en des sous , tout en conservant une largeur relativement assez
grande.
L'échancrure supér ieure, qui loge Tarière vertébrale, est profonde.
L a face postérieure, planche X C , figure 2, mont re ses deux surfaces articulaires unies sur
la ligne médiane, avec une profonde échancrure en ari'ièrc.
L a figure 3 de cette planche reproduit le même os, vu par sa face supér ieure, mont rant l 'apophyse
transverse entière.
Daus la figure h-, l'atlas est représenté de profil.
U n autre atlas, d' u n iml ividu |)lus adulte, est représenté planche X C l , figures 1, 2 et 3. On
remarque que le trou vertébral se rétrécit davantage selon que ¡'animal avance en âge.
Nous avons fait roprésenler un axi s , planche X C l , figure vu par sa face antérieure, et figure 5,
vu de profil. Cet os est caractérislique par sa forte épaisseur et [)ar le développement de son apophyse
odontoïde.
Les vertèbres cervicales sont épaisses, le corps des vertèbres est élevé et les dor sales , c omme les
lombaires, ont une dépres s ion assez forte, en arrière de la racine de l'arc neural .
Le plancher de la goiiltière rachidienne a une doui)le rainure longi tudinale.
Les vertèbres de la région dorsale se l'ont toutes remarquer par la présence d'une fossette articulaire
pour les cotes. Ces fossetlcs s 'observent du roste également dans ])lusieurs autres espèces
parmi lesquelles nous pouvons citer la Duloenoptera sib baliUna.
O n trouve assez souvent des ver tèbres soudées les unes aux autres.
L a planche X C I V reprodui t difi'érentes ver tèbres ; la figure 1 représente une vertèbre dor -
sale, vue de face, avec ses apophy ses I ransver ses el la figure 2 représente cette même verlèi>re,
vue de coté, pour mont rer sa longueur . Ou voit que la face inférieure du corps est régul ièrement
arrondie.
L a deuxième lombai re est dessinée même planche, figure 3, vue de face; on voit, en la c omparant
à la figure ' I , que le corps s'est ag randi sans changer de forme, que les apophy ses t rans -
vcrses sont un peu tiesccndues et que le canal neui^al s'est rétréci.
L a même vertèbre lombai re est représenlée, vue de prof i l , [)Ianche X C I V , figure ('„rc
neural est large et peu élevé; l 'apophy se t ransver se est fort étendue et a suivi le développement
du corps .
Une verlèbre caudale, la neuv ième sans doute, est figurée planche X C I V , figure 5, vue de face;
elle se fait r ema n i u c r p a r l e canal neural rudimentai re, par ses apophy ses I ransver ses sous forme
d'un tubercule au mi l ieu du corps et par les deux apophy ses inférieures cor respondant a u x os en V.
Les vertèbres doi'sales et lombai res ont une dépres s ion sur le corps en ar r ière du pied de l'arc
cl dans le canal vertébral une double dépres s ion longi ludinale Irès marquée surtout dans cer -
taines vertèbres.
Une autre verlèbre caudale assez complète est figurée, vue de face, planche X C V , figure 4. On
voit, au canal neural , qu'elle est postérieure aux préccdeules.
Les lombai res et les caudales sont piopor l ionel lement courtes et ont une dépres s ion derrière
l'arc neural.
Ninis s omme s
bien conver véo; i
très distincte, le
la tubérosité il \
Nous possodoi
en possession de la partie supér ieure d'un e côte, peut-être la cinquième, fort
Ilo cor respond parfaileraent à la vertèbre dorsale. La tète a une surface articulaire
•Oft est assez long cl la (ubérosiié n'est guère plus large (|uc la tête. De la tête à
I .'(• centimètres et demi . La tul)érosilé mesure 4 centimètres,
s également un l iuméi 'us compiei de cette espèce; il est figuré planche X C V ,
figures Ì cl 2. Il se l'ail remarquer d'abord par la tète qui est fori pelile et le col qui est l>cu pro