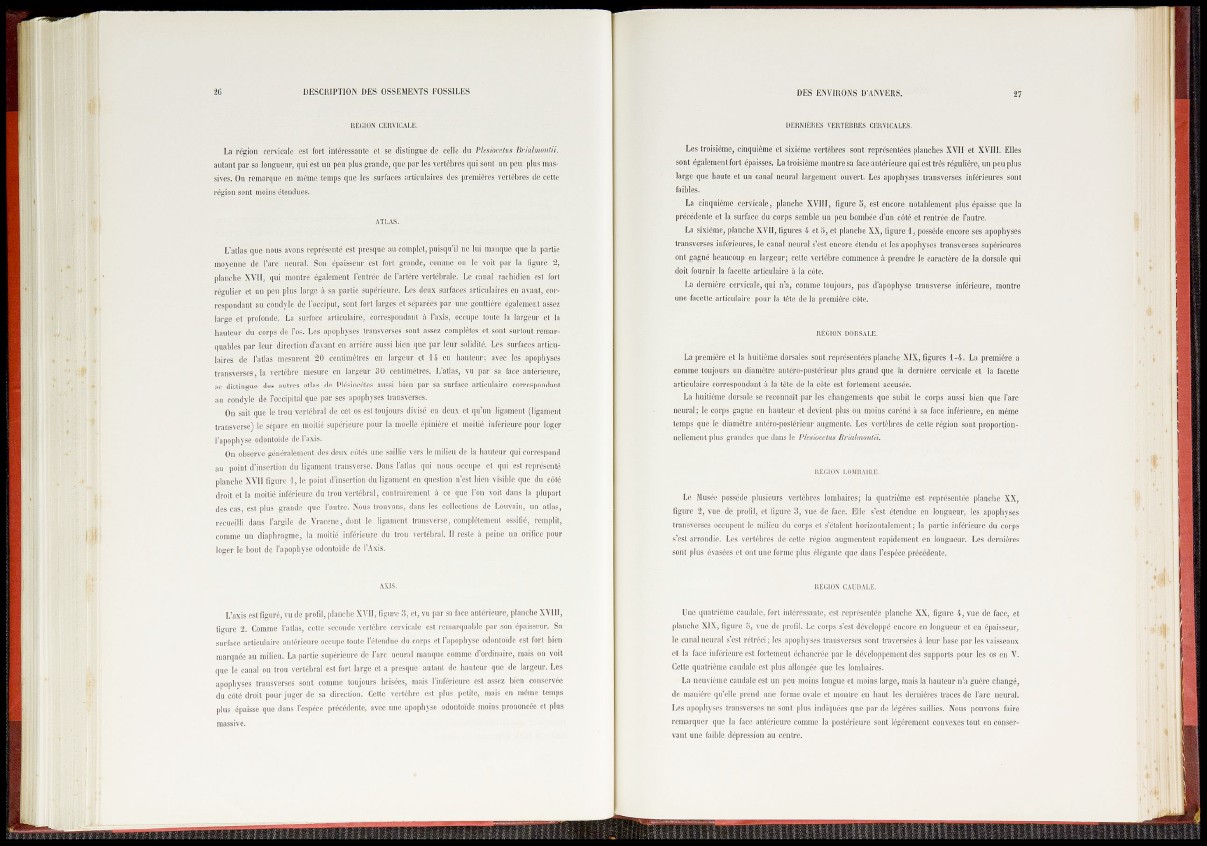
•ìli DESCRIPTION DE S OSSEMEiNTS FOS S I LES
REGION CERVICALE.
La région cervicale est fort intéressante et se distingue de celle du Plesiocetna Urialinonîii,
aiitiint par sa longueur, qui est un peu plus grande, que par les vertèbres qui sont un peu plus massives.
On remarque en même temps que les SOTÎaces articulaires des premières vertèbres de cette
région sont moins étendues.
L'atlas que nous avons représenté est presque au complet, puisqu'il ne lui manque que la partie
moyenne de l'arc neural. Son épaisseur est (ort grande, comme on le voit par la ligure 2,
planche XVI I , qui montre également l'entrée de lartère vertébrale. Le canal rachidien est l'oia
régulier et un peu plus large à sa partie supérieure. Les deux surfaces articulaires e» avant, corl'cspondaiit
au condyle de l'occiput, sont fort larges et séparées par uiie gouttière également assez
larae et profonde. La surface articulaire, correspondant à l'axis, occupe toute la largeur et la
hauteur du corps de l'os. Les apophyses transverses sont assez complètes et sont surtout remarquables
par leur direction d'avant en arrière aussi bien que par leur solidité. Les surfaces articulaires
de l'atlas mesurent 20 centimètres en largeur et 14 en hauteur; avec les apophyses
transverses, la vertèbre mesure en largeur 30 centimètres. L'atlas, vu par sa face antérieure,
se distingue des autres atlas de l'iésiocètes aussi bien par sa surface articulaire correspondant
au condyle de l'occipital que par ses apophyses transverses.
On sait que le trou vertébral de cet os est toujours divisé en deux et qu'un ligament (ligament
transverse) le sépare en moitié supérieure pour la moelle épinière et moitié inférieure pour loger
l'apophyse odontoïde de Taxis.
On observe généralement des deux cotés une saillie vers le milieu de la hauteur qui correspond
au point d'insertion du ligament transverse. Dans l'atlas qui nous occupe et qui est représenté
planche X V I I figure le point d'insertion du ligament en question n'est bien visible que du colé
droit et la moitié inférieure du trou vertébral, contrairejnent à ce que l'on voit dans la plupart
des cas, est plus grande que l'autre. Nous trouvons, dans les collections de Louvain, un allas,
recueilli dans l'argile de Vracene, dont ie iigament transverse, complètement ossifié, remplit,
comme un diaphragme, la moitié inférieure du trou vertébral. Il reste à peine un orifice pour
loger le bout de l'apophyse odontoïde de l'Axis.
L'axis est figuré, vu de profil, planche XVI I , figure 3, et, vu par sa face antérieure, planche XVI I I ,
figure 2. Comme l'atlas, cette seconde vertèbre cervicale est remarquable par son épaisseur. Sa
surface articulaire antérieure occupe toute l'étendue du corps et l'apophyse odontoïde est fort bien
marquée au milieu. La partie supérieure de l'arc neural manque comme d'ordinaire, mais on voit
que le canal ou trou vertébral est fort large et a presque autant de hauteur que de largeur. Les
apophyses transverses sont comme toujours brisées, mais l'inférieure est assez bien conservée
du côté droit pour juger de sa direction. Cette vertèbre est plus petite, mais en même temps
plus épaisse que dans l'espèce précédente, avec une apophyse odontoïde moins prononcée et plus
massive.
DES EiNVIUONS D' ANV ERS . 27
DERNIÈRES VERTÈBRES CERVICALES.
Les troisième, cinquième et sixième vertèbres sont représentées planches X V I I et X V H I . Elles
sont également fort épaisses. La troisième montre sa face antérieure qui est très régulière, ini peu plus
large que haute et un canal neural largement ouvert. Les apophyses transverses inférieures sont
faibles.
La cinquième cervicale, planche X V I I I , figure 3, est encore notablement plus épaisse que la
précédente et la surface du corps semble un peu bombée d'un côté et rentrée de l'autre.
La sixième, planche XVI I , figures 4 et S, et planche X X , figure d, possède encore ses apophyses
transverses inférieures, le canal neural s'est encore étendu et les apophyses transverses supérieures
ont gagné beaucoup en largeur; cette vertèbre commence à prendre le caractère de la dorsale qui
doit fournir la facette articulaire à la côte.
La dernière cervicale, qui n'a, comme toujours, pas d'apophyse transverse inférieure, montre
une facette articulaire pour la tôle de la première côte.
RÉGION DORSALE.
La première et la huitième dorsales sont représentées planche X I X , figures 1 - 4 . La première a
comme toujours un diamètre antéro-postérieur plus grand que la dernière cervicale et la facette
articulaire correspondant à la tète de la còte est fortement accusée.
La huitième dorsale se reconnaît par les changements que subit le corps aussi bien que l'arc
neural; le corps gagne en hauteur et devient plus ou moins caréné à sa face inférieure, en même
temps que le diamètre antéro-postérieur augmente. Les vertèbres de celte région sont proporlionnellement
plus grandes que dans le Plesiucelus Brialmonlii.
REGION LO.MBAIRE.
Le Musée possède plusieurs vertèbres lombaires; la quatrième est représentée planche X X ,
figure 2, vue de profil, et figure 3, vue de face. Elle s'est étendue en longueur, les apophyses
transverses occupent le milieu du corps et s'étalent horizontalement; la partie inférieure du corps
s'est arrondie. Les vertèbres de celte région augmentent rapidement en longueur. Les dernières
sont plus évasées et ont une forme plus élégante que dans l'espèce précédente.
REGION CAUDALE.
Une quatrième caudale, fort intéressante, est représentée planche X X , figure 4, vue de face, et
pianelle X I X , figure 5, vue de profil. Le corps s'est développé encore en longueur et en épaisseur,
le canal neunil s'est rétréci; les apophyses transverses sont traversées à leur base par les vaisseaux
c l la face inférieure est fortement échancrée par le développement des supports pour les os en V.
Cette quatrième caudale est plus allongée que les lombaires.
La neuvième caudale est un peu moins longue et moins large, mais la hauteur n'a guère changé,
de manière qu'elle prend une forme ovale et montre en haut les dernières traces de l'arc neural.
Les apophyses transverses ne sont plus indiquées que par de légères saillies. Nous pouvons faire
remarquer que la face antérieure comme la postérieure sont légèrement convexes tout en conservant
une faible dépression au centre.
M m i