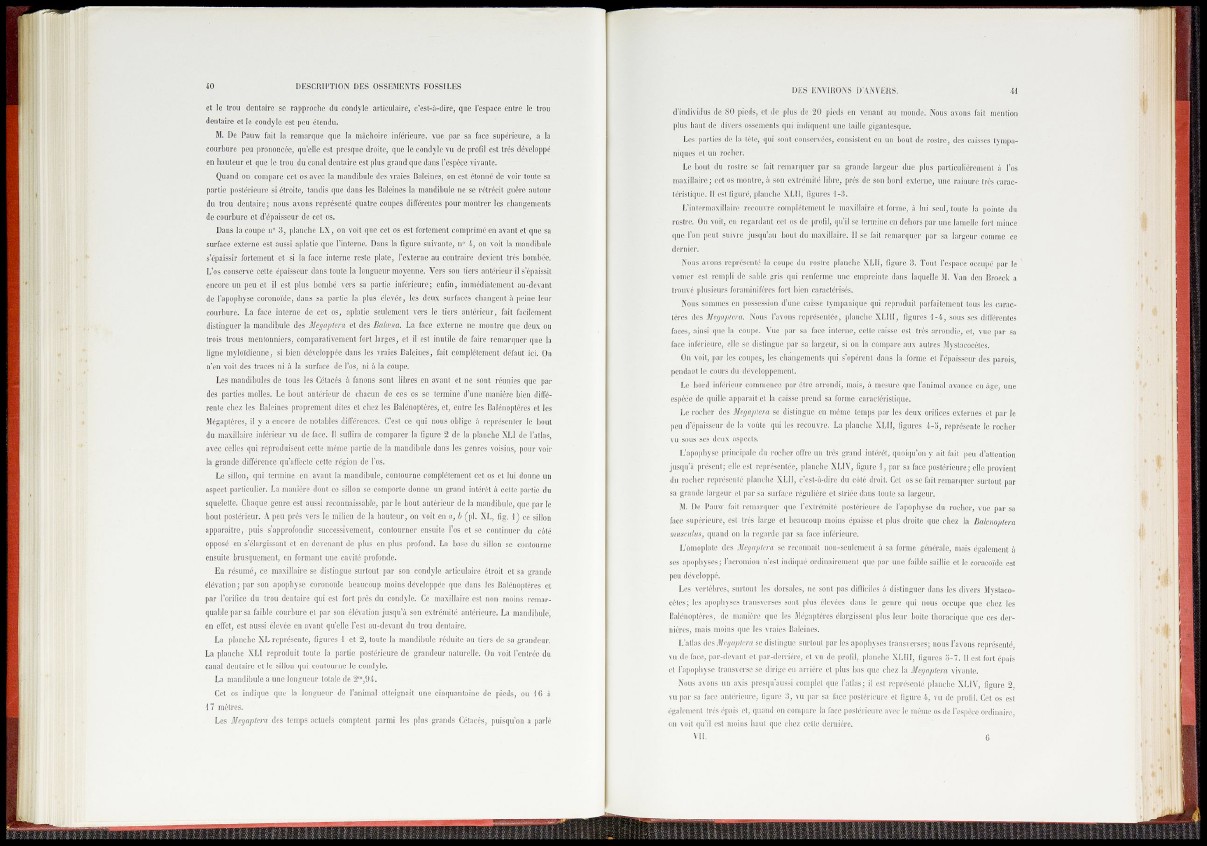
40 DESCRII'TIOiN DES OSSEMENTS FOSSILES
el le trou dcnl a i r e se rapproche du condyle arliculaire, c'esl-à-dire, que l'espace ent r e le trou
dentaire et le condylc est peu é t endu.
M. De Pa uw fait la r ema r q u e qu e la mâ choi r e inférieuve, vue par sa face supé r i eur e , a la
courbure peu prononcée, qu'elle est presque droite, que le condyl e vu de profil est très développe
en h a u t e u r et que le trou du canal dentaire est plus gr and que dans l'espèce vivanic.
Quand ou compa r e cet os avec la mandibul e des vraies Baleines, on est étonne de voir toiile sa
partie postérieure si étroile, tandis qu e dans les Baleines la mandibul e ne se rétrécit guè r e autour
du trou dent a i r e ; nous avons r e p r é s e n t é qua t r e coupes différentes pour mont r e r le¿ changement s
de c o u r b u r e cl d' épa i s s eur de cet os.
Dans la coupe n" 3, pl anche L X , on voit que cet os est for t cmenl compr imé en avant et que sa
surface ext e rne est aussi aplatie que r i n t e r n e . Dans la figure suivante, n" 4, on voit la mandibul e
s'épaissir for t ement et si la face int e rne reste pl a t e , r e x t c r n e au contraire devient très bombée.
L'os conserve cette épaisseur dans toute la l ongueur moyenne . Ve r s son tiers ani c r i cur il s'épaissit
encore un peu et il est plus b omb é ve r s sa partie inf é r i eur e ; enf in, immédi a t emen t au-devant
de l'apophys e coronoïde , dans sa partie la plus élevée, les deux surfaces cliangent à peine leur
courbure. La face int e rne de cet os , aplatie s eul ement ve r s le tiers a n t é r i e u r , fait facilement
distinguer la ma n d i b u l e des Megaptcm et des Baliena. La face ext e rne ne mont r e que deux ou
trois trous mentonni e r s , compa r a t ivement fort l a rge s , et il est inutile de faire r ema r q u e r que la
ligne my l o ï d i e n n e , si bien développée dans les vraies Ba l e ine s , fait compl è t ement défaut ici. On
n'en voit des traces ni à la sur f a c e de l'os, ni à la coupe.
Les mandibul e s de tous les Cétacés à fanons sont libres en avant et ne sont réunies que pa r
des parlies molles. Le bout ant é r i eur de chacun de ces os se t e rmine d'une mani è r e bien différente
chez les Baleines p r o p r eme n t dites et chez les Balénoptères, et, ent r e les Balénoptèi'cs et les
Mégaptères, il y a encore de notables différences. C'est ce qui nous oblige à représenter le bout
du maxillaire inf é r i eur vu de face. Il suffira de compa r e r la figure 2 de la pl anche XLI de l'atlas,
avec celles qui r eprodui s ent celte même partie de la maiulibule dans les genr e s voisins, pour voir
ia g r a n d e di f f é r enc e qu'affecte cette région de l'os.
Le sillon, qui t e rmine en avant la mandibul e , contourne complètement cet os et lui donne un
aspect particulier. La mani è r e dont ce sillon se comport e donne un grand intérêt à celle partie du
squelette. Chaque genr e est aussi reconnaissable, p a r le bout ant é r i eur de In mandibul e, que par le
bout postérieur. A peu pr ès ve rs le milieu de la h a u t e u r , on voit en a, b (pl. XL, fig. ]} ce sillon
apparaître, puis s ' approfondir suc c e s s ivement , contourne r ensuite l'os et se cont inuer du côté
opposé en s'élargissant et en devenant de plus en plus profond. La base du sillon se contourne
ensuite brus quement , en formant une cavité profonde .
En r é s umé , ce maxi l l a i r e se distingue surtout par son condyl e articulaire étroi t et sa gr ande
élévation; par son apophys e coronoïde be aucoup moins développée que dans les Balénoptères et
par l'orifice du (rou dcnlaire qui est fort près du condyle. Ce maxi l l a i re est non moins r ema r -
quable p a r sa faible c o u r b u r e et par son élévation jusqu' à son ext r émi t é antérieure. La mandii)ule,
en effet, est aussi élevée eu avant qu'elle l'est au-devant du trou dentaire .
La pl anche XL r epr é s ent e , figures 1 et 2, toute la ma n d i b u l e réduit e au tiers de sa gr andeur .
La pl anche XLI r eprodui t toute la partie postérieure de g r a n d e u r naturelle. On voit l'entrée du
canal dent a i r e et le sillon qui contourne le condyl e .
La ma n d i b u l e a un e longueur totale de 2 " ' , 0 i .
Cet os indique que lu longueur de l'animal atteignait une cinquantaine de pieds, ou IG à
1 7 mè t r e s .
Les Meijuplem des t emp s actuels compt ent pa rmi les plus gi'ands Cétacés, puisqu'on a parlé
Di'S ENVIRONS D'ANVERS. M
d'individus de 80 pieds, cl de plus de 20 pieds en venant au monde . Nous avons l'ait mention
|)lus haut de divers ossements qui indiquent un e taille gigant esque.
Les parties de la tèle, qui sont conservées, consistenl en un bout de ros t r e , des caisses tyrnpa -
niques et un roche r .
Le bout du rostre se l'ait r ema r q u e r par su g r a n d e largeur duc plus parliculièrement à l'os
maxillaire ; cet os mont r e , à son extrémit é libre, près de son bord exl e rne , une ruinure très carucléi'istiquo.
Il est figuré, pl anche XLII, ligures '1-3.
L'inlorniaxilliiire r e couvr e com|)lélement le maxillaire et forme, à lui seul, toute la pointe du
roslre. On voit, en r ega rdant cet os do prolil, qu'il se termine en dehor s pai' une lamelle fort mince
(|ue l'on peut suivi'c jusqu' au bout du maxillaire. Il se fait r ema r q u e r par sa largeur comme ce
dernier.
Nous avons l'eprésenlé la coupe du roslre pl anche XLII, figure 3. To u t l'espace occupé par le
vonu^r est reuipli de salde gris qui r e n f e ime une empr e int e dans Iu([uelle M. Van den Broeck a
trouvé plusieurs foraminifères fort bien caractérisés.
.Nous somme s en possession d'une caisse tynipanique qui r eprodui t pa r f a i t ement tous les caractères
i\cs Merjopífia. Nous l'avons r epr é s ent é e , planche XLI I I , figures 1 - i , sous ses difféi'entes
faccs, ainsi que la coupe. Vue par sa face int erne , cette caisse est très a r rondi e , et, vue par sa
lace inférieure, elle se distingue pur sa l argeur , si on lu compa r e aux aut r e s .'\lyst!icocéles.
On voit, par les coupes, les c h a n g eme n t s qui s'opèrent dans la forme et l'épaisseur des parois,
pendaiil le cours du développement .
Le bord inférieur c omme n c e par être a r rondi, mais, à me sur e que l'animal avanc e en âge, une
espèce de quille apparaî t et la caisse prend sa forme caractéristique.
Le rocher des Metjuplera se dislingue en même temps p a r les deux orifices ext e rne s el par le
peu d'épaisseur de la voûte qui les recouvre. La planche XLII, figures 4 - 3 , r epr é s ent e le r o c h e r
vu sous ses deux aspects.
L'apophyse principale du rocher ollre un très grand intérêt, quoiqu'on y ait fait peu d'attention
jusqu' à présent; elle est r epr é s ent é e , pl anche XLIV, figure 1, par sa face postèrieui'C; elle provient
(lu rocher r epr é s ent é pl anche XLI I , c'esl-à-dire du coté droit. Cet os se fait r ema r q u e r sur tout pur
sa g r a n d e l a rgeur el par sa sin-face rcgidiére el striée dans toute sa largeur.
.M. De l ' a uw l'ait l'emartjuer qu e l'extrémité postérieure de l'apophys e du r o c h e r , vue par sa
face supé r i eur e , est 1res lai'ge et be aucoup moins épaisse cl plus droite que chez la liaienoplcva
muscnliifi, quand on hi r e g a r d e par su face inf é r i eur e .
L'omopluie des Mcgoptvm so reconnaît non- s eul ement à sa forme générale, mais éga l ement à
ses a p o p h y s e s ; l'acroinion n'est indiqué ordina i r ement (jue par une faible saillie et le coracoïde est
peu développé.
Les vertèbres, surloul les dorsales, ne sont [)as diliicilcs à distinguer dans les divers Mvstacocèles;
les ajiophyses transverses sont plus élevées d a n s le g e n r e qui nous occupe que chez les
Balénoplèi'cs, de mani è r e (|ue les .'»légaptéres élargissent plus leur boîte Iboi'acique que ces d e r -
nières, mais moins (pie les vruies Baleines.
L'allas des :\lajaplmi se distingue surtout par les ai)opliyses transverses; nous l'avons représenté,
vu de l'ace, p a r - d o \ a n l cl [¡ar-derrière, cl vu de profil, pl anche XLIII, figures 5 - 7 . Il est foi't épais
et r apo| )bys e transverse se dirige en arrièr e et plus bas que chez la Majapicra \ ivanle.
Nous avons un axis pros(|u'aussi complet que l'atlas; il esl représ ent é pl anche XLIV, figure 2,
vu par sa face antérieure, figure 3, \ n par sa face postérieure el figure 4, vu de profil. Cet os est
également ti'ès épais el, (¡uand on compa r e la face postéi ieure a\ ec le même os de I'esjwce oi'dinaire,
on \()it (|u'il est inoins haut que chez celte dernière.
\ 11. 0