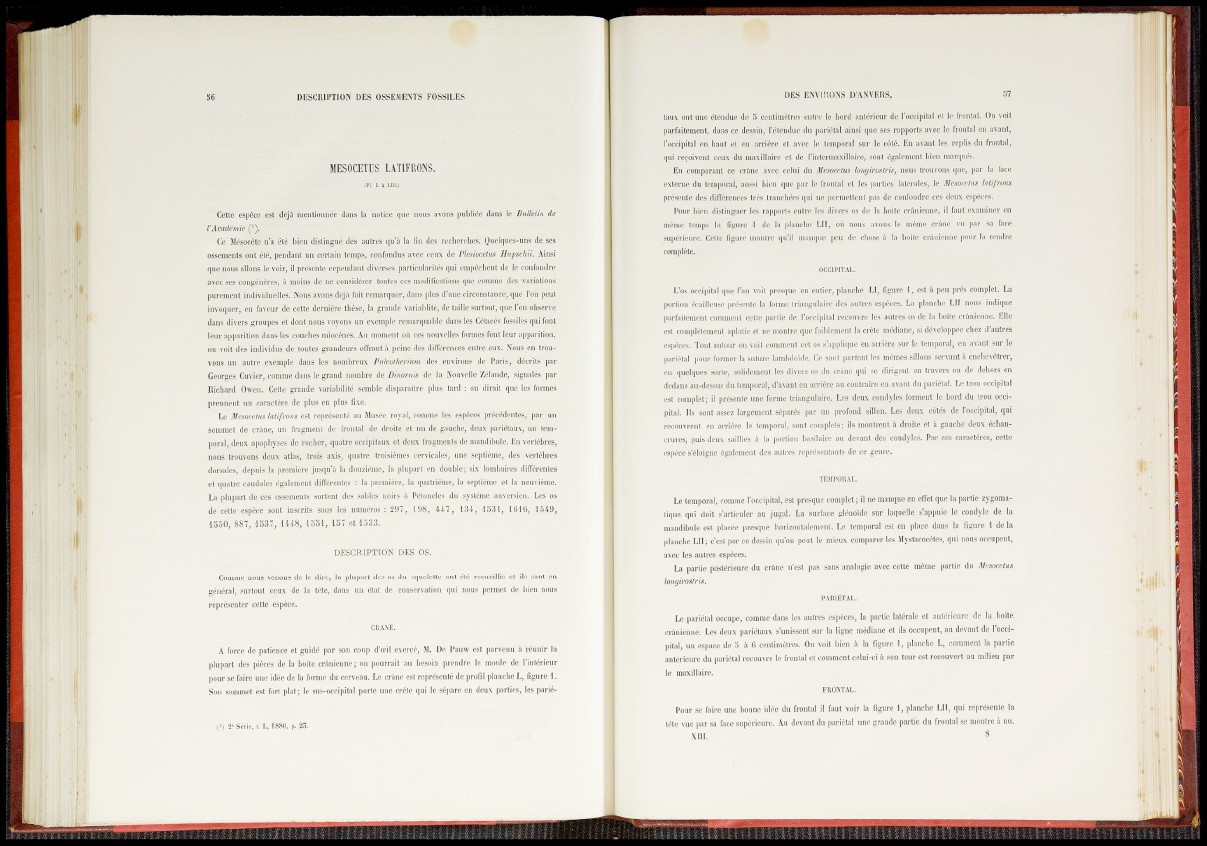
S6 DESCRIPTION DES OSSEMENTS FOSSILES
MESOCETUS LATIFRONS.
Cette espèce est déjà ment ionné e dans la notice que nous avons publiée dans le Bullelin de
l'Académie (').
Ce Mésocète n'a été bien distingué des uiitros qu'à !a fin des reclierches. Quel(|uas-uns de ses
ossements ont été, pendant un certain temps, confondus avec ceux de Plcsioceliis /¡upscltii. Ainsi
que nous allons le voir, il présente c ependant diverses parlicnlarilés qui enipèclienl de le confondr e
avec ses congénè r e s , à moins de ne considérer toutes ces modifications quo comme des variations
purement individuelles. Nous avons dc\jà fait r ema r q u e r , dans plus d'une circonstance, que Ton peut
invoquer, en f aveur de cette de rni è r e tlièse, la g r a n d e variablité, de taille surloul, que l'on observe
dans divers g r o u p e s et dont nous voyons un exempl e r ema rquabl e dans les Cétacés fossiles qui font
leur apparition dans les couches miocènes. Au mome n t où ces nouvelles forme s font leur apparition,
on voit des individus de toutes g r a n d e u r s of f r ant à pe ine des différences ent r e eux. Nous en t rouvons
un aut r e exempl e dans les n omb r e u x Pulcotherium des environs de Pa r i s , décrit s par
Georges Cuvier, c omme dans le gr and n omb r e de Dinornls de la Nouvelle Zélande, signalés par
Richard Owe n . Cette g r a n d e variabilité semble disparaître plus lard : on dirait que les formes
prennent un c a r a c t è r e de plus eu plus fixe.
Le Jlesoce/us lalifmis est r epr é s ent é au Musée roya l , comme les espèces précédentes , par un
sommet de c r âne , un f r a gme n t de frontal de droite et nn de gauche , deux pariétaux, un t emporal,
deux apophys e s de j o c h e r , quali-e oc c ipi l au\ et deux f r a gme n t s de n)andil)ule. En vertèbres,
nous t rouvons deux atlas, trois axis, qua t r e troisièmes cervicales, une septième , des vertèbre s
dorsales, depui s la pr emi è r e j u s q u ' à la donzicme, la plupa r t en doubl e ; six lomba i r es différentes
et qua t r e caudales éga l ement différentes : la pr emi è r e , la qua t r i ème, la septième et la neuvi ème .
La plupa r t de ces ossements sortent des sables noii's à Pétoncles du système anversicn. Les os
de celle espèce sont inscrits sous les numé ros : 2 9 " , 1 9 8 , W T , 1 3 4 , l o 3 1 , 161(5, 1 5 4 9 ,
1 5 3 0 , 8 8 7 , 1 5 3 7 , 1 4 i 8 , 1 3 5 1 , 1 5 7 et 1 5 3 3 .
DESCRIPTION DES OS.
Comme nous venons de le di r e, la plupa r t des os du squelette ont été recueillis et ils sont en
général, sur loul c eux de la tète, dans un état de conservation qui nous permet de bien nous
représenter cette espèce.
CITANE.
A force de pa t i enc e et guidé p a r son coup d'oeil exercé, M. De Pa uw est pa rvenu à r éuni r la
plupart des pièces de la boite c r àm' e n n c ; on pour r a i t au besoin p r e n d r e le moule de l'intérieur
pour se faire une idée de la forme du c e rve au. Le c r âne est r epr é s ent é de profil planche L, figure 1.
Son s omme t est fort pl a t ; le sus-occipilal porte une crête qui le sépare en deux parties, les parié-
(') Série, t. L, 1880, p. 23.
DES ENVIRONS D'ANVERS. 157
taux ont une é t endue de 5 c ent ime t r e s ent r e le bord ant é r i eur de Poccipilal cl le frontol. On voit
parfaitement, dans ce dessin, l ' é t endue du pariélal ainsi que ses r appor t s ave c le frontal en avant ,
l'occipital en haut et en a r r i è r e et ave c le t empor a l sur le côté. Kn avanl les replis dn frontal,
qui reçoivent ceux du maxi l l ai re et de l'intermaxillaire, sont éga l ement bien ma rqué s .
En c omp a r a n t ce c r â n e avec celui du Mcsocctus long ¿rosir ts, nous t rouvons que, par la face
externe du temporal , aussi bien que par le frontal et les parties latérales, le Mcsocelits lalifrons
présente des différence s très tranchées qui ne pe rme t t ent pas de confondr e ces deux espèces.
Pour bien distinguer les ra|)ports ent r e les divers os de la boile c r âni enne , il faut e x ami n e r en
même t emps la figure 1 de la pl anche LU, où nous avons le môme c r â n e vu par sa face
supérieure. Celle ligure mont r e qu'il ma n q u e peu de chose à la boite cn'iniennc |)0ur la r e n d r e
complète.
L'os occipital que l'on voit pr e sque en entier, pl anche Ll , figure 1, est à peu près complet . La
portion écailleuse présente la forme t r i angul a i r e des aut r e s espèces. La pl anche LU nous indique
parfaitement c omme n t celle partie de l'occipital r e couvr e les aut r e s os de la boile c r âni enne . Elle
est compl èl emenl aplatie et ne mont r e que fai!)lement la crête médi ane , si déve loppé e chez d' aut r e s
es|)èces. Tout auloiu- on voit comment cet os s'appli(|ue en a i r i è r e sur le t empor a l , en avanl sur le
|)ariélal pour forme r la SUIUI'G lambdoïde. Ce sont pa r tout les même s sillons s e rvant à e n c h e v ê t r e r ,
en quelques sorte, solidement les divers os du c r âne qui se dirigent en t r ave r s ou do dehor s en
dedans au-dessus du temporal , d'avant en a r r i è r e au cont r a i r e en avant du pariélal. Le trou occipital
est compl e t ; il présente une forme t r i angul a i r e . Les deux condyles forment le bord du trou occipital.
Ils sont assez l a rgement séparés par un profond sillon. Les d e u x côtés de l'occipital, qui
recouvrent en arrièr e le t empor a l , sont compl e t s ; ils mont r ent à droite et à g a u c h e deux é c h a n -
crures, puis deux saillies à la portion basilaire au devant des condyl es. P a r ces caractères, celte
espèce s'éloigne éga l ement des autres r epr é s ent ant s de ce g e n r e .
Le t empor a l , comme l'occipital, est pr e sque complet ; il ne ma n q u e en effet qu e la partie z y g oma -
tique qui doit s'articuler au j u g a l . La sur f a c e glénoïde sur laquelle s ' appuie le condyl e de la
mandibule esi placée pr e sque hor i zonl a l eni enl . Le t empor a l est en place dan? la figure 1 de la
planche LU; c'est par ce dessin qu'on peut le mi eux c omp a r e r les Mystacocéles, qui nous oc cupent ,
avec les aut r e s espèces.
La partie postérieure du c r â n e n'est pas s ans analogie ave c cette même partie du Mesocetus
lonyirosiris.
P A R I É T A L ,
Le pariétal occupe , comme dans les aut r e s espèces, la p a n i c latérale et ant é r i eur e de la boite
crânienne. Les d e u x pa r i é t aux s'unissent sur la ligne médi ane et ils occupent, au devant de l'occipital,
un espace de 5 à 6 centimètres. On voit bien à la figure 1, pl anche L, c omme n t la partie
antérieure du pariélal r e couvr e le frontal et c omme n t celui-ci à son tour est r e couve r t au milieu par
le maxillaii'C.
Pour se faire une bonne idée du frontal il faut voir la figure 1, p l a n c h e LU, qui r epr é s ent e la
léte vue par sa face supé r i eur e . Au devant du pariétal une g r a n d e pa r t i e du frontal se mo n t r e à nu.
XIII.