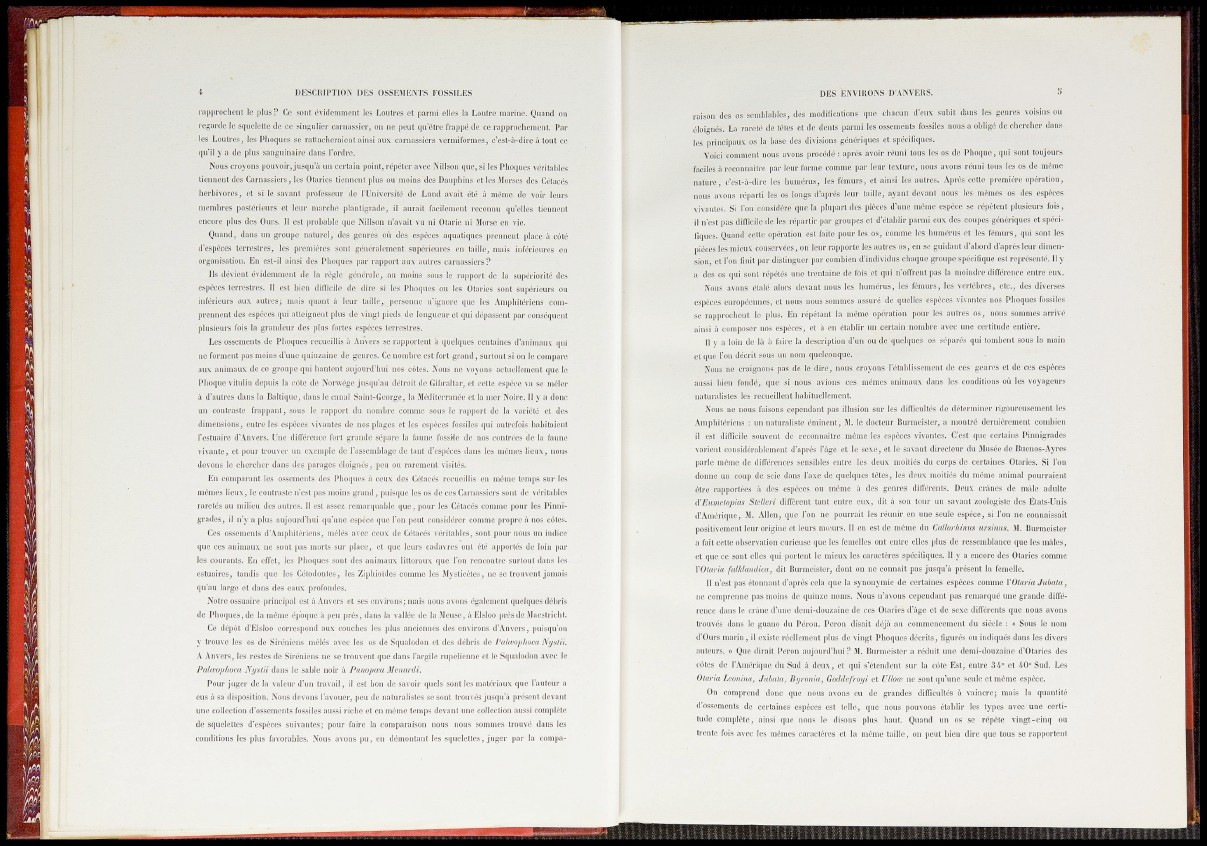
i DESCIUPTIO^Î DES OSSEMENTS FOSSILES
rapprocheiil le p l u s ? Ce sont ôvidcinitieiit les Loutres et parmi elles la Loulre marine. Qitoncl ou
regarde le sqiiolelte de ce singulier eariiassicr, on ne peut qu'être frappé de ce rapprochement. Pai'
les Lout r e s , les Phoque s se ratiacheraienl ainsi aux carnassiers vc rmi lorme s , c'est-à-dire à tout ce
qu'il y a de plus sanguinaire dans Tordre.
Nous croyons pouvoir, jusqu' à un certain point, répéter avec i\illson que, si les Phoques vcritahlcs
tiennent des Carnassiers, les Otaries tiennent plus ou moins des Dauphins et les .Morses des Cétacés
herbivores, et si le savant proiesseur de TUniversité de Lund avait été à même de voir leurs
membres postérieurs et leur ma r che plantigrade , il aurait racilcmenl reconnu (|u'elics tiennent
encore plus des Ours. Il est probable que Mllson n'avait vu ni Otarie ni Morse en vie.
Quand, dans un groupe naturel, des genres où des espèces aquatiques preimeut piace à côté
iPcspèces terrestres, les premières sont généralement supérieures en taille, mais inférieures en
organisation. En est-il ainsi des Phoque s [)ar rapport aux autres c a rna s s i e r s ?
Ils dévient évidemment de la règle générale , au moins sous le l'apport de la supéi'iorité des
espèces terrestres. Il est bien dilh'cile de dire si les Phoqiies ou les Otaries sont su[iérieHrs ou
inférieurs aux. aut r e s ; mais quant à leur taille, personne n'ignore que les Amphitériens comprennent
des espèces qui atteignent plus de \ l n g t ])icds de longueur et qui dépassent pa r conséquent
plusieurs fois la gr andeur des plus fortes espèces lerrestres.
Les ossements de Phoques recueillis à Anvers se rapportent à quelques centaines d'animaux qui
ne forment pas moins d'une quinzaine de genres. Ce nombre est fort g r a n d , surtout si on le compare
aux animaux de ce groupe qui hantent aujourd'hui nos côtes. Nous ne voyons acluellement que le
Phoque vitulin depuis la cote de Xorvvége jusqu'au détroit de Gibraltar, et celle espèce va se mêler
à d'autres dans la Baltique, dans le canal Saint-George, la Médilerranée et la me r Noire. Il y a donc
un contraste f r appant , sous le rapport du nombr e comme sous le rapport de la variété et des
dimensions, entre les espèces vivantes de nos plages et les espèces fossiles qui autrefois habitaient
l'estuaire d'Anvers. Une dillerence fort gr ande sépare la faune fossHe de nos contrées de la faune
vivante, et pour trouver un exemple de l'assemblage de tant d'espèces dans les mêmes l i eux, nous
devons le chercher dans des parages éloignés, peu ou r a r ement visiles.
En comparant les ossements des Phoques à ceux des Cétacés recueillis en même temps sur les
mêmes lieux, le contraste n'est pas moins gi'and, puisque les os de ces Carnassiers sont de véritables
raretés au milieu des autres. Il est assez r ema rquabl e q u e , pour les Cétacés comme pour les Pinnigrades,
il n'y a plus aujourd'hui qu'une espèce que l'on peut considérer comme propi'e à nos cotes.
Ces ossements d'Aniphitériens, mêlés avec ceux de Cétacés véritables, sont pour nous un indice
que ces animaux ne sont pas morts sur place, et que leurs cadavres ont été apportés de loin par
les courants. En effet, les Phoques sont des animaux littoraux que Ton rencontre surtout dans les
estuaires, tandis que les Cétodontes, les Zipliioïdes comme les Myslicetes, ne se trouvent jamais
qu'au large et dans des eaux profondes.
Notre ossuaire principal est à Anvers et ses environs; mais nous avons également ({uelques débris
de Phoque s , de la même époque à peu pr è s , dans la vallée de la .Meuse, à EIsloo près de ilaestrichi.
Ce dépôt d'EIsloo correspond aux couches les plus anciennes des environs d'Anve r s, puisqu'on
y trouve les os de Sii'éniens mêlés avec les os de Squalodon et des débris do l'aloeophoca Nijsli/.
A Anve r s , les restes de Siréniens ne se trouvent que dans l'argile rupelienne et le Squalodon avec le
Palmphocu Nyslii dans le sable noir ù Panopuiu Menordi.
Pour ju ge r de la valeur d'un travail, il est bon de savoir quels sont les matériaux que l'auleur a
eus à sa disposition. Nous des'ons l'avouer, peu de natui'alistes se sont trouvés jusqu'à présent devant
une collection d'ossements fossiles aussi riche et en même temps devant une collection aussi complète
de squelettes d'espèces suivantes; pour faire la comparaison nous nous sommes trouvé dans les
conditions les plus favorables. Nous avons p u , en démontant les squelettes, j u g e r par la comi)a-
DES ENVIRONS D'ANVERS. •)
raison des os semblables, des modifications que chacun d'eux subit dans les genres voisins ou
éloignés. La rareté de tètes et de dents parmi les ossements fossiles nous a obligé de cherche r dans
les principaux os la base des divisions génériques et spécifiques.
Voici comment nous avons procédé : après avoir réuni tous les os de P h o q u e , qui sont toujour s
faciles à reconnaître |)ar leur forme comme par leur texture, nous avons réuni tons les os de même
nature, c'est-à-dire les humé rus , les f émur s , et ainsi les autres. Après cotte première opération,
nous avons réparti les os longs d'après leur taille, ayant devant nous les mêmes os des espèces
vivantes. Si l'on considère que la plupart des pièces d'une même espèce se répètent plusieurs fois,
il n'est pas dilliciie de les réparlir par groupes et d'établii- parmi eux des coupes génériques et spécifiques.
Quand cette opération est faite pour les os, comme les humé rus et les f émur s , qui sont les
pièces les mieux conservées, on leur rapporte les autres os, en se guidant d'abord d'après leur dimension,
et l'on finit par distinguer par combien d'individus chaque groupe spécifique est représenté. Il y
a des os qui sont répétés une trentaine de fois et qui n'offrent pas la moindre difi'érence entre eux.
Nous avons étalé alors devant nous les h umé r u s , les f émur s , les vertcbi'es, etc., des diverses
espèces européennes, et nous nous sommes assuré de quelles espèces vivantes nos Phoques fossiles
se rapprochent le plus. En répétant la même opération poui' les autres o s , nous sommes arrivé
ainsi à composer nos espèces, et à en établir un certain nombr e avec une certitude entière.
Il Y a loin de là à faire la description d'un ou de quelques os séparés qui tombent sous la main
cl que l'on décrit sous un nom quelconque.
Nous ne craignons pas de le di r e , nous croyons l'établissement de ces genres et de ces espèces
aussi bien fondé, que si nous avions ces mômes animaux dans les conditions où les voyageur.'«
naturalistes les recueillent habituellement.
Nous ne nous faisons cependant pas illusion sur les difficultés de déterminer rigoureusement les
Amphitériens : un naturaliste eminent , M. le docteur Burmeister, a mont ré dernièrement combien
il est difilcile souvent de reconnaître même les espèces vivantes. C'est que certains Pinnigrades
varient considérablement d'après l'ûge et le s exe , et le savant directeur du Musée de Buenos-Ayres
parle même de différences sensibles entre les deux moilics du corps de certaines Otaries. Si l'on
donne un coup de scie dans l'axe de quelques têtes, les deux moitiés du même animal pourraient
être rapportées à des espèces ou même à des genres dilîérents. Deux crânes de mâle adulte
(]CEume(opias SlcUeri difi'èrent tant entre eux, dit à son tour un savant zoologiste des Élats-Unis
d'Amérique, M. Allen, que l'on ne pourrait les réunir en une seule espèce, si l'on ne connaissait
positivement leur origine et leurs moeur s . 11 en est de même du Cailorhinits ursinus. M. Burmeister
a fait cette observalion curieuse que les femelles ont entre elles plus de ressemblance que les mâ l e s ,
et que ce sont elles qui portent le mi eux les caractères spécifiques. II y a encore des Otaries comme
XOtaria fulklandica, dil Burmeister, dont on ne connaît pas jusqu' à présent la femelle.
Il n'est pas étonnant d'après cela que la synonymi e de certaines espèces comme VOtaria Jubata,
ne compr enne pas moins de quinze noms. Nous n'avons cependant pas r ema rqué une gr ande différence
dans le crâne d'une demi-douzaine de ces Otaries d'âge et de sexe diflërents que nous avons
trouvés dans le guano du Pérou. Pe ron disait déjà au commenc ement du siècle : « Sous le nom
d'Ours ma r i n , il existe réellement plus de vingt Phoque s décrits, figurés ou indiqués dans les divers
auteurs. » Que dirait Peron a u j o u r d ' h u i ? M. Burmeister a réduit une demi-douzaine d'Otaries des
cotes de l'Amérique du Sud à d e u x , et qui s'étendent sur la cote Est, entre 3 4 " et /lO^Sud. Les
Otaria Leonina, Jabata, Baronia, Goddefroyi et CUooe ne sont (pi'une seule et même espèce.
On comprend donc que nous avons eu de grandes difficultés à va inc r e; mais la quantité
d'ossements de certaines espèces est toile, que nous pouvons établir les types avec une certitude
complète , ainsi que nous le disons plus haut. Quand un os se répète v i n g t - c i nq ou
trente fois avec les mêmes caractères et la même taille, on peut bien dire que tous se rapportent
mi--^-^