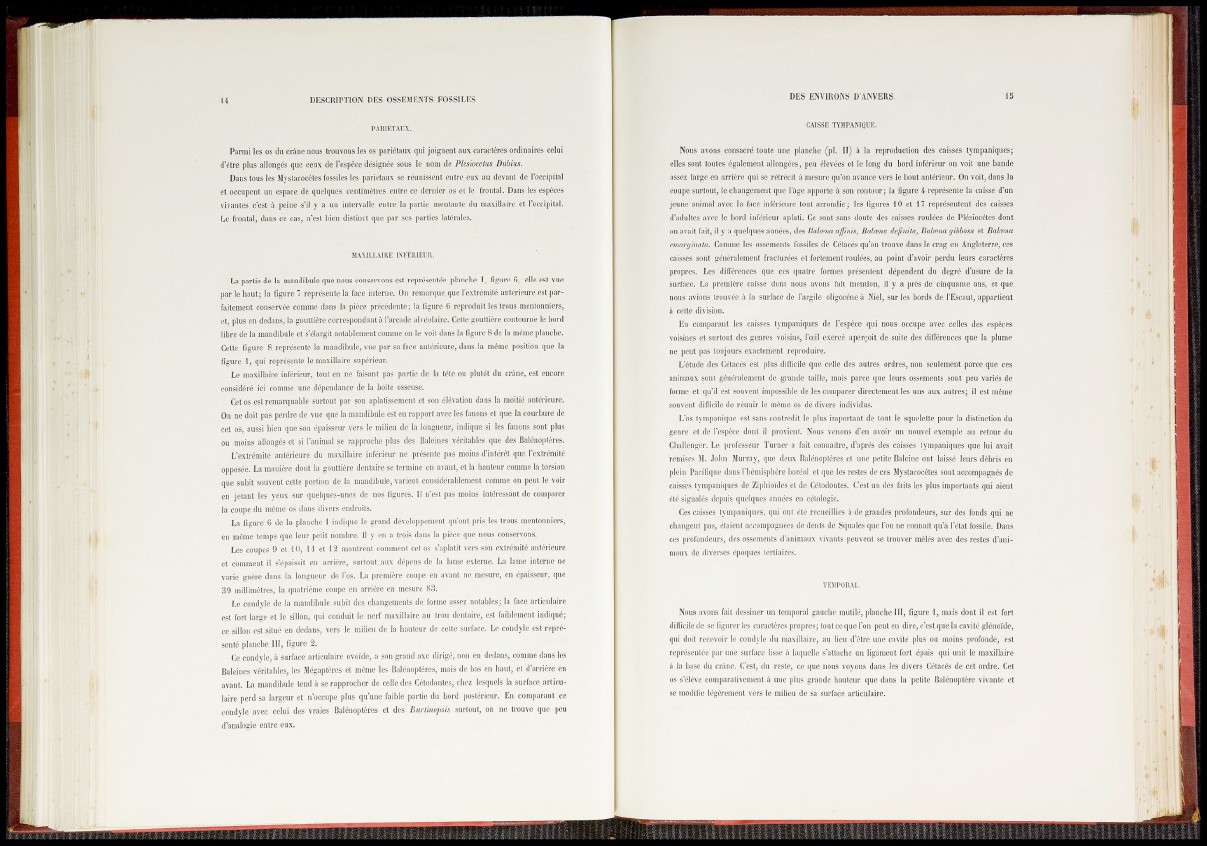
DESCRIPTION DES OSSEMENTS FOSSILES
Parmi les os dit c r âne nous trouvons les os pariétaux qui joignent aux caractères ordinaires celui
d'être plus allongés que ceux de l'espèce désignée sous le nom de Plcsiocalus Diibius.
Dans tous les Mystococétes fossiles les pariétaux se réunissent ent r e eux au devant de l'occipital
et oc cupent un espace de quclr|ues centimètres ent r e ce de rni e r os et le frontal. Dans les espèces
vivantes c'est à peine s'il y a un intervalle ent r e la partie mont ant e du maxillaire et l'occipital.
Le frontal, dans ce cas, n'est bien distinct que par ses parties latérales.
M-\XlI.l-AiUE INFÉRIEURLa
partie de la mandibul e que nous conservons est représentée pl anche I, figure 6, elle est vue
par le h a u t ; la flgure 7 r epr é s ent e la face interne. On r eni an(ue qu e l'extrémilé ant é r i eure est p a r -
faitement conservée c omme dans la pièce pr é c édent e ; la figure 6 r eprodui t les trous mentonniers,
et, plus en dedans, la gouttière cor r e spondant à l'arcade alvéolaire. Celte goultière contourne le bord
libre de la mandibul e et s'élargit notablement comme on le voit dans la figure 8 de la même planche.
Cette figure 8 r epr é s ent e la mandibul e , vue par sa face antérieure, dans la même position que la
figure 1, qui représente le maxillaire supé r i eur .
Le maxillaire inférieur, tout en ne faisant pas partie de la tète ou plutôt du c r âne , est encore
considéré ici c omme une dépendanc e de la boite osseuse.
Cet os est r ema r q u a b l e surtout par son aplatissement et son élévation dans la moitié antérieure.
On ne doit pas pe rdr e de vue que la mandibul e est en r appor t avec les fanons et que la courbur e de
cet os, aussi bien que son épaisseur ve rs le milieu de la longueur , indique si les f anons sont plus
ou moins allongés et si l'animal se r approche plus des Baleines véritables que des Balénoptères.
L'extrémité ant é r i eur e du maxillaire inférieur ne présente pas moins d'intérêt que l'extrémité
opposée. La mani è r e dont la gouttière dentaire se t e rmine en avant, et la haut eur comme la torsion
que subit souvent celle portion de la mandibul e, varient considérablement comme on peut le voir
en j e t ant les yeux sur quelques-une s de nos figures, li n'est pas moins intéressant de compa r e r
la coupe du même os dans divers endroits.
La figure 6 de la pl anche 1 indique le gr and déve loppement qu'ont pris les trous mentonni e r s ,
en même t emps que leur petit nombr e . Il y en a trois dans la pièce que nous conservons.
Les coupes 9 et lU, M et 12 mont r en t c omme n t cet os s'aplatit vers son extrémité ant é r i eure
et comment il s'épaissit en arrière , sur tout aux dépens de la lame externe. La lame interne ne
varie guère dans la longueur de l'os. La première cou)>e en avant ne me sur e , en épaisseur, qu e
3 9 millimètres, !a quatrième coupe en a r r i è r e en me sur e 8 3 .
Le condyle de la mandibul e subit des changement s de forme assez notables; la face articulaire
est fort large et le sillon, qui condui t le nerf maxillaire au trou dentaire, est laibiement indiqué;
ce sillon est situé en dedans, ve r s le milieu de la haut eur de cette surface. Lo condyl e est r e p r é -
senté pl anche 111, figure 2.
Ce condyl e , à sur f a c e ai'ticulaire ovoïde, a son gr and axe dirigé, non en dedans, comme d a n s les
Baleines véritables, les Mégaptères et même les Balénoptères, mais de bas en haut , et d' a r r i è r e en
avant. La mandibul e tend à se r a p p r o c h e r de celle des Cétodonles, chez lesquels la sui'face a r t i culaire
pe rd sa l a rgeur et n'occupe plus qu'un e faible partie du boi'd postérieur. En compa r ant ce
condyle avec celui des vraies Balénoptères et des Burliiiopm surtout, on ne trouve que peu
d'analogie ent r e e u x .
DES EINVIROINS D'AiNVERS.
CAISSE TYMPANIQUE,
15
Nous avons consacré toute une planche (pl. II) à la reproduction des caisses tympanique s ;
elles sont toutes éga l ement allongées, peu élevées el le long du bord inférieur on voit un e b a n d e
assez large en arrièr e qui se rétrécit à me sur e qu'on avance ve r s le bout ant é r i eur . On voit, d a n s la
coupe surtout, le c h a n g eme n t que l'âge apporte à son contour ; !a figure 4 représ ent e la caisse d'un
jeune animal ave c la face inférieure tout a r r o n d i e ; les figures 10 et 17 r epr é s ent ent des caisses
d'adultes avec le bord inférieur aplati. Ce sont sans doute des caisses roulées de Plésiocètes dont
on avait fait, il y a quelques années, des lialnna a/finis, Baloeiia dejînilu, Baloena (jibbosa et Bakcna
emaryinala. Comme les ossements fossiles de Cétacés qu'on trouve dans le crag en Angleterre, ces
caisses sont généralement fracturées et for t ement roulées, au point d'avoir perdu leurs caractères
pro|)res. Les différences que ces qua t r e forme s présentent dépendent du degr é d'usur e de la
surface. La pr emi è r e caisse dont nous avons fait ment ion, il y a près de cinquante ans, et que
nous avions trouvée à la surface de l'argile oligocène à Niel, sur les bords de l'Escaut, appartient
è celte division.
En compa r ant les caisses tympanique s de l'espèce qui nous occupe avec celles des espèces
voisines el surtout des genr e s voisins, l'oeil exercé aperçoit de suite des différences que la plume
ne peut pas toujours exactement r eprodui r e .
L'étude des Cétacés est plus dillicile que celle des autres ordres, non seulement parce que ces
animaux sont généralement de gr ande taille, mais parce que leurs ossements sont peu variés de
forme et qu'il est souvent impossible de les c omp a r e r di rect ement les uns aux aut r e s ; il est même
souvent difficile d e r éuni r le même os de divers individus.
L'os t ympani qu e est sans contredit le plus impor t ant de loul le squelelte pour la distinction du
genre et de l'espèce dont il provient. Nous venons d'en avoir un nouvel exempl e au retour du
Challenger. Le professeur Tu r n e r a fait connaître, d'après des caisses tympanique s que lui avait
remises M. J o h n Mur r ay, que deux Balénoptères et une petite Baleine ont laissé leurs débr i s en
plein Pacifique dans rhémi spl i è re boréal et que les restes de ces Mystacocètes sont a c compagné s de
caisses tympanique s de Ziphioïdes et de Cétodontes. C'est un des faits les plus impor t ant s qui aient
été signalés depuis quelques années en cétologie.
Ces caisses tympaniques , qui ont été recueillies à de grandes profondeurs , sur des fonds qui ne
changent pas, étaient a c compagné e s de dents de Squales que l'on ne connaît qu'à l'état fossile. Dans
ces profondeurs, des ossements d' animaux vivants peuvent se trouver mêlés avec des restes d' ani -
maux de diverses époque s (erliaires.
Nous avons fait dessiner un temporal gauche mutilé, pl anche 111, figure 1, ma i s dont il est fort
dillicile de se figurer les caractères propr e s ; tout ce que l'on peut en dire, c'est que la cavité glénoïde,
qui doit recevoir le condyle du maxillaire, au lieu d'être une cavité ])lus ou moins profonde, est
représoulée par une sur f a c e lisse à laquelle s'attache un ligament fort épais qui unit le maxillaire
à la base du crâne. C'est, du reste, ce que nous voyons dans les divers Cétacés de cet ordre. Cet
os s'élève compa r a t ivement à une plus g r a n d e haut eur que dans la petite Balénoptère vivante et
se modifie légèrement vers le milieu de sa sur f a c e articulaire.
HflïJ