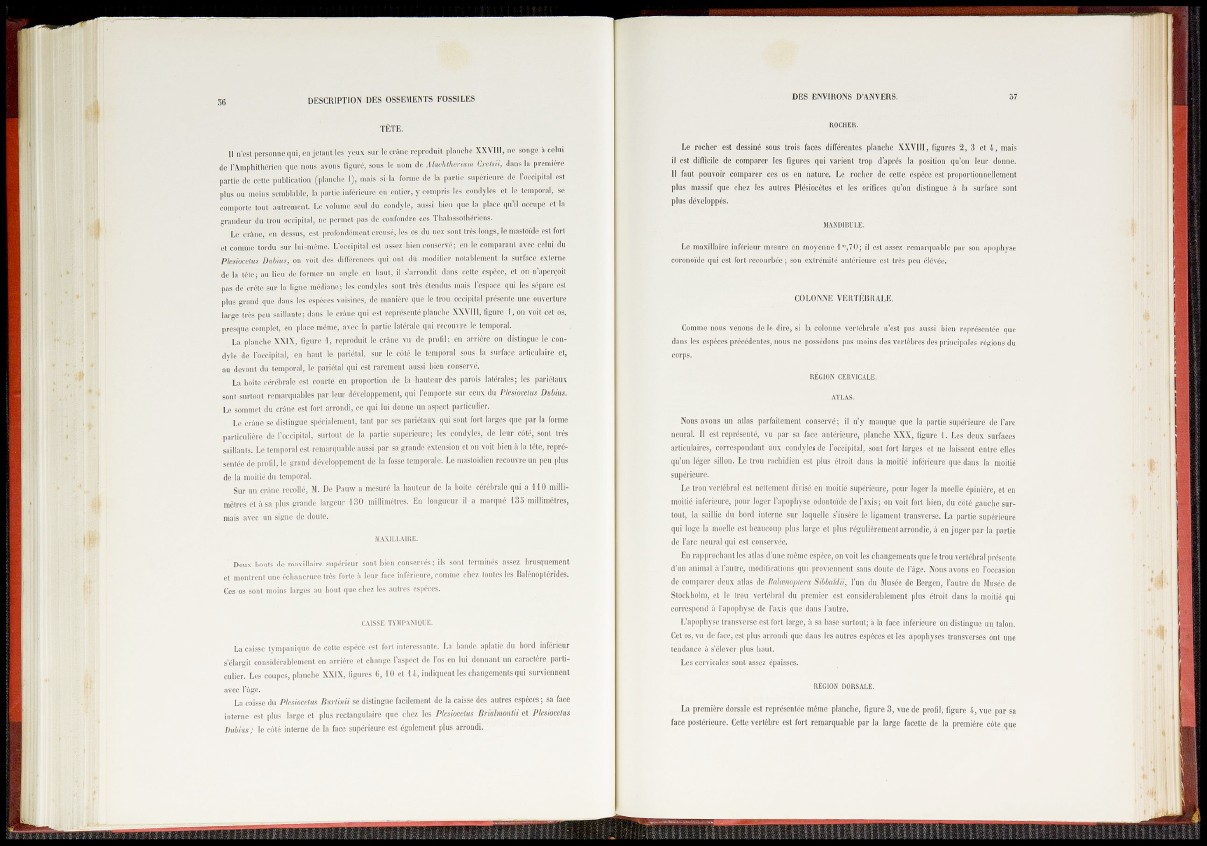
56 DESCRIPTION DES OSSEMENTS FOSSILES
TÊTE.
Il n'est personne qui, en j e t ant les y e u x s u r le c r ànc r eprodui t pl anche XXVI I I , no songe à celui
de rAniphi thé r i en que nous avons figuré, sous le nom ih Alaclitlirnim Crelsii, dniis la prcmii-re
partie de celte publication (pl anche 1), mais si la l'orme de la partie supé r i eure de l'occipital est
plus ou moins semblable, la partie iulêrieure en entier, y r omp r i s les condyles et le lemporal, se
comporte tout aut r emenl . Le volume seul du condyle, aussi bien (|uc la place qu'il occupe el In
grandeur du trou occipital, ne pe rme t pas de coiitbndre ces Thalassolbériens.
Le c r ane , en dessus, esl profondément creusé, les os du nez sont Ires longs, le mastoïde esl fort
el comme tordu sui' lui -même . L'occipital est assez biei! cons e rvé ; en le compa r ant avec celui du
Plesioccliis Jhibîus, on voil des diflerences qui ont dù moditier notablement la sur f a c e ext e rne
de la tète; au lieu de forme r un angle en baut , il s'arrondit dans cette espèce, et on n'aperçoit
pas de créte sur la ligne mé d i a n e ; les condyles sont très étendus mais l'espaoe qui les sépare est
plus gr and que dans les espèces voisines, de mani è r e que le trou occipital pi'ésenie une onvei'ture
large très peu saillante: dans le e r àne qui est r epr é s ent é pianelle XW' l l l , figure I, on voil cet os,
presque complet, en place même , ave c la pa r t i e latérale qui recouvre le temporal.
La pianelle XXIX, ligure 1, reproduit le c r âne vu de profil; en a r r i è r e on distingue le condyle
de l'occipital, en haut le pariétal, sur le côté le lemporal sous la sur f a c e arliculaire et,
au devant du lemporal, le pariétal qui est r a r eme n l aussi bien conservé.
La boite cérébrale est cour t e en proportion de la h a u t e u r des parois latérales; les pariétaux
sont surtout r ema rquabl e s par leur développement, qui l ' empor t e sur ceux du Plesiocelus DiiOius.
Le sommet du c r âne est fort a r rondi, ce qui lui donne un aspect particulier.
Le c r âne se dislingue spécialement, tant par ses pariétaux qui sont fort larges que par la forme
particulière de l'occipital, surlinil de la partie supé r i eur e ; les condyles, de leur coté, sont très
saillants. Le t empor a l est r ema rquabl e aussi p a r sa g r a n d e extension et on voil !)ien à la tète, r epr é -
sentée de proiil, le gr and déve loppement de la fosse temporale. Le mastoïdien r e couvr e un peu plus
de la moitié du temporal.
Sur un c r âne recollé, M. De Pa uw a me sur é la haut eur de la boîte cérébrale qui a MO millimètres
et à sa plus g r a n d e l a rgeur '3 3 0 millimètres. En longueui' ii a ma r q u é 4 3 5 millimétrés,
mais avec un signe de doute.
Deux bout s de maxillaire supé r i eur sont bien cons e rvé s ; ils sont t e rminé s assez brusquemen t
et mont r en t une éciiancrure très forte à leur face inférieure, connue chez loutes les Balénoptérides.
Ces os sont moins larges au bout que chez les aut r e s cs|)éces.
C.MSSE TYMfANIQl'E.
La caisse t ymp a n i q u e de cette espèce est fort inléres.simtc. La bande aplatie du bord inférieur
s'élargit cons idé r abl ement en a r r i è r e et c h a n g e i'as|)ecl de l'os en lui donnant un caractère pa r t i -
culier. Les coupes, planche XXIX, ligures 6, 10 et l i , indiquent les change r a enl s qui survi ennent
avec l'âge.
La caisse du Plesiocelus Burlimi se distingue facilement de la caisse des autres espèces; sa face
interne esl plus large et plus rectangulaire que chez les Plesiocelus Briabnontii el Plesiocelus
Dubius ; le côté interne de la face supé r i eure est éga l ement plus a r rondi .
DES ENVIRONS D'ANVERS.
Le rocher est dessiné sous trois faces dilTépcnles pl anche XXVI I I , figures 2, 3 el 4, ma i s
il est difficile de compa r e r les figures qui va r i ent trop d'après la position qu'on leur donne .
Il faut pouvoir compa r e r ces os en na tur e . Le roche r de cette espèce est proportionnellement
plus massif que chez les aut r e s Plésiocétes el les orifices qu'on distingue à la surface sont
plus développés.
Le maxillaire inférieur me sur e en mo y e n n e d'",7U; il esl assez r ema rquabl e par son apophys e
coronoïde qui esl fort recourbé e ; son ext r émi t é ant é r i eur e esl très peu élévée.
COLONNE VEKTEBUALE.
Comme nous venons de le dire, si la colo ime ver t ébrale n'est pas aussi bien l'cprésentée que
dans les espèces précédentes, nous ne possédons pas moins des vertèbre s des principales régions du
corps.
RÉGION CERVICALE.
ATLAS.
Nous avons un allas parfaitement c o n s e r v é ; il n'y ma n q u e qu e la partie supéi'ieure de l'arc
neural. Il est représenté, vu par sa face ant é r i eur e , pl anche XXX, figure 1. Les deux surfaces
articulaires, cor r e spondant a u x condyles de l'occipital, sont fort larges et ne laissent ent r e elles
qu'un léger sillon. Le trou rachidieii est plus étroit dans la moitié inféi'ieure qu e dans la moitié
supérieure.
Le trou vertébral est nettement divisé en moitié supé r i eur e , pour loger la moelle épinière, et en
moitié inférieure, pour loger l ' apophys e odontoïde de l'axis; on voit fort bi en, du coté g a u c h e s u r -
tout, la saillie du bord interne sur laquelle s'insère le ligament transverse. La partie supé r i eur e
qui loge la moelle est beaucoup plus large et plus r égul i è r ement a r rondi e , ù en j u g e r par la partie
de l'arc neura! qui est conservée.
En r a p p r o c h a n t les allas d'une même espèce, on voit les c h a n g eme n t s que le trou vertébral présente
d'un animal à l'autre, modifications qui provi ennent sans dout e de l'âge. Nous avons eu l'occasion
de compa r e r deux allas de iiahmopicra Sihbaklii, l'un du Jlusée de Bergen, l'auli-e du .Musée de
Stockholm, et le trou vertébral du pr emi e r est cons idé r abl ement plus étroit dans la moitié qui
correspond à l'apophyse de l'axis que dans l'autre.
L'apophyse t ransver s e est fort large, à sa base surtout; à la face inférieure on distingue un talon.
Cet os, vu de face, est plus arrondi que dans les aul r e s espèces el les apophys e s Iransverses ont une
tendance à s'élever plus h a u t .
Les cervicales sont assez épaisses.
RÉGION DORSALE.
La pr emi è r e dorsale est représentée même pl anche , figure 3, vue de profil, figure h-, vue par sa
face postérieure. Celte vertèbre esl fort r ema rquabl e par la large facelte de la pr emi è r e côte que