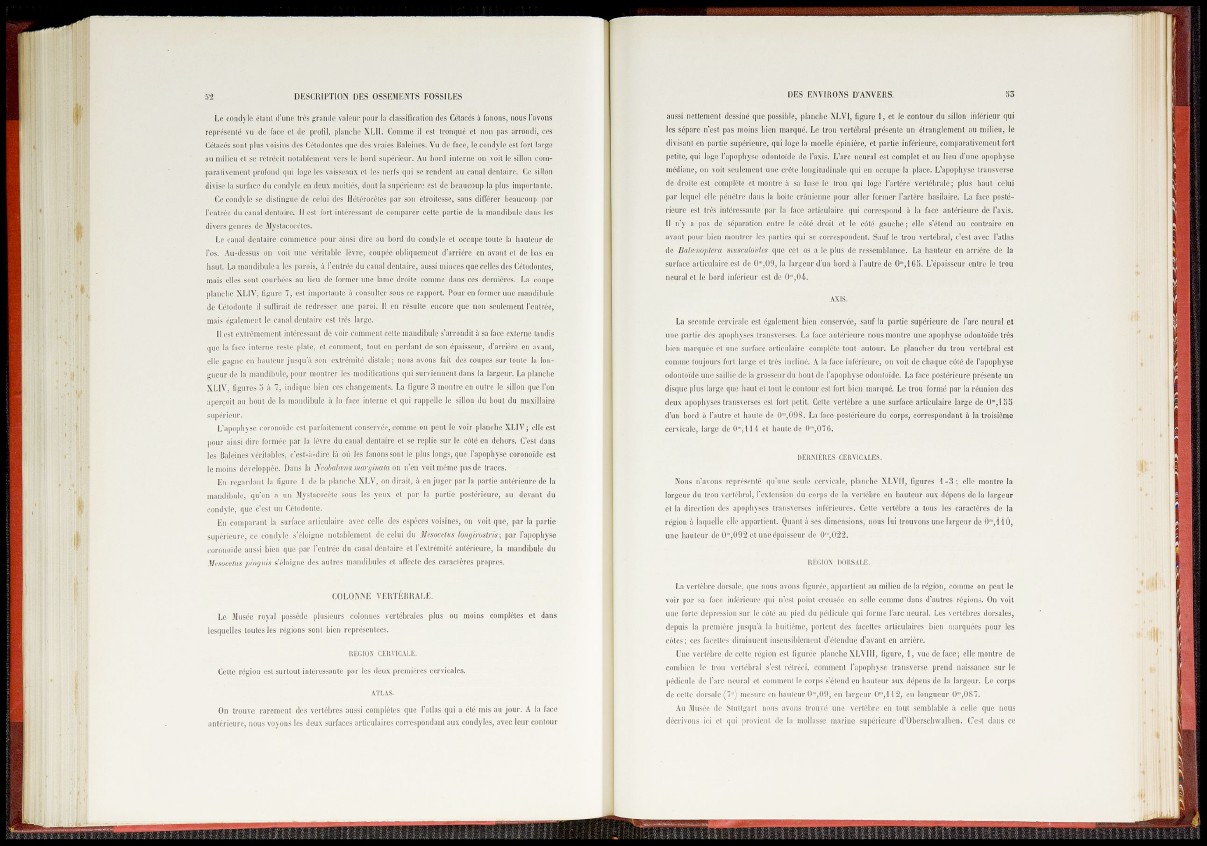
» ri 2 DKSCRIFTION DES OSSEMENTS FOS S ILES
Le condyl e élaiU d'une Irc^s gfiiiule viilciir pour la classification des Cétacés à fanons, nous l'avons
représenté vu de face et lie prolil, planclic XLl l . Comme il est t ronqué ot non pas in-rondi, ces
Cétacés sont plus \oisins des Oétodonles i]ue des vraies Baleines. Vu do face, le condyl e est fori large
au milieu et se rétrécit not abl ement ve r s le i)ord supéi'ieur. Au bord interne on voit le sillon conijKinUivemoiU
[irofond qui loge les vaisseaux et les nerfs qui se r enden t au canal deiUiiire. Ce sillon
divise la sur f a c e du condyle en deux moitiés, dont la supé r i eur e esl de b e a u c o u p la plus iniporlanle.
Ce condyle se distingue de celui des IJétérocètes par son étroilesse, sans dilTérer beaucoiif) par
l'entrée du canal dentaire, il esl fort intéressant de c omp a r e r celte partie de la maiulibule dans les
divers genr e s de Jlystacoeètes.
Le canal dent a i r e c omme n c e pour ainsi dire au bord du condyl e et occupe toute la haut eur de
l'os. Au-dessus on \ o i i une véritable lèvre, coupée obliquemeiil d' a r r i è r e en avanl el de bas en
liaut. La mandibul e a les parois, à l'entrée du canal dent a i r e , aussi minc e s que celles des Oétodonles,
mais elles sont courbé e s au lieu de former une lame di'oiie comme dans ces dernières. La coupe
planche XLIV, figure 7, est impor t ant e à consulter sous ce r appor t . Pour en former uiie mandibul e
de Cétodonte il sullii'aii de redi'essor une paroi. Il en résulte encore que non seulement l'entrée,
mais éga l ement le canal dentaire est (rès large.
Il est e x t r émeme n l intéressant de voir comment cette mandibul e s ' a r r o n d i t à sa face ext e rne tandis
que la face interne l'esle plate, et comment , tout en pe rdant de son épaisseur, d' a r r i è r e en avant ,
elle g a g n e en bauteni' jusqu' à son extrémité di s t a l e ; nous avons fail des coupes sur toute la longueur
de la mandibul e , pour montre)' les modifications qui survi ennent dans la largeur. La plancbe
XLIV, figures 3 à 7, indique bien ces changement s , La figure 3 mo n t r e en out r e le sillon que Ton
aperçoit au bout de la mandibul e à la face int e rne et qui rappelle le sillon du bout du maxillaire
supérieur.
L' apopbys e coronoïde est pa r f a i t ement conservée, comme on peut le voir pl anche XLIV; elle est
pour ainsi dire formé e |)ar la lèvre du canal dent a i r e et se replie sur le côté en dehor s . C'est dans
les Baleines véritables, c ' e s t - à -di re là où les fanons sont le plus longs, que l'apophys e coronoïde est
le moins développée. Dans la Seobaloena martjinaia on n'en voit même pas de traces.
En r ega r dant la figure I de la pl anche XLV, on dirait, à en j u g e r par la partie antéi'ieure de la
mandibule, qu'on a un Myslacocète sous les yeux et par la partie postérieure, au devant du
condyle, ([ue c'est un Cétodonle.
En c omp a r a n t la sur f a c e articulaire avec celle des espèces voisines, on voit que, par la partie
supérieure, ce condvi e s'éloigne not abl e jnent de celui du .)]ijsoceUis loiKjiroslri^-, par l'apophys e
coi'onoide aussi bien que par l'entrée du canal dent a i r e et l'extrémilé ant é r i eur e , la mandibul e du
McaoceUis pincjuis s'éloigne des a u t r e s mandi bul e s et alTecte des c a r a c i è r es propr e s .
DES EiNVIRONS D'ANVERS. f)3
aussi ne t t ement dessiné que possible, pl anche XLVI, figure •!, et le contour du sillon inférieur qui
les sépare n'est pas moins bien ma rqué . Le trou vertébral pr é s ent e un é t r angl ement au mi l i eu, le
divisant en partie supé r i eur e , qui loge la moelle épinière, et partie inf é r i eur e, compa r a t ivement fort
petite, qui loge l ' apophys e odontoïde de l'axis. L' a r c neur a l est complet et au lieu d'une a p o p h y s e
médiane, on voit s eul ement une créte longitudinale qui en occupe la place. L' apophys e t r ansve r s e
de droite est complète et montre à sa base le trou qui loge l'artère v e r t é b r a l e ; plus haul celui
par lequel elle pénèt r e dans la boite c r âni enne |)our aller foi'mer l'artère basilaire. La face postérieure
est très intéressante par la face ar t i cul ai r e qui correspond à la face ant é r i eur e de l'axis.
Il n'y a pas de séparation entre le côté droit et le côté g a u c h e ; elle s'étend au cont r a i r e en
avant pour bien mont r e r les parties qui se coi r e spondent . Sauf le trou ve r t ébr a l , c'est ave c l'atlas
de Dala-noplcra masvulo'idcs que cet os a le plus de r e s s embl anc e . La haut eur en a r r i è r e de la
surface articulaire est de 0" ' ,09, la largeur d'un bord à l'autre de 0 " , 1 6 5 , L'épaisseur ent r e le trou
neural et le i)ord inférieur est de 0' " ,04.
AXtS.
La seconde cervicale esl éga l ement bien conservée, sauf la partie supé r i eur e de l'arc neur a l et
une partie des apophys es transverses, La face ant é r i eur e nous mont r e un e apophys e odonloïde très
bien mar(]uéc et une sui'facc articulaii'e complète tout autour . Le pl anche r du trou ve r t ébr a l est
comme toujours fort l a rge et très incliné. A la face inf é r i eur e, on voil de c h a q u e coté de l ' apophys e
odontoïde une saillie de la grosseur du bout de l ' apophys e odonloïde. La lace ¡iostérieure pr é s ent e un
disque plus large que haut et tout le conlour est fort bi en ma rqué . Le trou formé par la r éunion des
deux apophys e s transverses est fort petit. Celte ve r t èbr e a une sur f a c e articulaire large de O^ j I S S
d'un bord à l'autre et haut e de 0 ' " , 0 9 8 . La face postérieure du corps, cor r e spondan t à la troisième
cervicale, large de 0"vl'I''i. et haut e de 0 ' " , 0 7 6 .
DERNiÈRES CEIWtCALES.
Nous n'avons repi'ésenté qu'un e seule cervicale, pl anche XLVI l , figures 1 - 3 ; elle mont r e la
:'geur du trou vertébral, r ext cns ion du corps de la ve r t èbr e en h a u t e u r aux dépens de la l a rgeur
el la direction dos apopiiyses transverses inférieures . Cette
région à laquelle elle iip|)artient. Quant à ses dimensions, not
une haut eur de 0 " ' , 0 9 2 et une épa i s s eur de 0 " ' , 0 2 2 .
vertèbre a tous les caracières de la
; lui trouvons une l a rgeur de \ 0,
fîEtitON l)Ot\SAt.E.
COLONNE V E R Ï K B I U L E .
Le Musée royal possède plusieurs colonnes ve r t ébr a l e s plus ou moins complètes et dans
lesquelles toutes les régions sont bien représentées.
HEGtON CERVtC.VLE.
Cette région est sur tout intéressante p a r les deux pr emi è r es cervicales.
ATLAS.
On t rouve r a r eme n t des ve r t èbr e s aussi complètes que i'atlas qui a été mis au j o u r . A la face
antérieure, nous voyons les deux surfaces articulaires cor r e spondan t aux condyles , avec leur contour
La ve r t ebr e dorsale, que nous avons figurée, appa r t i ent au milieu de la région, c omme on peut le
voir par sa face inféi i eure qui n'est point c r eus ée en selle c omme dans d'aut re s régions. On voit
une forte dépression sur le còlè au pied du pédicule qui f o rme l'arc neur a l . Les vertèbre s dorsales,
depuis la pr emi è r e jusqu' à la linitième, portent des facettes articulaires bien ma rqué e s pour ies
côtes; ces facettes diniinuent iiisensiblemciit d' é t endue d' avant en arrière.
Une ve r t èbr e de celte région est iiguréc pl anche XLVl l l , figure, I, vue de f a c e ; elle mo n t r e de
combien le trou vertébral s'est l'étréci, c omme n t l'apophys e t r ansve r s e pr end naissanc e sur le
[lédicule de l'arc neural el comment le corps s'étend en haut eur aux d é p e n s de la l a rgeur . Le corps
de cette dorsale (7<') mesni'c en haut eur 0'",()9, en l a rgeur en longueur ü " ' , 0 8 7 .
Au .Musée de Stut tgart nous avons trouvé un e ve r t èbr e en tout s embl abl e à celle que nous
décrivons ici el (|ui )>rovienl de la mollasse ma r i n e supé r i eur e d'Obe r s c lnva lben. C'est d a n s ce