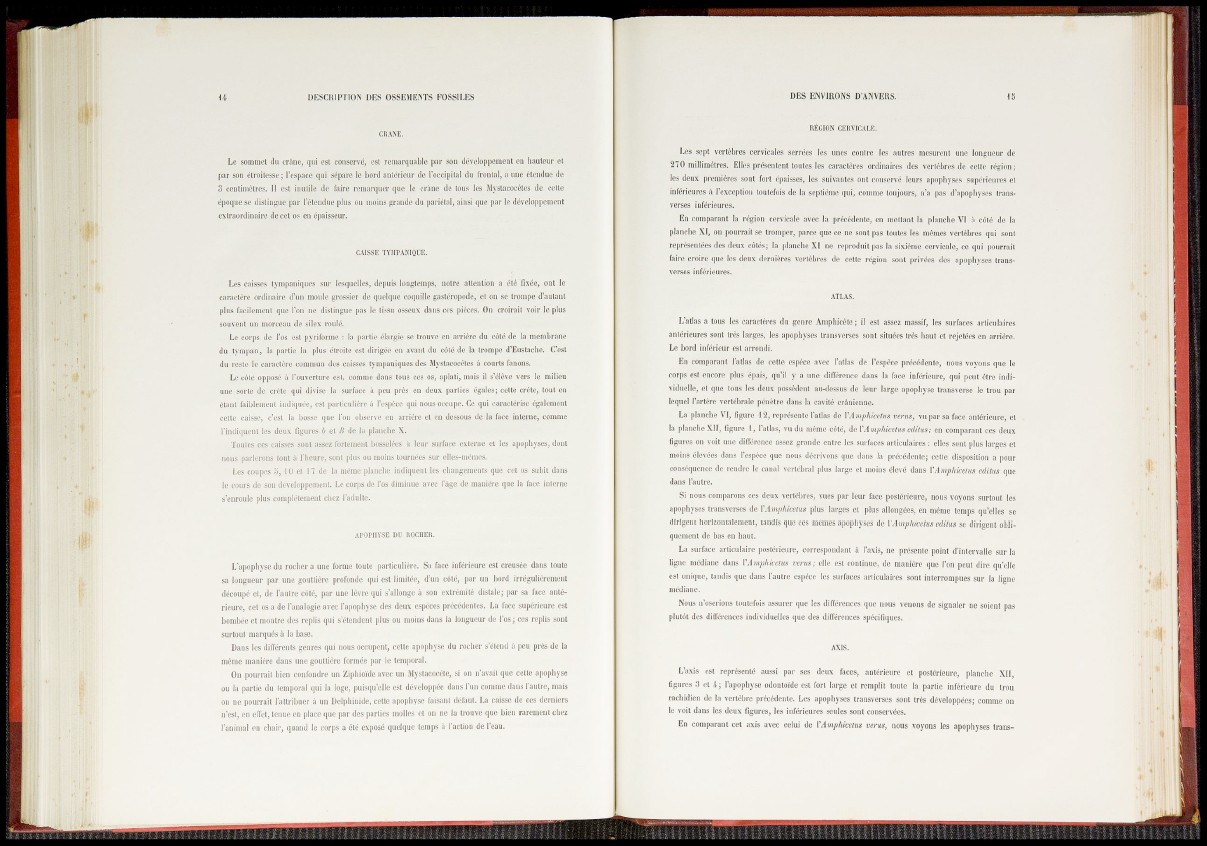
Ijí!
Le somme t du c r âne , qui est conservé, est r ema rquabl e par son déve loppement en haut eur et
par son é l roi l e s s e ; l'espace qui sépare le bord ant é r i eur de l'occipita! du frontal, a un e é t endue de
3 centimètres. Il est Inulile de faire r ema r q u e r que le c r â n e de tous les Mystacocétes de celte
époque se distingue par l'étendue plus on moins g r a n d e du pariétal, ainsi que par le déve loppement
extraordinaire de cet os en épaisseur.
CAISSE TYMP.ySIQUE.
Les caisses t ymp a n i q u e s sur lesquelles, depui s longtemps, not r e attention a été fixée, ont le
caractère ordinair e d'un moul e grossier de que lque coquille gastéropode, et on se t rompe d'autant
plus facilement que l'on ne distingue pas le tiisu osseux dans ces pièces. On croirait voir le plus
souvent un morceau de silex roulé.
Le corps de l'os est pyr i forme : la partie élargie se trouve en arrièr e du côté de la memb r a n e
du t ymp a n , la partie la |)lus étroite est dirigée en avant du coté de ia t rompe d'Eus t a che . C'est
du r e s l e le c a r a c t è r e c ommu n des caisses tympanique s des Mystacocétes à courts fanons.
Le còte opposé à l 'ouve r tur e est, comme dans tous ces os, aplati, ma i s il s'élève vei-s le milieu
une sorte de crete qui divise la surface à peu près en deux parlies égales; cette crête, tout en
étant faiblement indiqué e , est particulière à l'espèce qui nous occupe. Ce qui caractérise éga l ement
cette caisse, c'est la bosse que l'on obs e rve en arrière et en dessous de la face int e rne , c omme
l'indiquent les deux figures b ei R de la pianelle X.
Toutes ces caisses sont assez fortement bosselées à leur surface ext e rne et les apophys e s, dont
nous |)arlerons tout à Tlieure, sont plus ou moins tournées sur elles-mêmes.
Les coupes ii, 10 et IT de la même pl anche indiquent les c h a n g eme n t s que cet os subit dans
le cour s de son déve loppement . Le corjis de l'os diminue avec l'âge de mani è r e que la face inicrne
s'enroule plus complètement chez l'adulte.
APOPHYSE DU ROCHER.
L'apophvse du roche r a une forme toute particulière. Sa face inf é r i eur e est c r eus ée dans toute
sa longueur par un e gouttière profonde qui est limitée, d'un côté, par un hord i r r égul i è r ement
découpé et, de l'aulre côté, par une lèvre qui s'allonge à son ext r émi t é distale; par sa face ant é -
rieure, cet os a de l'analogie avec l'apophys e des deux espèces pr é c édent e s. La face supé r i eur e est
bombée et mont r e des replis qui s ' é t endent plus ou moins dans la longueur de l'os ; ces replis sont
surtout ma r q u e s à ia base.
Dans les différents g e n r e s qui nous occupent, cette apophys e du roche r s'étend à peu prés de la
même mani è r e dans un e gouttière formé e par le t empor a l.
On pourrait bien confondre un Ziphioïde avec un Mystacocète, si on n'avail que cette apophys e
ou la partie du temporal qui la loge, puisqu'elle est déve loppé e dans l'un c omme dans l'auli'e, ma i s
on ne pourrait l'attribuer à un Delphinide, cette apophys e faisant défaut. La caisse de ces de rni e r s
n'est, en elTct, tenue en place que par des parties molles et on ne la t rouve que bien r a r emen t chez
J'animai en ciiair, quand le corps a été exposé que lque t emps à l'action de l'eau.
DES EINVIRONS D'ANVERS.
REGION CERVICALE.
15
Les sept vertèbres cervicales s er rée s les une s contre les autres me sur ent une longueur de
2 7 0 millimètres. Elles pr é s ent ent toutes les caractères ordinaires des ve r t èbr e s de cette r égion ;
les deux premi ères sont fort épaisses, les suivantes ont conservé leurs apophys e s supé r i eur e s et
inférieures f^i l'exception toutefois de la sepliéme qui, c omme toujour s , n'a pas d' apophys e s transverses
inférieures .
En c omp a r a n t la région cervicale avec la précédente, en me t t ant (a pl anche VI à côte de la
planche XI, on pourrait se t rompe r , parce que ce ne sont pas toutes les mômes vertèbre s qui sont
représentées des deux côtés; la [ilanche XI ne reproduit pas la sixième cervicale, ce qui pourrait
faire croire que les deux dernière s vertèbre s de cette région sont privées des a p o p h y s e s t r ans -
verses inférieures.
L'atlas a tous les caractères du g e n r e Amp h i c ô t e ; il est assez massif, les surfaces articulaires
antérieures sont très larges, les apophys e s transversos sont situées très haut et r e j c l é es en a r r i è r e .
Le bord inférieur est a r rondi .
En compa r ant l'atlas de cette espèce avec l'atlas de l'espèce pr é c édent e , nous voyons que le
corps est encore plus épais, qu'il y a une différence dans la face inférieure, qui peut être indi -
viduelle, et que tous les deux possèdent au-dessus de l eur large apophys e t r ansve r s e le t rou par
lequel l'artère ver t ébrale p é n é t r e dans la cavité c r âni enne .
La pl anche Vi , figure 12, r epr é s ent e l'atlas de VAmphicetus venis, v n p a r s a face ant é r i eur e , et
la pl anche XII, figure 1, l'atlas, vu du môme côté, do VAmphicaliis edilux; en c omp a r a n t ces deux
figures on voit une différence assez g r a n d e ent r e les surfaces articulaires : elles sont plus larges et
moins élevées dans l'espèce que nous décrivons que dans la pr é c édent e ; cette disposition a pour
conséquence de r e n d r e le canal vertébral plus large et moins élevé dans VAmp/nceius edilus que
dans l'autre.
Si nous compa rons ces deux vertèbres, vues par l eur face pos t é r i eur e , nous voyons sur tout les
apophyses transverses de VAmphicetus plus larges et plus allongées, en même t emps qu'elles se
dirigent hor i zont al ement , tandis que ces même s apophys e s de VAmphicetus edilus se dirigent obliquement
de bas en h a u t .
La sur f a c e articulaire postéi'ieure, cor r e spondant à l'axis, ne pr é s ent e point d'intervalle sur la
ligne médi ane dans VAmpIticeliis vcnis; elle est continue, de mani è r e que l'on peut dire qu'elle
est unique, tandis que dans l'autre espèce les surfaces articulaires sont i n t e r r omp u e s sur la l igne
médiane.
Nous n'oserions toutefois assurer que les dilTérences qu e nous venons de signaler ne soient pas
plutôt des diiïércnccs individuelles que des différences spécifiques.
L'axis est représ ent é aussi pa r ses deux faces, ant é r i eur e et postérieure, pl anche XI I ,
figures 3 et i ; l'apophys e odontoïde est fort large et r empl i t toute ia partie inf é r i eur e du trou
racliidien de la ve r t èbr e précédente. Les apophys es t r ansve r s e s sont très déve loppé e s ; c omme on
le voit dans les deux figures, les inférieures seules sont conservées.
En c omp a r a n t cet axis avec celui de VAmphicelîis vents, nous voyons les apophys e s t r a n s -
• .i