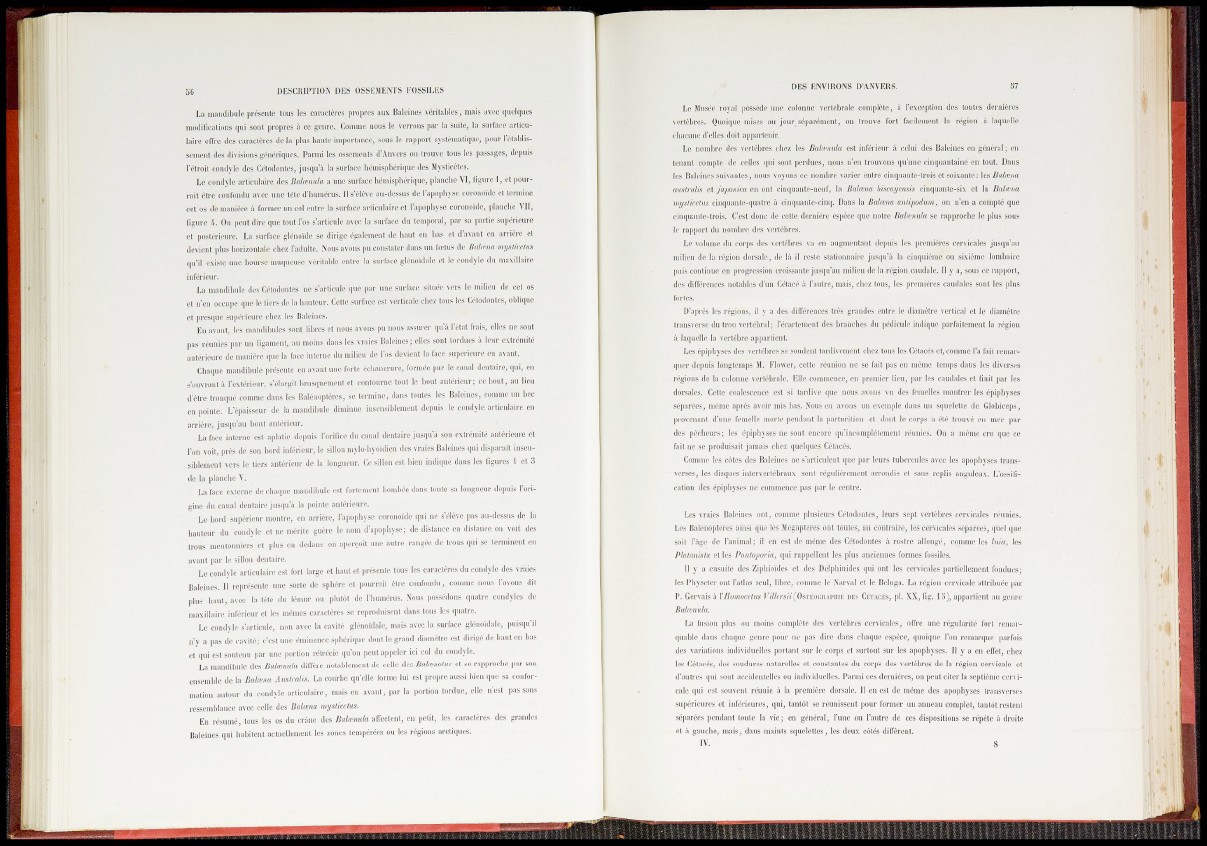
I T I ]
Í I T '
; . 'l'i
^G DESCUIPTION DES OSSEMEÎSTS I -OSSILES
La nuMidibule préseiile tous les caractères propr e s aux Ouleines vé r i t abl e s , ma i s avec tiiielquos
1110(1 ili cal ions qui soiil propr e s à ce genre. Comine nous ]e ve r rons par la suite, la surface a r l i culaire
c i ï r e des caraclères d e l à plus h a u l e iniporlance, sous le r appor t systoinalique, pour Iclablis -
senient des divisions géné r ique s . Pa rmi les ossements d'Anve r s on Irouve tous les passages, depuis
l'élroil condyl e des Cctodoiites, jusqu' à la sui'l'ace liémisplioriqiie des Myslicètes.
Le condyl e articulaire des Bulwnula a une surl'ace liéniispliérique, planclie VI, ligure 1, et pour -
ipophyse coronoïde el termine
i l n s e coronoïdo, |)lanclie VII,
loral, par su partie supé r i eur e
bas el d' avant en arrièr e el
Il [(rtus de Buloena myslkctus
loïdale et le condyl e du maxillaire
L'e b o u t .
rait ótre confondu avec un e tète d'humé rus . Il s'élève au-dessus d
cet os de mani è r e à forme r un col ent r e la sur f a c e ai'ticulaire et 1':
ligure i . On peut dire que tout J'os s'articule avec la sur f a c e du t
et posléricure. La sur f a c e glenoide se dirige égalemeiil de baut
devient plus liorizonlale chez l'adulto. .Nous avons jui constater dui
qu'il existe une bour s e mu q u e u s e véritable eni r e la sur f a c e
inférieur.
La mandibul e des Cétodontes ne s'articule que par une surface située v e r s le milieu de cet os
el n'en occupe que le tiers de la baut eur . Cette surface est verticale cbez tous les Célodontes, oblique
et pr e sque supé r i eur e cbez les Baleines.
En avant , les mandi bul e s sont libres et nous avons pu nous assurer qu'à l'état frais, elles ne sont
pas r é u n i e s par un ligament, au moins dans les vi'aies Baleines; elles sont lordues à leur extrémité
antérieure de mani è r e que la face interne du milieu de l'os devient la face supé r i eure en avant.
Chaque mandibul e présente en avant un e forte écliancrure, formé e par le canal dentaire, q
s'ouvrant à l'extérieiu', s'élargit b r u s q u eme n t et contourne lout le bout ant é r i eur ,
d'être tronqué comme dans les lialéiioptères, se t e rmi n e , d a n s toutes les Baleines, c
en iiointe. L'épaisseur de la mandibul e diminue ins ens ibl ement depu
arrière, j u s q u ' a u bout ani é r i eur .
La face interne est aplalie depuis Tori lice du canal dentaire jusqu' à son exU
l'on voit, prés de son bord inférieur , le sillon m\lo-!iyoïdien des vraies Oaleines qui disparaît insensiblemenl
ve rs le tiers ant é r i eur de la longueur. Ce sillon esî bien indiqué dans les ligures 1 el 3
de la p l a n c h e > .
La face cxl e rne de cliaque mandibul e est for t ement bombé e dans toiile sa longueur depuis l'origine
du canal dentaire jusfiu'à la pointe aniérieuro.
Le bord supériem- mont r e , en arrière, l'apopliyse coronoïdo qui ne s'élève pas
hauteur du c o i u h l e et ne mé r i l e guè r e le nom dapoj i l iys e ; de dislance on dislance o
irons mc i i tonni e r s et plus en dedans on aperçoi t une aut r e r angé e de t rous n
avant par le sillon dentaire .
Le cond\ le arliculaire est fort large el haut et présente tons les c a r a c l è r es du condyl e des vraies
Baleines. Il r epr é s ent e une sorte de sphè r e el p o umu t être c o n f o n d u , comme nous l'avons dil
:iut, avec la té te du f émur ou plutôt de l 'humé rus. Nous possédons q u a t r e coiulyles de
lire inf é r i eur et les même s caractères .se r eprodui s ent dans tous les quati'c.
idvie s'ai'licule, non avec la cavile glenoidale, mais avec la sur f a c e glenoidale, puis(|u'il
de cavité; c'est une éminenc e spiiérique dont le gr and di amè t r e esl dirigé de haut en bas
i col d
en
;m lieu
un bec
le c o n d \ l e arliculaire eu
nité anl é r i eure el
dessus de la
t des
se t e rminent en
pins
d e .
Le et
n'y a i);i
et qui est soulenu |)ar une portion ¡élvéàv. qu'on peut u p |
La mandibul e des Baioenulu diffère iiotablement de celle des naiwuolus cl se r approche par soi
ensemble de la Ba(oe:m Auslntlà. La courbe (|u'ellc forme lui est propre aussi bien que sa co.ifor
mation autour du condyl e a r t i c u l a i r e , ma i s en a v a n t , |)ar la portion t o r d u e , elle n'est passali;
ressemblance avec celle des lialoena myslicclus.
En r é s umé , tous les os du crime des liakcniih
Baleines qui habi t ent actuellement les zones temp
affccteiil, eu pelil, les c a r a c t è r es des grande,
•ées ou les régions arctiques.
DES ENVIRONS D'ANVERS. 57
Le Musée royal possède une colonne vertébrale compl è t e , à l'exception des toutes dernière s
\ertèbres. Quoique mises au j o u r s épa r ément , on Irouve fort facilemenl la région à laquelle
chacune d'elles doit apparlciiir.
Le n omb r e des verlébre s chez les Bula-nula est inférieur à celui des Baleines eu g é n é r a l ; en
tenant compt e de celles (|ui sont pe rdue s , nous n'en trouvons qu'un e c inquanl a ine en tout. Da n s
les Baleines s u i v a n t e s , nous voyons ce n omb r e varier ent r e cinquante-trois cl soixanle ; les BaUnna
amlrulis et japónica en ont c inquant e -neuf , la Baloena biscaijensis cinquante-six el la Buioeiia
mysiirelHS c inquant e -qua t r e à cinquant e-cinq. Dans la Bulwna uHli'¡)odum, on n'en a compt é que
cinquanle-trois. C'est donc de cette de rni è r e espèce que not r e Balwmila se r approch e le plus sous
le r appor t du n omb r e dos vertèbres.
Le volume du corps des vertèbres va en a u gme n t a n t depuis les premi ères cervicales jusqu' a u
milieu de la région dor s a l e, de là il reste stationnaire jusqu' à la cinqui ème ou sixième lomba i r e
puis conlinue en progression croissante jusiju'au milieu de la région caudale. 11 y a, sous ce r appor t ,
des dilférences notables d'un Célacé à l'autre, mais, chez tous, les premi ères caudales sont les plus
fortes.
D'après les régions, il y a des diiTéreuces très g r a n d e s ent r e le diamètre vertical cl le di amè t r e
transverse du Iron ve r t ébr a l ; r é c a r t eme n l des br anche s du |>édicule indique pa r f a i t ement la région
à laquelle la verlèbre a|)parlicnl.
Les épiphys es des vertèbres se soudent tardivement chez tous les Cétacés e l , c omme l'a l'ail r ema r -
quer depuis longt emps M. Flowe r , cette réunion ne se fait pas en même temps dans les diverses
régions de la colonne \ e r t éhr a l e . Elle commenc e , en premier lieu, par les cautlales et (init pai' les
dorsales. Celle coalescence esl si (ardive que nous avons vu des femelles mont r e r les épipiiyses
séparées, même après avoir mis bas. Nous en avons un exemple dans un squelelte de í í lobi c cps ,
provenant d'une femelle mor t e pendant la parturition el dont le corps a été trouvé en me r par
des p ê c h e u r s ; les épiphys e s ne sont encore qu' incompl èt ement l'éunics. On a même cru (|ue ce
fait ne se produisait j ama i s chez ([uelques Cétacés.
Comme les côtes des Baleines ne s'articulent que par leurs tube r cul e s avec les apophys e s Iraiisverses,
les disques inl e rve r l ébr aux sont r égul i è r ement a r rondi s et s ans replis angul eux. L'ossilication
des épiphys es ne commenc e pas par le centre.
Les vraies Baleines o n t , c omme plusieurs Cétodontes, leurs sept vertèbre s cervicales réunies.
Les Balénoptères ainsi que les Méga|)lcres ont toutes, au contraire, les cervicales séparées, quel que
soit l'âge de l ' anima l ; il en est de même des Cétodontes à rostre a l longé , c omme les hua, les
Platanisla el les Ponioporia, qui rappellent les plus anci ennes forme s fossiles.
Il y a ensuite des Zipliioïdes et dos Dolphinide s qui ont les cervicales partiellement fondue s ;
les Pbys e t e r ont l'atlas seul, libre, c omme le Narval el le Beluga. La région cervicale a t t r ibué e [lar
P. Gervais à Vllomocotus r///«'s//(OsïÉOGriAi>ini; des Cé t a c i í s, pl. XX, fig. lîJ), a))parlient au g e n r e
Balamulu.
La fusion plus ou moins complète dos ve r t èbr e s cervi cal es , offre une régularité fort r ema r -
quable ilans chaque g e n r e pour ne pas dire dans chaque espèce, quoique l'on r ema r q u e parfois
des variations individuelles portant sur le corps ot surtout sur les apophys e s . Il y a eu eiïel, chez
les Cétacés, des soudures nalurelles et conslantes du corps des vertèbre s de la région cervicale et
d'autres qui sont accidentelles ou individuelles. Pa rmi ces dernières, on peut citer la seplième cervicale
(|ui est souvent r éuni e à la pr emi è r e dorsale. Il en est de môme des apophys e s transverses
supérieures et inférieures , qui, tantôt se r éuni s s ent pour forme r un anne a u complet, tantôt resleiit
s('parées pendant toute la v i e ; en géné r a l , l'une ou l'autre de ces dispositions se répète à droite
et à g a u c h e , ma i s , dans ma iul s sque l e t t e s , les deux côtés diffèrent.
IV.