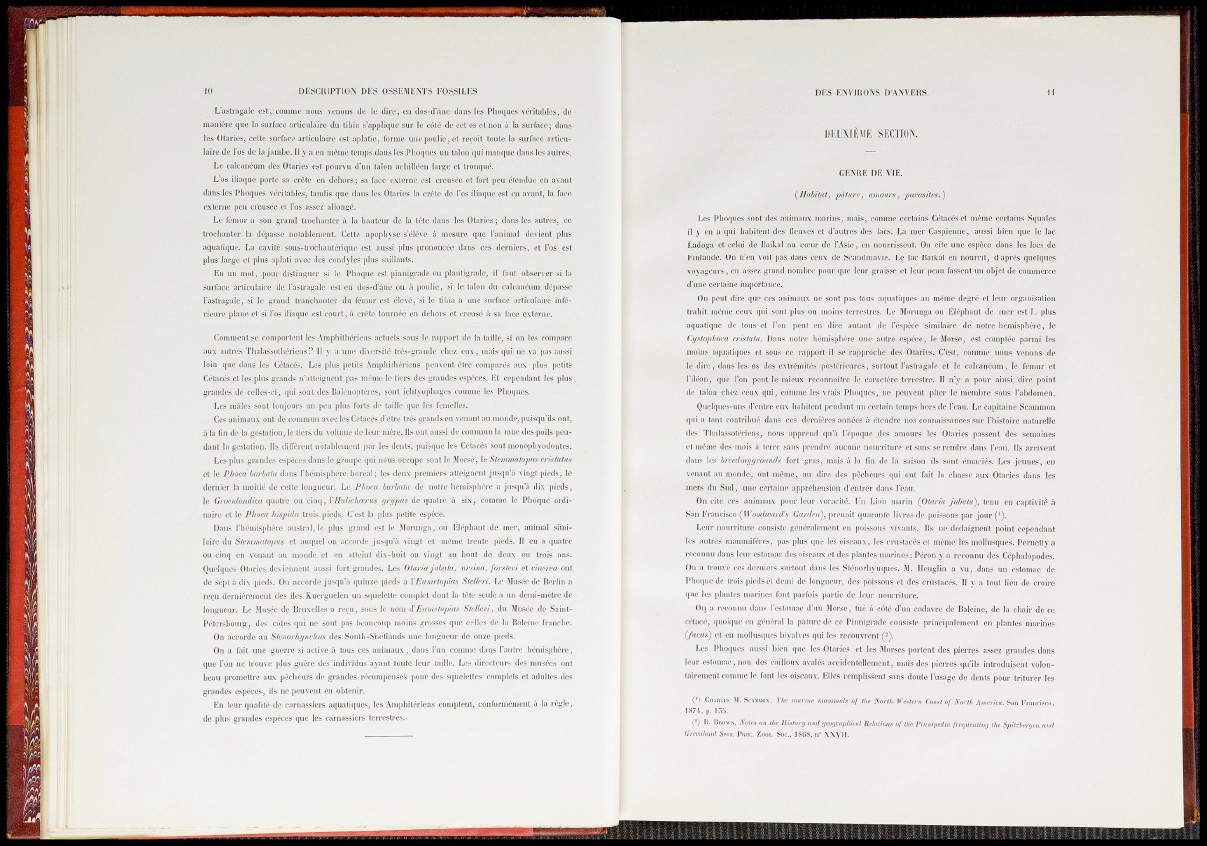
10 DESCKlPTlüxN DES OSSEMENTS FOSSILES DES ENVIKONS D'ANVERS.
L'astragale est, comme nous Y C I I O D S de le di r e , en dos-d'àne clans les Phoques vôrilables, de
manière cjue la surface avliculaire du libia s'appli([ue sur le côté do cet os cl non à la surface; clans
les Otaries, cette surface articulaire est aplatie, forme une poulie, et reçoit toute, la surface articulaire
do l'os de la j\uubc. Il y a en même temps dans les l'Iioqucs un talon c|ui manque dans les autres.
Le calcanéum des Otaries est pourvu d'un talon acliilléen large et tronqué.
L'os ilia({i.ic porte sa crête en dehor s ; sa face externe est creusée et fort peu étendue en avant
dans les Phoque s véritables, tandis que dans les Otaries la crête do l'os iliaque est en avant, la face
externe peu creusée et l'os assez allouifé.
Le fémur a sou grand trochanter à la haut eur de la tète dans les Ot a r i e s ; dans les autres, ce
trochanter la dépasse notablement. Cette apophyse s'élève à mesure que l'animal devient plus
aquatique. La cavité sous-trochantérique est aussi plus prononcée dans ces de rni e r s , et l'os est
plus large et plus aplati avec des c o n d j l e s plus saillants.
En un mot , pour distinguer si le Phoque est pinnigrade ou plantigrade, il faut observer si la
surface articulaii'e do Taslragale est en dos-d'ânc ou à poulie, si le talon du calcanéum dépasse
l'astragale, si le grand traaeluuiter du fémur est élevé, si le tibia a une surface articulaire inlorienrc
plane et si l'os iliaque est coui't, à crête tournée en deliors et creusé à sa face externe.
Comment se comportent les Amphithériens actuels sous le rap|)ort de la taille, si on les conqtare
aux autres Tha l a s sothé r i ens? Il y a une diversité très-grande chez e u x , mais qui ne va pas aussi
loin que dans les Cétacés. Les plus petits Amphithériens peuvent être comparés aux plus petits
Cétacés et les plus grands n'atteignent pas mvmc le tiers des grandes espèces. El cependant les plus
grandes de celles-ci, qui sont des Balénoptères, sont ichtyophagcs comme les Pin)ques.
Les maies sont toujours un peu plus forts de taille que les femelles.
Ces animaux ont de commun avec les Cétacés d'être très grands en venant au monde, puisqu'ils ont,
à la fm de la gestation, le tiers du volume de leur jnère. Ils ont aussi de commun la unu; des poils pendant
la gestation. Ils dilTérent notablement par les dents, puisque les Cétacés sont monopbyodcmtcs.
Les plus grandes espèces dans le groupe qui nous occupe sont le Morse, le Slcmmatopns crtsiuliis
et le Phoca barbuiu dans l'hémisphère boréal; les deux premiers atleignent jusqu'à vingt pieds, le
dernier la moitié de cette longueur. Le PItoca barbala de notre hémisphère a jusqu'à dix pi eds ,
le Groenlandica quatre ou c inq, \'Ilalichoenis [/ri/pus de quatre à s ix, comme le Phoque ordinaire
et le Phoca hispida trois pieds. C'est la plus petite espèce.
Dans riiémisj)hère ausiral, le plus grand est le Morunga , ou lilléphant de mer, animal similaire
du Slcmmatopus et aut|uel on accorde jusqu'à vingt et même trente [lieds. Il en a (juatre
ou cinq en venant au monde et en atteiiit dix-huit ou vingt au bout de deux ou trois ans.
Quelques Otaries deviennent aussi foi't grandes. Les Olariu jiibala, ursina, forsleri et cinnea ont
de sept à dix pieds, On accorde jusqu'à quinze pieds à Vlumtelopius Sieilcri. Le Musée de Berlin a
leçu dernièrement des iles Kuei'guelen un sciueiette complet dont ia tète seule a un demi-mètre de
longueur. Le Musée de Bruxelles a r e çu, sous le nom iVEainfiiop/as SlcUcri, du Musée de Saint-
Pétersbourg, des côtes qui ne sont pas l)eauc'0up moins grosses que celles de la Btileine franche.
On accorde au Stcnorhyacltun des Soutli-Sinitlands une longueur de onze pieds.
On a fait une gue r r e si active à tous ces a n ima u x , dans l'un comme dans l'autre liémisph(;ro,
que Ton ne trouve plus guère des individus ayant toute leur taille. Les directeurs des tnusées ont
beau promettre aux pécheurs de grandes ]'écompenses pour des squelettes complets et adultes des
grandes espèces, ils ne peuvent en obtenir.
En leur qualité de carnassiers aquaiiques, les Amphitériens comptent, conforméjnent à la règle,
de plus grandes espèces que les carnassiers terrestres.
i ) K l l X I È \ IE SECTlOiS.
GENRE DE VIE.
[Habitat, pâture, amourx, parasites.)
Les Phoques sont des animaux marins, mais, comme certains Cétacés et même certains Squales
il y en a c[ui habitent des lleuves et d'autres des lacs. La me r Caspienne, aussi bien que le lac
Ladoga et celui de Baikal au ccrur de l'Asie, en nourrissent. Ou cite une espèce dans les lacs de
Finlande. On n'en voit pas dans ceux de Scandinavie. Le lac Baikal en nour r i t , d'après quekpies
voyageui'S, en assez grand nombre pour que lem- graisse et leur peau fassent un objet de commerce
d'une certaine importance.
On peut dire que ces animaux ne sont pas tous aquati(]ucs au même degré et hun- oi-ganisation
trahit même ceux qui sont plus ou moins terrestres. Le Morunga ou Eléphant de me r est L plus
aquatique de tous et l'on peut en dire autant de l'espèce similaire de notre hémi sphè r e , le
Cystophora cristuia. Dans notre hcmisphère une autre espèce, le Morse, est comptée parmi les
moins aquatiques et sous ce rapport il se rapproche des Otaries. C'est, comme nous venons de
le di r e , dans les os des extrémités postérieures, surtout l'astragale et le c a l c anéum, le f émur et
l'iléon, que l'on peut le mieux reconnaître le caractère terrestre. Il n'y a pour ainsi dire point
(le talon chez ceux qui , comme les vrais Phoque s , ne peuvent plier le memb r e sous l'abdomen.
Quelques-uns d'entre eux habitent pendant un certain temps hors de l'eau. Le capitaine Scammon
qui a tant contribué dans ces dernières années à étendre nos connaissances sur l'histoire naturelle
des ïha l a s sot é r i ens , nous apprend qu'à l'époque des amours les Otaries passent des semaines
et même des mois à terre sans prendre aucune nourriture et sans se r endr e dans l'eau. Ils arrivent
dans les brepdhujgroiinds fort gras , mais à la lin de la saison ils sont émaciés. Les j e une s , en
venant au monde , ont même , au dire des pêcheurs qui ont fait la ciiasse aux Otaries dans les
mers du Su d , une certaine appréhension d'enti'er dans l'eau.
On cite ces animaux pour leur voracité. Un Lion marin (Otaria jubata), tenu en captivité à
San Francisco [Woodward's Garden), ¡ircnait quaratiie livres de poissons par jour
Leur nourriture consiste généralement en poissons vivants. Ils ne dédaignent point cependant
lc>s autres mammifères, pas plus que les oiseaux, les crusiacés et même les mollusques. Pernet ty a
i-econnu dans leur estomac dos oiseaux et des plantes ma r ine s ; Pérou y a reconnu des Céphalopodes.
On a trouvé ces derniers surtout dans les Sténorbynques. M. Ileuglin a v u , dans un estomac de
Pho(iue de ti'ois pieds et demi de longueur, des poissons et d((s crustacés. Il y a tout lieu de croire
que les plantes marines l'ont pai-fois partie de leur nourriture.
On, a reconnu dans Pestomac d'un Morse, tué à côté d'un cadavre de Baleine, de la chair de ce
cétacé, quoique en général la pâture do ce Pinnigrade consiste ])rincipalcment en plantes marines
{fitcui) et on mollusques bivalves qui les recouvrent (-).
Los Phoques aussi bien que les Otaries et les Morses portent des pierres assez gr ande s dans
leur estomac, non des cailloux avalés accidentellement, mais des pierres qu'ils introduisent volontairement
comme le font les oiseaux. Elles remplissent sans doute l'usage de dents pour t r i tur e r les
vKimmoh of Iho l^orlh-] Coaai of ( , ' } Cu.VRI .BS- M . SCAMMON, The North America. San l^rancisco,
1874, |). 135.
(') U. BiiowN, Notes on Ihc llistoru nml (jenrjraphind Mmions of the I'innipcdia frcquentuxj the Spitzknjm and
(h-eenla,uì Se'is. Piioc. Zooi.. Soc-, 1868, XKVII.