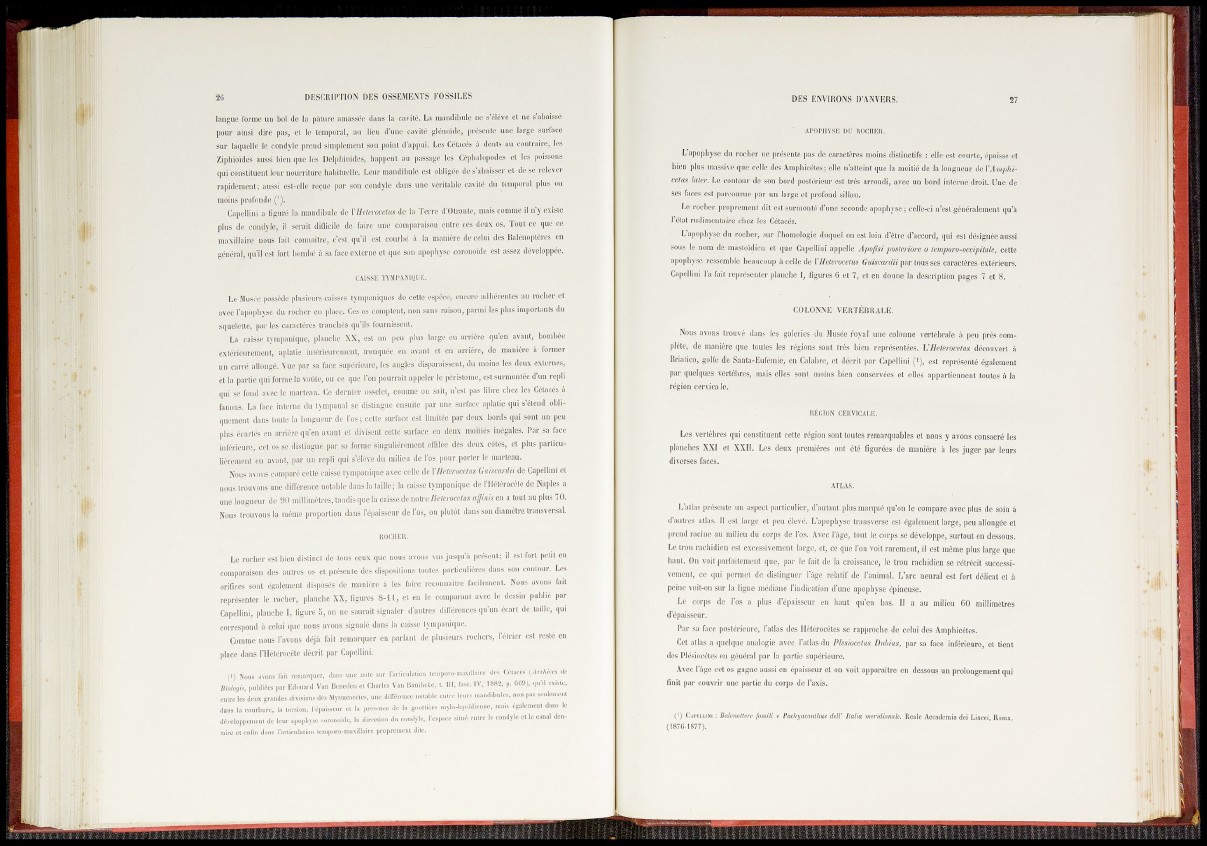
ê
1!
Ill
2(5 DKSCRIPTION DES OSSEMENTS FOS S ILES
langue forme un bol de la pâture amassée dans la cavité. La mandibul e no s'élève cl ne s'abaisse
poui' ainsi dire pas, el le t empor a l , au lieu d'une cavité glénoide, présente une large sui'l'ace
sur laquelle le condyl e prend simplement son point d'appui. Les Cétacés à dent s au conlraire, les
Ziphioïdes aussi bien (¡ue les Delphinides, happent au passage les Téplialopodes et les poissons
qui constituent lour nour r i tur e habituelle. Leur mandibul e est obligée de s'abaisser el de se relever
vapidemeul; aussi est-elle r e çue par son coiidyk- dans une véiilable cavité du temporal plus ou
moins profonde ( ' ) .
Capellioi a figuré la mandibul e de ['Ilelcrocctus de la Te r r e d'Otranto, mais c omme il n'y existe
plus do condyle, il serait dillicile de faire une comparaison entre ces deux os. Tout ce que ce
maxillaire nous fait connaitre, c'est qu'il esl courbé à la mani è r e de celui des lîalénoptères en
général, qu'il esl fort bombé à sa face ext e rne et (lue son apophys e coronoïde est assez développée.
CAISSE TV.MfAMQlE.
Le i l u s é e possède plusieurs caisses tympanique s do cette espèce, encore adhé r ent e s au roche r el
avec Tapopliyse du roche r en place. Ces os complenl, non sans raison, pai'ini les plus impor l ant s du
squelette, pai' les caractères t r anché s qu'ils Iburnissenl.
La caisse ump a n i q u e , planche XX, est un peu plus large en arriér e qu' en avant, bombé e
extérieurement, aplatie int é r i eur ement , t ronqué e en avant el en arrière , de mani è re à forme r
un carré allongé. \ ' u e par sa face supé r i eur e , ¡es angles disparaissent, du moins les deux externes,
et la partie (|ui l'ormcla voûte, ou ce que l'on pourrait appeler le péristome, est surmont é e d'un ropii
qui se fond avec le ma r l e au. Ce d e r n i e r osselet, comme on sail, n'est pas libre chez les Cétacés à
fanons. La face inlerne du txmpana l se distingue ensuite par une surface aplatie qui s'étend obliquement
dans tdule la longueur de l 'os ; cette surface est limitée par deux ijords qui sonl un peu
plus écartés on arrière qu'en avant et divisenl cette sur l a ce en deux moitiés inégales. Pa r sa face
inférieure, cet os se distingue par sa forme singulièrement eililée des deux côtés, et plus pa r t i culièrement
en a \ a n t , par un repli qui s'élève du milieu de l'os |)Our por t er le ma r t e au.
Nous a\()ns com|)aré cette caisse tympanique avec celle de Vllclerocehis Ciuscardii de Capellini cl
1.0iis trouvons un e différence notnble dans la taille; la caisse t ymp a n i q u e de l'ilétérocète de Naples a
une longueur de 90 millimètres, tandis que la caisse de n o t r e Hetcrocelus en a tout au plus 7 0 .
Nous t rouvons la même proportion dans l'épaisseur de l'os, ou plutôt da
liUCHIiK.
diamètre transversal.
Le rocher est bien distinct de tous ceux que nous avons vus jusqu' à pr é s ent ; il est fort petit en
comparaison des aut r e s os el présente des dispositions loules particulières dans son contour. Los
orifices sont également disposés de mani è r e à les faire reconnaili'o facilement. Nous avons fait
représenter le rochei', pl anche XX, figures 8 - M , el en le comparant avec le dessin publié par
Capellini, pl anche 1, ligure S, on ne saurait signaler d' aut r e s diiïérences (|u'un écart de taille, qui
correspond à celui que nous avons signalé dans la caisse tynq.aniquo.
Comme nous l'avons dé j à fail r ema r q u e r en parlant de plusieuis rocliers, l'étrier esl resté en
place dans l'ilétérocète décrit par Capellini.
(I) Nous nvons fail remni'c|uer, ilai
Biologie, publiées par Kdoiiard Van
emrr les doux grande.s divisions des
dans la courbure, la lorsioii, tepaisseï
dé^eloppeiueni .le leur ajiophysc eoron
laire el cnlln dans l'ai-ticulalion icmpoi
S une nole sur iBrticulaiioii k
neden el Charles Van Bainliekc
itaeocéies, une dilTérenee nciabl
r el la presence de hi gouiiiOi
ndc, la dirccüoii du condyle, l'i
5-maNÍIhnrc piopreniCDl dile.
tipor.i-nia\illaii-e di's Cétaeés {Ardiives de
U III, fase. IV, 1882, p, CG!)), .|uil exisic,
cnlre leurs mamlilmles, non pas seiilenieni
mxlo-liydulieiine, mais ('•galemem dans le
.uaec silué eiure lo eondyle et le CiUial den-
DES ENVIRONS D'ANVERS.
AI>OPHYSE DU ROCIIEU.
27
L'apophyse du rocher no présente pas de caractères moins dislinctifs : elle est cour t e , épaisse cl
bien plus massive que celle des Amphi c è t e s; elle n'atteint qu e la moitié de ia longueur ikWlmphicelas
later. Le contour de son bord postérieur est très a r rondi, ave c un bord int e rne droit. Une de
ses faces est pa r courue ))ar un large et profond sillon.
Le rocher p r o p r eme n t dit est surmont é d'une seconde apophys e ; celle-ci n'est géné r a l ement (¡u'à
l'état rudiment a i r e chez les Cétacés.
L'apophyse du roche r , sur l'homologie duquel on esl loin d'être d'accord, qui est désignée aussi
sous le nom de mastoïdien et que Capellini appelle Apofisi posteriore o lemporo-occipilale, cette
apophyse ressembl e be aucoup à celle de Vlleierocelus Gniscurdii t o u s s e s caractères extérieurs.
Capellini l'a fait r epr é s ent e r pl anche I, figures G et 7, et en d o n n e la description pages 7 et 8.
COLONNE VERTÉBKALE.
Nous avons trouvé dans les galeries du .Musée roya l une colonne ver t ébrale à jieu prés complète,
de mani è r e que toutes les régions sont très bien r epr é s ent é e s . Ilclevocetiis dé couve r t à
Rriatico, golfe do Sant a -Euf emi e , en Calabre, et décrit par Capellini ( ' ) , est r epr é s ent é éga l ement
par quelques vertèbres, mais elles sont moins bien conservées et elles a p p a r t i e n n e n t toutes à la
région c e rvi c a l e .
RÉGION CERVICALE.
Les vertèbres qui constituent cette région sont loules r ema rquabl e s el nous y avons consacré les
planches XXI et XXI I . Les deux premières ont été figurées de mani è r e à les j u g e r par leurs
diverses faces.
ATLAS.
L'allas pr é s ent e un aspect particulier, d'autant plus ma rqué qu'on le compa r e ave c plus de soin à
d'autres atlas. Il est large et peu élevé. L' apophys e t r ansve r s e est également large, peu allongée et
prend r a c ine au milieu du corps de l'os. Avec l'âge, tout le corps se développe , sur tout en dessous.
Le trou r a chidi cn est excessivement large, et, ce que l'on voit r a r eme n t , il est même plus large que
haut. On voit pa r f a i t ement que, par le fait de la croissance, le trou rachidien se rétrécit successivement,
ce qui pe rme t do distinguer l'âge relatif de l'animal. L' a r c neural est fort délicat et à
peine voit-on sur la ligne médi ane l'indication d'une apophys e épineuse.
Le corps do l'os a plus d'épaisseur en haut qu'en bas. Il a au milieu 60 millimètres
d'épaisseur.
Par sa face postérieure, l'atlas des Hétérocctes se r approche de celui des Amphi cèt es.
Cet atlas a que lque analogie avec l'atlas du Plesiocetus Diihius, par sa face inf é r i eur e, et tient
des Plésiocètes en général par la partie supé r i eur e .
Avec l'âge cet os gagne aussi en épaisseur et on voit apparaî t re en dessous un prolongemen t qui
finit par c
(') (MPKLim
(Í87C-1877).
une partie du corps de l'axis.
Balenottere fossili e Pacliyacatiihtis dell' Italia meridionale. Reale Accademia dei Lincei. K(i