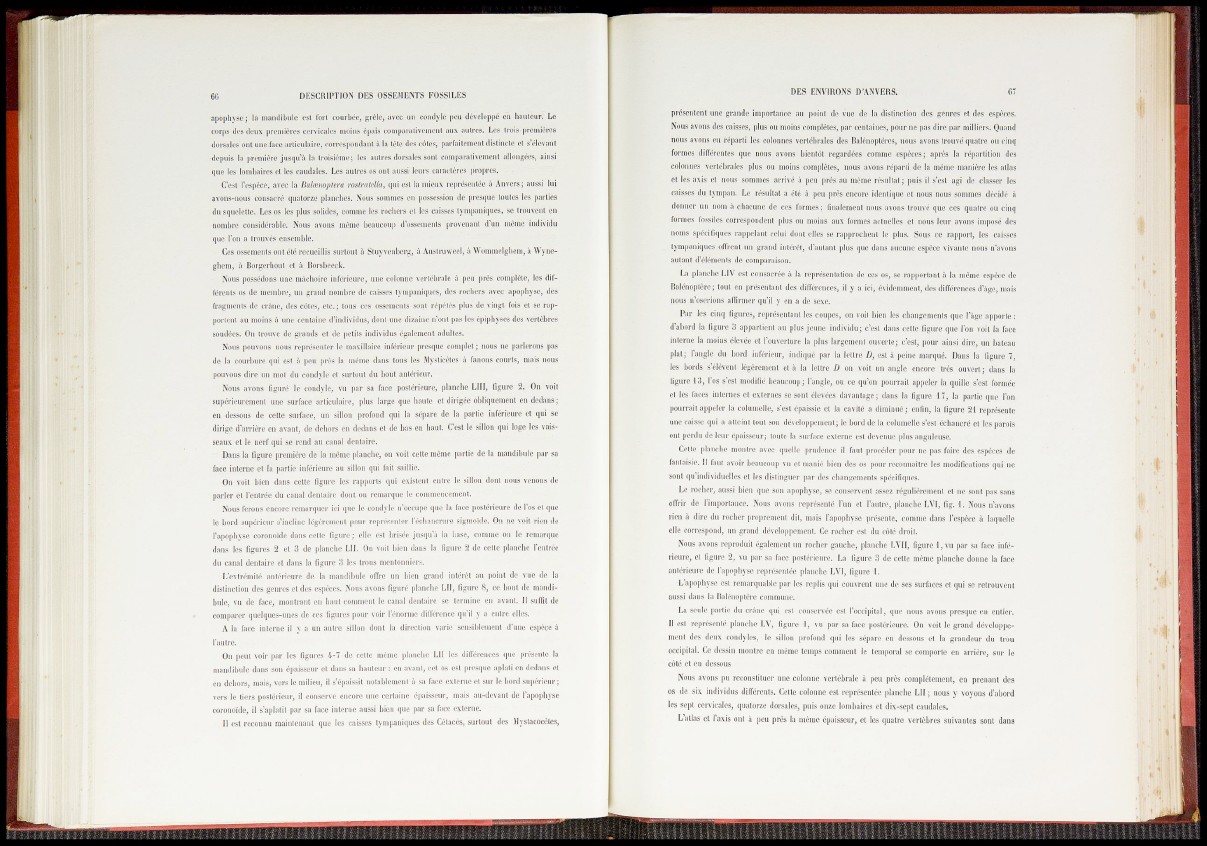
6() DESCRIPTION DES OSSEMENTS FOSSILES
npophysc; ¡a mandibule esl fori courbée, f^réle, avec un condyle [¡eu développé en hauteur. Le
corps des deux premières cervicales moins épais coiiiparativemout. aux aulres. Les Irois premières
dursales ont une lace arlieulaii'e, correspondant à la tète des cèles, parla item eut distincte et s'éleviint
depuis la première jusqu'à la troisième; les auti'os dorsales sont comparalivement allongées, ainsi
que les lombaires el les caudales. Les autres os oui aussi leurs caractères propres.
C'est l'espèce, avec la Ualoenopiera roslvalella, i]ui est la mieux l'epréseulée à Anvers; aussi lui
avons-nous consacré quatorze planches. Xous sommes en possession de presque toutes les parties
du squelette. Les os les plus solides, comme les rochers et les caisses tynipaniques, se Irouvcnl en
nombre considérable. Nous avons même beaucoup d'ossenieuts provenant d'un même indis idu
que l'on a trouves ensemble.
Ces ossemenis oui été recueillis suilout à Sluyveuberg, à .Vuslruweei, à Wdimneighem, à Wynegliem,
à Borgerhout et à Rorsbeeck.
Nous possédons une niàeboire inférieure, une colonne vertébrnie à peu pi'ès complète, les différents
os de membre, un grand nombre de caisses tympaniques, des rochers avec apophyse, des
fragmenls de eràne, des côtes, etc.; tous ces osseraenls sont répétés i)lus de vingt fois et se rapporlent
au moins à une centaine d'individus, dont une dizaine n'on! pas les epiphyses des vertèbres
soudées. On irouve de grands et de petils individus également adulles.
Nous pouvons nous représenter le maxillaire inférieur presque complet ; nous ne parlerons pas
de la courbure qui est à peu près la même dans tous les Myslicètes à fanons courts, mais nous
pouvons dire un mot du condyle el surtout du bout aniérieur.
Nous avons figuré le condyle, vu par sa face postérieure, planche LUI, figure 2. On voit
supérieurement une surface articulaire, plus large que hante et dirigée obliquement en dedans;
en dessous de cette surface, im sillon profond (¡ui la sépare de la partie inférieure et qui se
dirige d'arrière en avant, de dehors en dedans et de bas en haut. C'est le sillon qui loge les vaisseaux
et le nerf qui se rond au cana! dentaire.
Dans la figure première de la même planche, on voit cette même partie de la mandibule |)ar sa
face interne el la partie inférieure au sillon qui fait saillie.
On voit bien dons celte figure les rapports qui existent entre le sillon dont nous venons de
parler et l'entrée du canal dentaire dont on remarque le commencement.
Nous ferons encore remarquer ici (pie le condyle n'occupe que la face poslérieure de l'os el que
le bord supérieur s'incline légèrenienl pour représenler l'échiincrui'e sigmoïde. On ne voit rien de
l'apopbvse coronoïde dans cette ligure; elle est iirisée jusqu'à la i;ase, connue on le remarque
dans les figures 2 et 3 de j)lanche LU, On voit bien dans In figure 2 de cette planche rentrée
du canal dentaire et dans la figure 3 les trous mcnlonniers.
L'extrémité antérieure de la maiulibulc offi'e un bien grr
distinction des genres et des espèces. Nous avons figuré planch
bule, vu de face, montrant en haut comment le canal dentair
comparer quelques-unes de ces ligures pour voir l'énonne dilfi
I inlénH au poiul de vue de la
LN, figui'e 8, ce bouf de mandise
tevuiino en avant, Il suilit de
mce (ju'il y a entre elles.
A la face inlerne il y a un autre sillon dont la direction vai'ie sensiblement d'une espèce à
l'aulre.
On peut voij' par les figures 4-7 de cetle même planche LU les diflV'rences que présenle la
mandibule dans sou épaisseur el dans sa hauteur : (;n avani, cet os est pi'osipie aplati en dedans et
en dehors, mais, vers le milieu, il s'épaissit noiableinent à sa face cxlerne el sur le bord supérieui' ;
vers le tiers postérieur, il conserve encore une certaine épaisseur, mais au-devant de l'apophyse
coronoïde, il s'aplatit par sa face interne aussi bien que par sa face externe.
1! est reconnu maintenant que les caisses tympani(|ues des Cétacés, surtout des Mystacocèles,
DES ENVIRONS D'ANVERS.
prcsenlent une grande imporlance au point de vue de la distinction des genres et des espèces.
Nous avons des caisses, plus ou moins complètes, par centaines, pour ne pas dire |)ar milliers. Quand
nous avons eu réparti les colonnes vertébrales des Balénoptères, nous avons Irouvé quati'e ou cinq
formes diU'ércnles que nous avons bientôt regardées connne espèces; après la répartition des
colonnes vertébrales plus ou moins complètes, nous avons réparti de la même manière les atlas
et les axis et nous sommes arj'ivé à peu près au même résnlial; puis il s'est agi de classer les
caisses du lympan. Le résidlat a été à peu près encore ideulique et nous nous sommes décidé à
donner uu nom à chacune de ces formes; finalement nous avons Irouvé que ces quatre ou cinq
formes fossiles correspondenl (ilus ou moins aux formes actuelles et nous leur avons imposé des
noms spécifiques rappelant celui dont elles se rapprochent le plus. Sous ce rappoi't, les caisses
tym))ani(jues oITrent un grand intéi'èt, d'aulant plus que dans aucune espèce vivante nous n'avons
aulant d'élémenis de com))araison.
La planche LIV est consaci'ée à la représentation de ces os, se rapjiortant à lu même espèce de
Ralénoplère; tout en présentant des différences, il y a ici, é\idemnienl, des dilférences d'âge, mais
nous n'oserions alTirmer qu'il y en a de sexe.
Par les cinq figures, représcnlant les coupes, on voii bien les changements que IVige apporte :
d'abord la figure 'â appartienl au plus jeune individu; c'est dans cette figure que l'on voit la face
inlerne la moins élevée el l'ouverture la plus largement ouverie; c'esl, pour ainsi dire, un bateau
plat; l'angle du bord inférieur, indiqué pai' la lettre D, est à peine niarqué. Dans la figure 7,
les bords s'élèvent légèrement et à la lettre I) on voit un angle encore très ouvert; dans la
ligure 13, l'os s'est modifié beaucoup; langie, ou ce qu'on pouirait appeler la quille s'est formée
cl les faces internes el e-xternes se sont élevées davantage; dans la figure d" , la partie que l'on
pourrait appeler la columelle, s'est épaissie el la cavité a diminué; enfin, la figure 21 représente
une caisse qui a aileint tout son développement; le bord de la columelle s'est échancré el les parois
ont perdu de leur épaisseur; toule la surface exlerne est devenue plus anguleuse.
Cetle planche montre avec quelle prudence il faut procéder pour ne pas faire des espèces de
faniaisie. II faut avoir beaucoup vu et manié bien des os pour reconnaître les modifications qui ne
sont (|u'individuelles et les distinguer par des changements spécifiques.
Le rocher, aussi bien que son apophyse, se conservent assez régulièrement el ne sont pas sans
offrir de l'imporlaiice. Nous avons représenté l'un et l'aulre, planche LVl , fig. 1. Nous n'avons
rien à dire du rocher pi'upremenl dil, mais l'apophyse présente, comme dans l'espèce à laquelle
elle correspond, un grand développement, Ce rocher esl du côté droil.
Nous a vons reproduit également un rocher gauche, planche LVII, figure 1, vu par sa face inférieure,
et iigure 2, vu pai' sa face poslérieure. La figure 3 de cetle même planche donne la face
aniérieure de l'apophyse représentée planche LVI, figure l.
L'apophyse est remai'qmd)le par les i'e|)lis qui couvrent une de ses surfaces el qui se retrouvent
aussi dans la lialénoptèro commune,
La seule partie du crâne (¡ui esl conservée es! l'occipital, que nous avons presque eu entiei'.
Il est représenté planche LV, ligure 1, ui par sa face ])0Sléricure. On voit le grand développement
des deux condyles, le sillon profond qui les sépare en dessous el la grandeur du trou
occipital. Ce dessin monti'e en même temps comment le temporal se comporte en arrière, sur le
côté el eu dessous
Nons avons pu reconstituer une colonne vertébrale à peu près complètement, en prenant des
os de six individus dilTérents. Celte colonne est représentée planche L U ; nous y voyons d'abord
les sepi cervicales, quatorze dorsales, puis onze lombaires et dix-sept caudales.
L'atlas el l'axis ont à peu près la même épaisseur, el les quati'c vertèbres suivantes sont dans