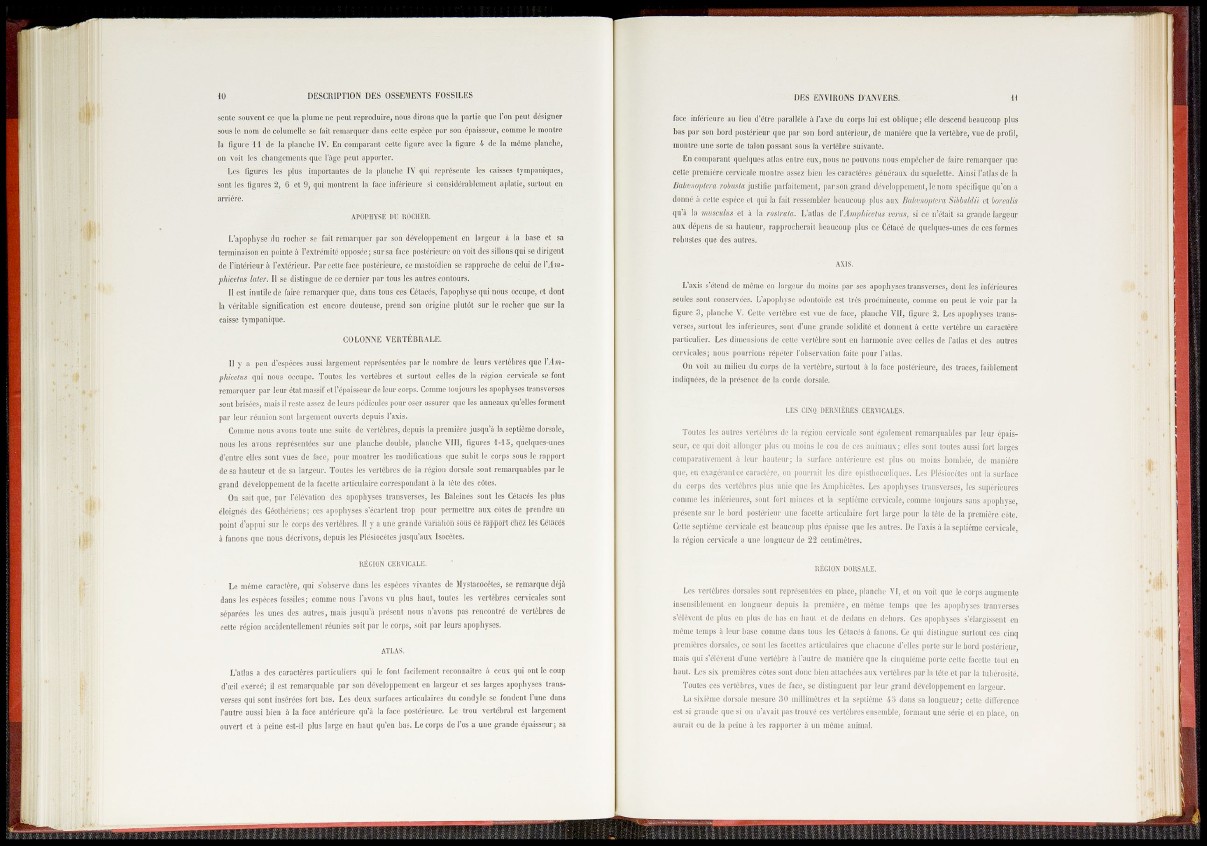
ÌO DESCRIPTION DES OSSEMENTS FOSSILES
scnle souvent ce que la p l ume ne peut r eprodui r e , nous dirons que la partie que l'on peut désigne r
sons le nom de columelle se fait r ema r q u e r dans cette espèce par son épaisseur, c omme le mont r e
la figure H de la pl anche IV. Eu compa r ant cette figure avec la figure 4 de la même planche,
on voit les c h a n g eme n l s que lïige peut appor t e r .
Les figures les plus importantes de la pl anche IV qui r epr é s ent e les caisses tympaniquc s ,
sont les figures 2, 6 et qui mont r ent la face inférieure si cons idé r abl ement aplatie, sur tout en
arrière.
APOI'IIYSE Di ; ROCHER.
L'apophyse du roche r se fait r ema r q u e r par son déve loppement en l a rgeur à la base et sa
terminaison en pointe à l'extrémité oppos é e; sur sa face postérieure on voit des sillons qui se dirigent
de l'intérieur à l'extérieur. P a r c c t i e face postérieure, ce mastoïdien se r approche de celui d e i ' / lmphiceftis
later. 11 se distingue de ce de rni e r par tous les autres contours.
Il est inutile de faire r ema r q u e r que, dans tous ces Cétacés, l'apophyse qui nous occupe, et dont
la véritable signification est encore douteuse, prend son origine plutôt sur le roche r qu e sur la
caisse t ymp a n i q u e .
COLONNE VERTÉBRALE.
11 y a peu d'espèces aussi l a rgement représentée s par le nombr e de l eur s ve r t èbr e s que l ' / l /»-
phicelxis qui nous occupe. Tout e s les vertèbre s et sur tout celles de la région cervicale se font
remarquer par lem- étatmassi f et l'épaisseur de leur corps. Comme toujours les apophys es transverses
sont brisées, mais il reste assez de l eur s pédicules pour oser assurer qu e les a n n e a u x qu'elles forment
par leur r éunion sont l a rgement ouverts depuis l'axis.
Comme n o u s avons toute une suite de vertèbres, depuis la pr emi è r e j u s q u ' à la septième dorsale,
nous les avons représentée s sur un e pl anche double, planche Vl l l , figures 4 - 1 5 , quelques-unes
d'entre elles sont vues de face, pour mont r e r les modifications que subit le corps sous le r appor t
de sa haut eur et de sa l a rgeur . Tout e s les vertèbre s de ia région dorsale sont r ema rquabl e s p a r le
g r a n d déve loppement de la facette arUculaire cor r e spondant à la tcle des côtes.
On sait que, par l'élévation des apophys e s transverses , les Baleines sont les Cétacés les plus
éloignés des Géolbé r i ens ; ces apophys e s s'écartent t rop pour p e rme t t r e aux côtes de p r e n d r e un
point d'appui sur le corps des vertèbres. 11 y a un e g r a n d e variation sous ce r appor t chez les Cétacés
à f anons que nous décrivons, depuis les Plésiocètes j u s q u ' a u x Isocèles.
RÉGION CEIIVICALE.
Le même caractère, qui s'observe d a n s les espèces vivantes de Mystacocètes, se r ema r q u e déjà
dans les espèces fossiles; comme nous l'avons vu plus haut , toutes les vertèbre s cervicales sont
séparées les unes des aut r e s , mais jusqu' à |)résenl nous n'avons pas r encont r é de ve r t èbr e s de
cette région accidentellement r éuni es soit par le corps, soit par l eur s apophys e s .
ATLAS.
L'atlas a des c a r a c t è r es pa r t i cul i e rs qui le font facilement r e conna î t r e à ceux qui ont le coup
d'oeil exe r c é ; il est r ema r q u a b l e par son déve loppement en l a rgeur et ses larges apophys es transverses
qui sont insérées fort bas. Les deux surfaces articulaires du condyl e se fondent l'une dans
l ' a u t r e aussi bien à la face a n t é r i e u r e qu'à la face postérieure. Le Irou vertébral est l a rgement
ouvert et à peine est-il plus l a rge en h a u t qu'en bas. Le corps de l'os a une g r a n d e épaisseur; sa
DES ENVIRONS D'ANVERS. i\
face infér i eur e au lieu d' ê t r e parallèle à l ' a x e du corps lui est oblique ; elle descend be aucoup plus
bas par son bord postérieur que par sou bord ant é r i eur , de mani è r e que l a ve r t èbr e , vue de profil,
montre une sorte de talon passant sous la ve r t èbr e suivante.
Eu compa r ant quelques atlas ent r e eux, nous ne pouvons nous emp ê c h e r de faire r ema r q u e r que
celte pr emi è r e cervicale mont r e assez bien les caractères g é n é r a u x du squelette. Ainsi l'atlas de la
Baloenopicra j'oiiiiito justifie pa r f a i t emenl , p a r s o n gr and dcve loppemeut , le nom spécifique qu'on a
donné à cette espèce et qui la fait r e s s embl e r be aucoup plus aux Balcnoplera SiObaldii et borealis
qu'à la muscultis et à la rostrala. L'atlas de ÏAmp/iicelus verus, si ce n'était sa g r a n d e l a rgeur
aux dépens de sa h a u t e u r , r approche r a i t be aucoup plus ce Cétacé de que lque s -une s de ces formes
robustes que des autres.
L'axis s'étend de même en largeur du moins par ses apophys e s t r ans verses, dont les inf é r i eur e s
seules sont conservées. L' apophys e odontoïde est très proéminent e , comme on peut le voir p a r la
figure 3, planche V. Celte ve r t èbr e est vue de face, pl anche VII, figure 2. Les apophys e s i r ans -
verses, surtout les inférieures, sont d'une g r a n d e solidité et donnent à cette ve r t èbr e un c a r a c t è r e
particulier, Les dimensions de cette ve r t èbr e sont en ha rmoni e avec celles de l'atlas et des aut r e s
cervicales; nous pourrions répéter l'observation faite pour l'atlas.
On voit au milieu du corps de la ve r t èbr e , surtout à la face postérieure, des traces, f a ibl ement
indiquées, de la présence de la corde dorsale.
LES CINQ DE RNI È R E S CERVICALES.
Toutes les autres vertèbre s de la région cervicale sont éga l ement r ema rquabl e s par leur épaisseur,
ce qui doit allonger plus ou moins le cou de ces a n ima u x ; elles sont toutes aussi fort larges
comparativement à leur h a u t e u r ; la surface ant é r i eur e est plus ou moins bombé e , de mani è r e
que, on e x a g é r a n t e e caractère, on poui'i'ail les dire opisthocoeliques. Les Plésiocètes ont la sur f a c e
du corps des vertèbre s plus unie que les Amphicètes. Les apojihyses iransverses , les supé r i eur e s
comme les inférieures, sont fort minces et la septième cervicale, comme toujour s sans apophys e ,
présente sur le bord postérieur un e faceltc articulaire fort large pour la tète de la pr emi è r e côte.
Celte se])lième cervicale est be aucoup plus épaisse que les autres. De l'axis à la s e p u ème cervicale,
la région cervicale a une louirueur de 22 centimètres.
REGiON DORS.ALE.
Les vertèbre s dorsales sont représentées en place, pl anche VI, et on voit que le corps a u gme n t e
insensiblement en l ongueur depuis la p r emi è r e , en même t emps que les apophys e s t r anvc r s e s
s'élèvent de plus en plus de bas en haul et de dedans en dehor s . Ces apophys es s'élargissent en
même temps à leur bas e c omme dans tous les Cétacés à fanons. Ce qui distingue sur tout ces cinq
premières dorsales, ce sont les facettes arliculaires qu e cha cune d'elles porte s u r le bord postérieur,
mais qui s'élèvent d'une ve r t èbr e à l'autre de ma n i è r e que la cinqui ème porte cette facette tout en
haut. Les six premi ères côtes sont donc bien attachées aux vertèbre s par la téle et par la tubérosité.
Toutes ces vertèbres, vue^ de face, se distinguent par leur gr and déve loppement en l a rgeur .
La sixième dorsale me sur e 30 millimètres et la sepUème /i 3 dans sa l o n g u e u r ; cette difi^érence
est si g r a n d e que si on n'avait pas trouvé ces ve r t èbr e s ensemble , formant u n e série et en place, on
aurait eu de la peine à les r appor t e r à un même animal.