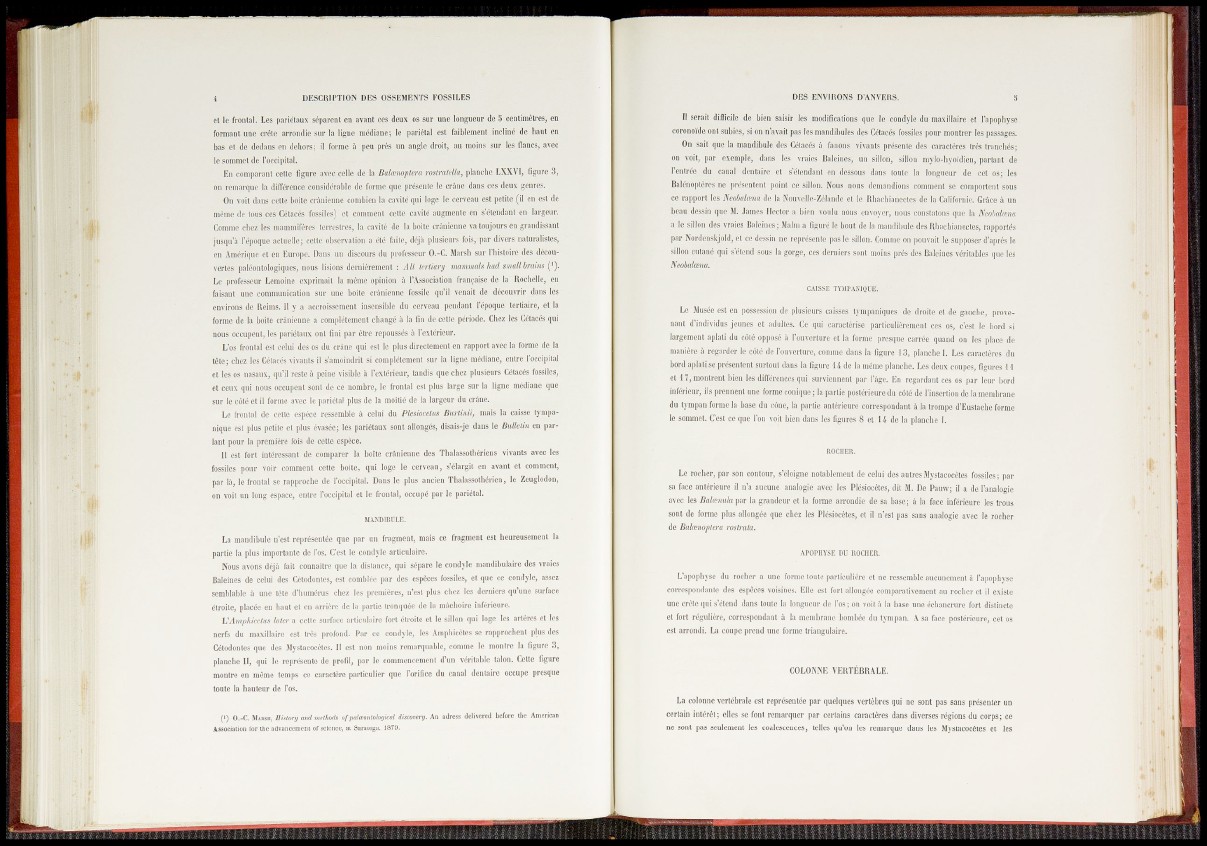
4 DESCRIPTIOÎS DES OSSEMENTS FOSSILES
et le fronlal. Les pariétaux sêparcnl en avant ces deux os sur une longueur de 5 centimètres, eo
formant une créte a r rondie sur la ligne médi ane ; le pariétai est faiblement incliné de !mut en
bas et de dedans en dehor s ; il forme à peu près un angle droit, au moins sur les flancs, avec
!e sommet de l'occipilal.
En comparant cetle figure avec celle de la Bahenoplcra rosira/cllu, planche LXXVI, fignrc 3,
on r ema rque la différence considérable de forme que présente le crime dans ces deux genres.
On voit dans celle boile c r âni enne combien la cavilé qui loge le cerveau est petite (il en esl de
même de tous ces Célacés fossiles) cl commenl celle cavilé augment e en s'étendant en largeur.
Comme cbez les mammifère s terrestres, la cavité de la boite c r âni enne va toujours en grandissant
jusqu'à l'époque actuellej cette observation a élé faite, déjà plusieurs fois, par divers naturalistes,
en Amérique et en Europe. Dans un discours du professeur O.-C. Marsb sur l'histoire des découvertes
paléonlologiques, nous lisions de rni è r ement : AU tcrliary immmah hud SIIKUI brains Q).
Le professeur Lemoine exprimait la même opinion à l'Association française de la Rochelle, en
faisant une communication sur une boite c r âni enne fossile qu'il venait de découvrir dans les
environs de Reims . Il y a accroissement insensible du cerveau pendant l'époque tertiaire, et la
forme de la boite crânienne a complètement changé à la fin de ccUe période. Chez les Cétacés qui
nous occupent, les pariélaux ont fini par être repoussés à l'extérieur.
L'os frontal est celui des os du crâne qui est le plus directement en rapport avec la forme de la
t é l e ; chez les Célacés vivants i! s'amoindrit si com])lélemcnt sur la ligne médi ane, entre l'occipital
et les os nasaux, qu'il reste à peine visible à l'extérieur, tandis que chez plusieurs Célacés fossiles,
et c eux qui nous occupent sont de ce n omb r e , le fronlal est plus large sur la ligne médiane que
sur le côté el il forme avec le pariétal plus de la moitié de la largeur du crâne.
Le frontal de celte espèce ressemble à celui du Plesioccliis Burtinii, mais la caisse t ymp a -
nique est plus petite et plus évasée; les pariétaux sont allongés, disais-je dans le Bulklin en pa r -
lant pour la pr emi è r e fois de cette espèce.
Il est fort intéressant de comparer la boite c r âni enne des Thalassothériens vivants avec les
fossiles pour voir commenl cette boile, qui loge le c e rve au , s'élargit en avant et comment ,
par là, le frontal se r approche de l'occipilal. Dans le plus ancien Tha l a s sothé r i en, le Zeuglodon,
on voit un long espace, ent r e l'occipital et le fronlal, occupé par le pariétal.
La mandibule n'est représenté e que par un f r agment , mais ce f r agment est heur eus ement la
partie la plus importante de l'os. C'est le condyle articulaire.
Nous avons déjà fait connaître que la dislance, qui sépare le condyle mandibulaire des vraies
Baleines de celui des Cétodontes, est comblée p a r des espèces fossiles, et que ce condyle, assez
semblable à une tète d' humé rus chez les pr emi è r e s , n'est plus chez les derniers qu'une surface
étroite, placée en haut et en arrière de la partie t ronqué e de la mâchoire inférieure.
VAmphkelua later a cette suiface articulaire fort étroite et le sillon qui loge les artères et les
nerfs du maxillaire est très profond. Pa r ce condyle, les Amphicéles se r approchent plus des
Cétodontes que des .Mystacocèles. il est non moins r ema rquabl e , comme le mont r e la figure 3,
planche II, qui le représente de profil, pa r le commenc ement d'un véritable talon. Cette figure
montre en même temps ce caractère particulier que l'orifice du canal dentaire occupe presque
toute la haut eur de l'os.
( ' ) O.-C. MAPSI I , Ilistory and methods of paloeontolo'jkal discovery. An ûdrcss delivered before llie American
Associaiioii for tlie advanc ement of science, al Saratoga. 187'J.
DES ENVIRONS D'ANVERS. S
Il serait diilicile de bien saisir les modifications que le condyle du maxillaire et l'apophyse
coronoïde ont subies, si on n'avait pas les mandibule s des Cétacés fossiles pour montrer les passages.
On sait que la mandibule des Célacés à fanons vivants présente des caractères (rès t r anché s ;
on voil, par exemple, dans les vraies Raleines, un sillon, sillon mylo-hyoïdi en, parlant de
l'entrée du canal dentaire et s'étendant en dessous dans toute la longueur de cet os; les
Balénoptères ne présentent point ce sillon. Nous nous demaiidions comment se comportent sous
ce r appor t les Neolmloena de la Nouvelle-Zélande el le Rhachianectes de la Californie. Grâce à un
beau dessin que .M. J ame s Hector a bien voulu nous envoyer, nous constatons que la Neobaloena
a le sillon des vraies Baleines; .Maini a figuré le bout de la mandibule des Rhachianectes, rapportés
par Nordenskjold, et ce dessin ne représente pas le sillon. Conune on pouvait le supposer d'a[)rès le
sillon cutané qui s'éleiid sous la gorge, ces dei'iiiers sont moins près des Baleines véritables que les
Neobaloena.
CAISSE TY.MPA>mLE.
Le Musée est en possession de plusieurs caisses tympanique s de droite et de g a u c h e , provenant
d'individus j eune s et adultes. Ce qui caractérise particulièremenl ces os, c'est le bord si
largement aplafi du côté opposé à l'ouverture el la forme presque carrée quand on les place de
manière à regarder le côté de l'ouverlure, comme dans la figure 13, planche 1. Les caractères du
bord aplati se présentent surtout dans la figure 14 de la même planche. Les deux coupes, figures M
et \ 7, mont r ent bien les ditïérenccs qui surviennent par l'âge. En regardant ces os par leur bord
inférieur, ils pr ennent une forme conique ; la partie postérieure du côté de l'insertion de la memb r a n e
du tympan forme la base du cône, la parlie antérieure correspondant à la trompe d'Eustache forme
le sommet. C'est ce que l'on voil bien dans les figures 8 et 14 de la planche J.
Le rocher, par son contour, s'éloigne notablement de celui des autresMyslacocètes fossiles; par
sa face antérieure il n'a aucune analogie avec les Plésiocètes, dit M. De P a uw; il a de l'analogie
avec les Baloenula^vv la gr andeur el la forme ar rondie de sa base; à la face inférieure les trous
sont de forme plus allongée que chez les Plésiocètes, et il n'est pas sans analogie avec le rocher
de Btiloenopicra rostrata.
APOPHYSE DU ROCHER.
L'apophyse du roche r a une forme toute particulière et ne ressemble aucunement à l'apophyse
corresi)ondanlc des espèces voisines. Elle esl fort allongée comparativement au roche r et il existe
une crête qui s'étend dans toute la longueur de l"os; on voil à la base une é chanc rur e fort distincte
et fort régulière, correspondant à la memb r a n e bombée du t ymp a n . A sa face postérieure, cet os
est ari'ondi. La coupe prend une forme triangulaire.
COLONNE VERTEBRALE.
La colonne vertébrale est représentée pa r quelques vertèbres qui ne sont pas sans présenter uo
certain int é r ê t ; elles se font r ema rque r par cerlaiiis caractères dans diverses régions du corps ; ce
ne sont pas seulement les coalescences, telles qu'on les r ema rque dans les Mj'stacocètes et les