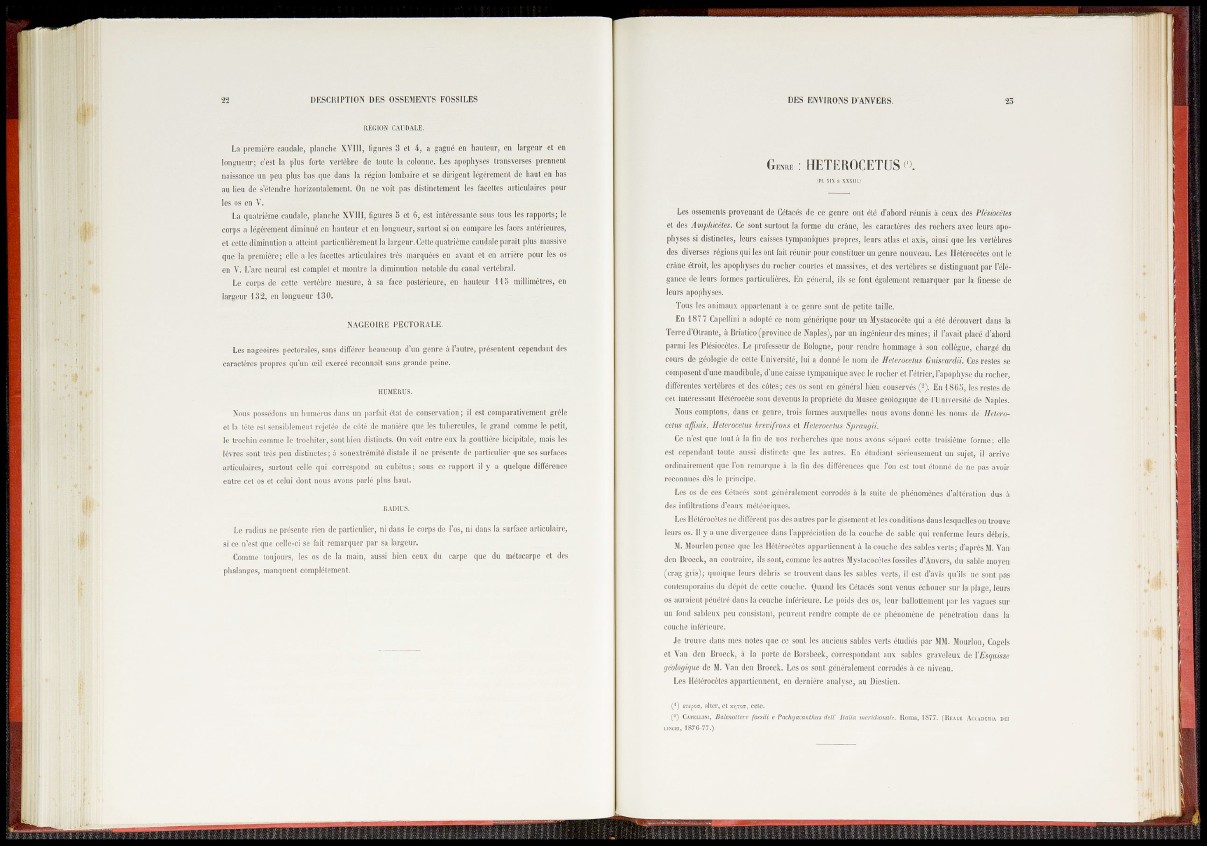
w
m.
DESCRIPTION Dl îS OSSEMENTS FOSSILES
REGION CARDALE.
La [iremii're caudale, pl anche XVI I I , figures 3 el a g a g n é en haut eur , e» l a rgeur et en
longueur; c'est la plus forte ve r t èbr e de toute la colonne. Les apophys es transverses pr ennent
naissance un peu plus bas que dans la région lombaire el se dirigent légèrement de haut en bas
au lieu de s'étendre hor i zool a l ement. Ou ne voit pas dislinctement les facetlcs articulaires pour
les os en V.
La qua t r i ème caudale, pl anche XVI I I , figures 5 et fi, est intéressante sous tous les r appor t s ; le
corps a légèrement diminué en haut eur et en longueur , surtout si ou compa r e les faces antérieures,
et celte diminution a atteint particulièrement la largeur. Cette qu;\ti'icnie caudale parait plus massive
que la p r emi è r e ; elle a les facettes articulaires très ma rqué e s en avant et en arrière pour les os
en V. L'arc neural est compiei et mont r e la diminution notable du canal ve r t ébr a l .
Le corps de cette ve r t èbr e me s u r e , à sa face postérieure, en hauteur 1 4 5 millimètres, en
largeur 1 3 2 , en longueur 1 3 0 .
NAGEOIRE PECTORALE,
Les nageoires pectorales, sans différer be aucou p d'un g e n r e à l'autre, présentent c ependant des
caractères propr e s qu'un oeil exercé reconnaît sans g r a n d e peine.
Nous possédons un h umé r u s dans un parfait état de cons e rva t ion; il est comparativement grêle
et In tote est sensiblemeiil rejetée de côte de mani è r e qu e les tubercules, le grand comme le petit,
le t rochin c omme le trocliiter, sont bien distincts. On voit ent r e eux. la gouttière bicipitale, mais les
lèvres sont très peu distinctes; à sonext r émi t é distale il ne présente de particulier que ses surfaces
articulaires, surtout celle qui correspond au cubi tus ; sous ce r appor t il y a que lque différence
entre cet os et celui dont n o u s avons parlé plus haut .
Le r adius ne présente rien de particulier, ni dans le corps de l'os, ni dans la sur f a c e articulaire,
si ce n'est que celle-ci se fait r ema r q u e r par sa l a rgeur .
Comme toujour s , les os de la ma in, aussi bien ceux du carpe que du mé t a c a rpe et des
phalanges, ma n q u e n t complètement.
DES ENVIRONS D'ANVERS. 23
GENRE : H E T E R O C E T U S
(PI. XIX à xxxii),:
Les ossements provenant de Cétacés de ce g e n r e ont été d' abord r é u n i s à ceux des Plésiocèles
cl des Amphkèies. Ce sont surtout la forme du crâne, les caractères des roche r s avec leurs apophyses
si distinctes, leurs caisses tympanique s propres, l eur s allas el axis, ainsi que les ve r t èbr e s
des diverses régions qui les oui fait r éuni r pour constituer un i^enre nouve au. Les Hétérocètes onl le
crane étroit, les apophys es du roche r courtes et massives, et des vertèbre s se distinguant par l'élégance
de leurs formes parliculières. liln général, ils se font égalemejil r ema r q u e r par la finesse de
leurs apo|>hyses.
Tous les animaux appa r t enant à ce genr e sont de petite taille.
Eu 1 8 7 7 Capellini a adopté ce nom géné r ique pour un Mystacocète qui a été dé couve r t dans la
Terre d'Olrante, à Briatico (provinc e de Naples), par un ingénieur des mine s ; il l'avait placé d'abord
parmi les Plésiocèles. Le professeur de Bologne, pour r e n d r e h omma g e à son collègue, c h a r g é du
cours de géologie de cette Université, lui a donné le nom de Ueierocclus Guiscurdii. Ces restes se
composent d'une mandibul e , d'une caisse tympanique avec le roche r et l'élrier, l'apophys e du roche r ,
différentes vertèbre s et des côt e s ; ces os sont en général bien conservés (2). En 1 8 6 3 , les restes de
cet intéressant llétérocète sont devenus la propriété du Musée géologique de l'Université de Naples.
Nous comptons, dans ce genr e , trois forme s auxquelles nous avons d o n n é les noms do Jicterocem
affinis, Hclerocelus brevifroHS et licterocelus Sprangii.
Ce n'est que tout à la fin de nos r e che r che s que nous avons s épa r é cette troisième f o rme ; elle
est c ependant toute aussi distincte que les autres. En étudiant s é r i eus ement un suj e t , il a r r ive
ordinairement que l'on r ema r q u e à la fin des diffèreuces qu e l'on est tout é tonné de ne pas avoir
r e connue s dès le principe.
Les os de ces Cétacés sont géné r a l ement corrodés à la suite de phénomène s d'aitération d u s à
des infiltrations d'eaux météoriques.
Les Hétérocètes ne dilTèrent pas des autres par le gisement et les conditions dans lesquelles on t rouve
leurs os. Il y a un e dive rgenc e dans l'appréciation de la couche de sable qui r e n f e rme l eur s débris.
M. Mourlon pense que les Hétérocètes appa r t i e iment à la couche des sables ve r l s ; d'après xM. Va n
dcn Broeck, au coutrairo, ils sont, comme les autres Mystacocètes fossiles d'Anvers, du sable mo y e n
(crag gr i s ) ; quoique leurs débris se trouvent dans les sables verts, il est d'avis qu'ils ne sont pas
contemporains du dépôt de celte couche . Quand les Cétacés sont venus é choue r sur la plage, leurs
os aur a i ent pénétré dans la couche inférieure. Le poids des os, leur ballotlemeut par les vague s s u r
un foud sableux peu consistant, peuvent r endr e compt e de ce phénomène de pénétration dans la
couche inférieure.
Je trouve dans me s notes que ce sont les anciens sables verts étudiés par MM. Mourlon, Cogels
et Van don Broeck, à la porte de Borsbeek, cor r e spondant aux sables gr ave l eux de X^Esquisse
géologique de M. Van deii Broeck. Les os sont géné r a l ement corrodés à ce nive au.
Les Ilctérocctes appa r t i ennent , en de rni è r e ana lys e , au Diestien.
sTssoff, alter, cl xTiTOT, ceie.
(2) CAPELMisi, Dalenolterc fossiii c Pachyacanthus iloW hatiu mcridionah'. Roma, 1S77. (Ri-ai.e Acc^demu oei
LiNCRi, 1876-77.)
' 1