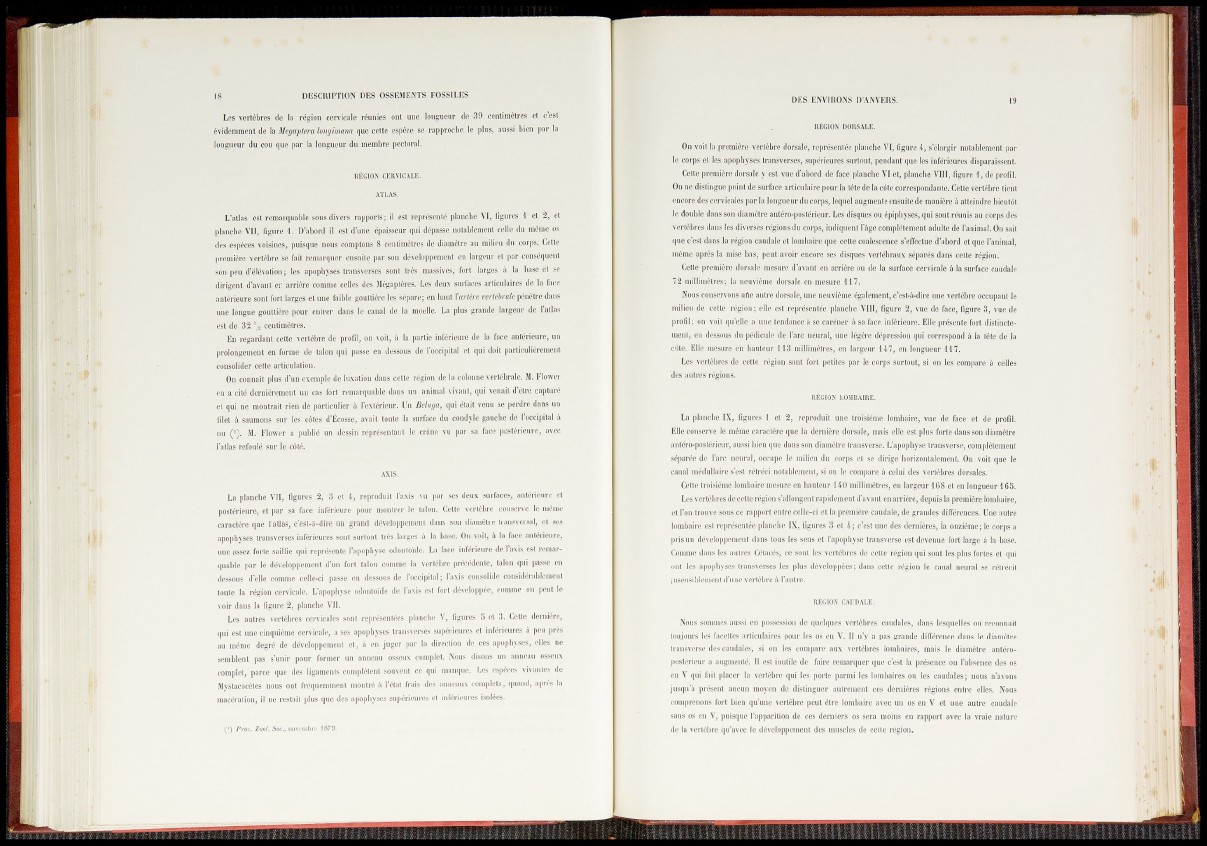
de Tal Ir
jliéreraonl
18 DESCRIPTION DES OSSEMENTS FOSSILES
Les vertèbre s de la région cervicale réunies ont une loiigiieiir de 39 centimètres et c'est
évidemment de la Megaplera longimam que celte espèce se rapproclie le plus, aussi bien par la
longueur du cou que par la longueur du memb r e peclorai.
RÉGION CERVICALE.
ATLAS.
L'atlas est r ema r q u a b l e sous divers r appor l s ; il est représeiUé planche VI, ligures 1 et % cl
planche VU, ligure 1. D'abord il est d'une épaisseur qui dopasse uolablcniciit celle du môme os
des espèces voisines, pui sque nous comptons 8 centimèlres de diamcire au milieu du corps. Colle
première ve r t èbr e se fait r ema r q u e r ensuite par son développement en largeui' et par conséquent
son peu d' é l éva t ion; les apophys e s t r ans \ e r s e s sont très massives, ioi'l larges à la base ei se
dirigent d'avant er arrièr e comme celles des Mégaplères. Les deux sui'l'aces arliculaircs de la face
antei'ieure sont fort larges et une faible gouttière les s épa r e ; en baut Wtrlère wr / e i / j a f e pènèire dans
une longue gouttière pour entre r d a n s le canal de la moelle. La plus gr ande largeur
est de 32 centimètres.
En r ega rdant celte ve r t èbr e de profil, on voil, à la partie inférieure de la face anié
prolongement en forme de talon qui passe en dessous de l'occipital et qui doit partie
consolider cette articulation.
On connaît plus d'un exempl e de luxation dans cette région de la colonne vertébrale. M. Flowe r
en a cite de rni è r ement un cas for! r ema rquabl e dans un animal vivant, qui venait d'etre c apturé
et qui lie montrait rien de particulier à l'extérieur. Un Beluyo, qui était venu se pe rdr e dans un
lilet à s aumons sur les côtes d'Ecosse, avail toute la surface du condyle gauche de l'occipital à
lui ( ' ) . M. Flowe r a publié un dessin r epr é s ent ant le c r âne vu par sa face pos t é r i eur e , avec
l'atlas l'efoulé sur le côté.
La pl anche Vi l , figures 2, 3 et 4, reproduit I a x i s \u par ses deux surfaces, anl é r i cur e et
posicrieiire, et par sa face inférieure pour mont r e r le talon. Cette ve r t èbr e conserve le même
caractère que l'atlas, c'est-à-dire un gr and développement dans son diamètre transversal, et ses
apophyses transverses inférieures sont surtout très larges à la base. On voit, à la face ant é r i eur e ,
line assez forte saillie qui r epr é s ent e l'apophys e odontoïde. La face inférieure de l'axis est r e ina r -
(|uable par le déve loppement d'un fort talon comme la ve r t èbr e précédente, talon qui passe en
dessous d'elle comme celle-ci passe en dessous de i'occipilal; l'axis consolidi^ considérablement
toute la région cervicale. L'apophyse odontoïde de l'axis est fort développée, comme on peut
voir d a n s la figure 2, planche VU.
Les autres vertèbre s cervicales sont représentée s pinncbe V, ligures 5 et 3. Celle dernière,
qui est une cinquième cervicale, a ses apophys e s ti'ansvers'es supérieures et inférieures à peu ])r-és
nu même degr é de déve loppement e t , à en j u g e r par la dii'ection de ces apophys e s , elles ne
semblent pas s'unir pour forme r un anne au osseux compiei. Nous disons uii anneau osseux
complet, puree que des ligaments comj)lèlent souvent ce qui manque . Los espèces vivantes de
Mystacocèles nous ont f r é q u emme n l mont r é à l'état frais des iinneaux compl e t s , <piand, api'ès la
macération, il ne restait plus que des apophys e s supé r i eur e s et inférieures isolées.
(I) Vroc. Zoo!. Soc., novfmbri.' 1879.
DES ENVIRONS D'AiVVEIlS.
RÉGION DORSALE.
19
On voit la première vertèbre dorsale, r epr é s ent é e planche VI, figure 4, s'élargir not abl ement par
le corps et les apophys e s transverses, supérieures surtout, pendant que les inférieures disparaissent.
Cette première dorsale y est vue d'abord de face planche VI el, pl anche VIII, figure i , de profil.
On ne distingue point de surface articulaire pour la tète de la côte correspondante. Cette vertèbre lient
encore des cervicales par la longueur du corps, lequel augment e ensuite de mani è re à atteindre bientói
le double dans son diamètre antéro-posicrieur. Les disques ou epiphyses, qui sont réunis au corps des
vertèbres dans les diverses régions du corps, indiquent l'ùge compl è t ement adulle de l'animal. On sait
que c'est dans la région caudale et lomba i r e que cette coalescence s'eiïectue d'abord et que l'animal,
même après la mise bas, peut avoir encore ses disques ve r t ébr aux s épa r é s dans celte région.
Celte pr emi è r e dorsale mesure d'avant en arrièr e ou de la surface cervicale à la surface caudale
7 2 milliinèli'es; ia neuvième dorsale en me s u r e 1 1 7 .
Nous conservons iifie aut r e dorsale, une neuvi ème également, c'esl-à-dire une ve r t èbr e occupant le
milieu de celte r égion ; elle est représentée pl anche VIII, figure 2, vue de face, ligure 3, vue de
j)j'olil ; on voit (¡u'ellc a une tendance à se c a r éne r à sa lace inférieure. Elle présente fort dislinctemenl,
en dessous du pédicule de l'arc neural, une légère dépression qui correspond à la tète de la
côte. Elle mesure en haut eur 1 1 3 millimèlres, en l a rgeur 1 4 7 , en longueur H 7 .
Les vertèbres de cette région sont fort petites par le corps surtout, si on les compa r e à celles
des autres régions.
RÉGION I-OMBAIRE.
La planche IX, ligures 1 et 2, r eprodui î une troisième lombaire , vue de face et de profil.
Elle conserve le même caractère que la dernière dorsale, mais elle est plus forte dans son di amè t r e
antéro-poslérieur, aussi bien ijue dans son di amè t r e transverse. L'apophyse transverse, comj)lêtemen(
séparée de l'arc neur a l , occupe le milieu du corps et se dirige horizontalement . On voit que le
canal métiuilaire s'est rétréci notablement, si on le compa r e à celui des ve r t èbr e s dorsales.
Cette troisième lombaire me sur e en liauleur 1 4 0 millimèlres, en l a rgeur 1 6 8 et en longueur 1 6 5 .
Les verlèbre s de cette région s'allongent r apidement d' avant en arrière , depuis la première lomba i r e ,
el l'on trouve sous ce rapport ent r e celle-ci et la pr emi è r e caudale, de gr ande s diilerences. Une aut r e
lombaire est représentée pl anche IX, ligui'es 3 et 4; c'est une des dernières, la o n z i ème ; le corps a
])i'isun développement dans tous les sens et l'apophyse transverse est devenue fort large à la base.
Comme dans les autres (lélacés, ce sont les ve r t èbr e s de cette région qni sont les plus fortes et qui
ont les apophyses transverses les plus déve loppé e s ; dans celte r égion le canal neurai se rétrécit
iiisensiblenient d'une ve r t èbr e à Tautre.
RÉGION c.u;dale.
Nous somme s aussi en possession de que lque s vertèbre s caudales, dans [csquelles on reconnaît
toujours les fiicettes articulaires pour les os en V. Il n'y a pas g r a n d e dilTérence dans le dianièlre
li ansverse des caudales, si on les compa r e aux vertèbre s lombaires, ma i s le di amè t r e ant é roposlerieiir
a augment é . Il est inutile de faire r ema r q u e r que c'est la pr é s enc e ou l'absence des os
en V i|ni fait placer la ve r t èbr e qui les porte parmi les lombai res ou les c a u d a l e s ; nous n'avons
jusqu'à présenl aucun moyen de di s t ingue r aut r ement ces dernière s r égions ent r e elles. Nous
comprenons fort bien qu'une vertèbre peut être lombaire avec un os en V et une aut r e c auda l e
sans os en V, puisque l'appiu'ition de ces d e r n i e r s os sera moins en rapport avec la vraie n a t u r e
(le la verlèbre (]u'avee le développement des muscles de cette r égion.