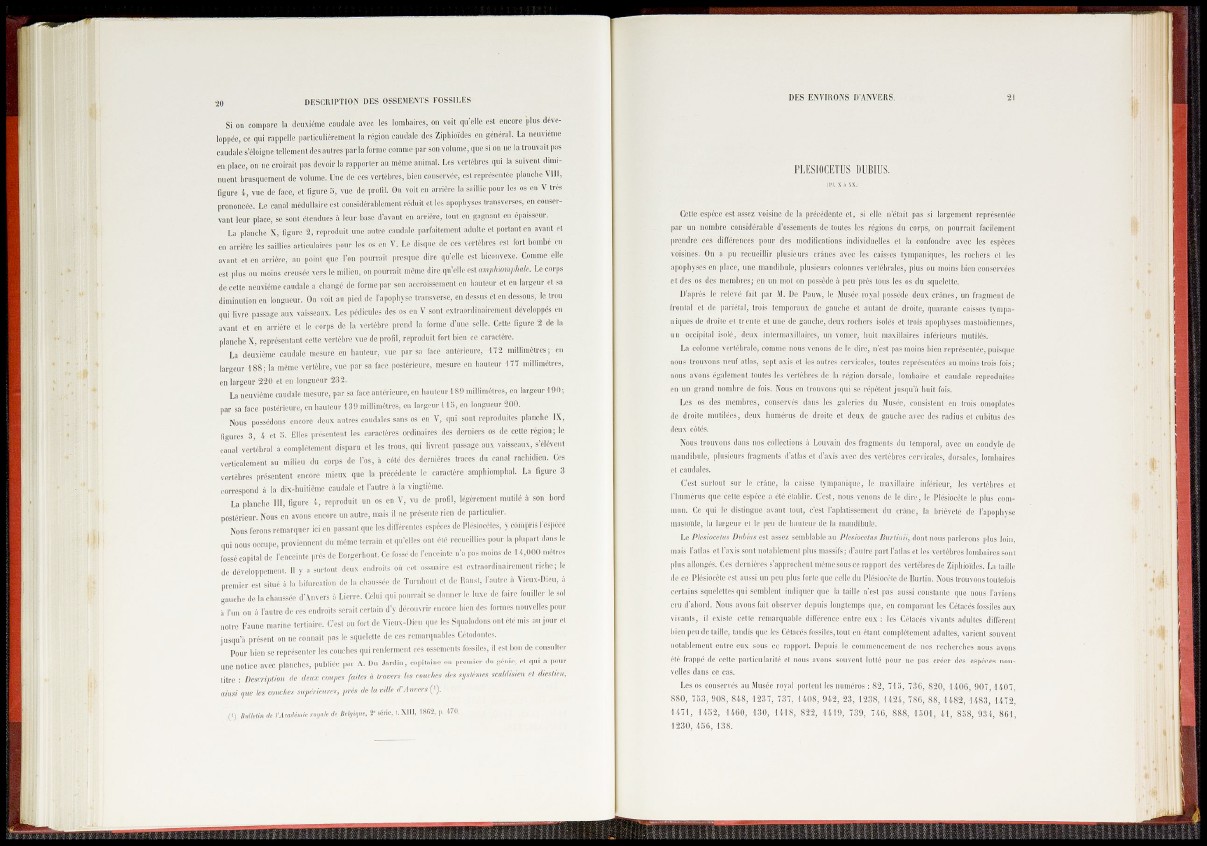
20 DESCRIPTION DES OSSEMEiSTS FOS S l lXS
Si on compyre la deuxi ème caudale avec les lonibaiies, on voit qu'elle est encor e ¡dus développée,
ce qui rappelle iinrlicuIièremeiU la région c auda le des Zipliioïdes en général. La neuvième
caudale s'éloigne tellement des autres par la forme comme par son volume, que si on ne la trouvait pas
en place, on ne croirais pas devoir la r appor t e r au même anima l . Les verlèbre s qui la suivent diminuent
b r u s q u eme n t de volume. L'ne de ces vcrtL^bres, bien conservée, est représentée plaiicbe Vl l l ,
figure 4, vue de face, et figure 3, vue de prolil. On voit en arrièr e la saillie pour les os en V très
prononcée. Le canal médullaire est cons idé r abl cmcut réduit et les apophys e s Iransverses, en conservant
leur place, se sont é t endue s à leur base d'avant en arrière, tout en gagnant en épaisseur.
La pl anche X, figure 2, reproduit u n e aut r e caudale parfaitement adulte et portant on avant et
en arrièr e les saillies articulaires pour les os en V. Le disque de ces vertèbres est fort bombé en
avant et en arriére , au point que Ton pourruit presque dire ((u'elle est biconvexe. Comme elle
est plus ou moins creusée ve rs le milieu, on pourrait môme dire qu'elle est (mpkiomphale. Le corps
(le cette neuvi ème caudale a changé de forme par son accroissement en lianteur et en largeur et sa
diminution en longueur. Ou voit an pied de Tapopln se transverse, en dessus cl en dessous, le trou
qui livre passage aux vaisseaux. Us pédicules des os en V sont extraordinairenient développés en
avant et en a r r i è r e et !e corps de la ve r t èbr e prend la forme d'une selle. Celte figure 2 de la
planche X, r epr é s eut aut celte vertèbre vue de profil, r eprodui t fort bien ce caractère.
La deuxième caudale me sur e en haut eur , vue par sa face antérieure, 1 7 2 mi l l imè t r e s ; en
largeur 1 8 8 ; la mémo vertèbre, vue par sa face postérieure, me sur e en haut eur 1 7 7 millimètres,
en l a rgeur 2 2 0 et en longueur 2 3 2 .
La neuvi ème caudale me sur e , p a r sa face ant é r i eur e , en haut eur 1 8 9 millimètres, on largeur 1 9 0 ;
par sa face postérieure, en haut eur 1 3 9 millimètres, en largeur 1 1 5 , en longueur 2 0 0 .
Nous possédons encor e deux autres caudales sans os en V, (pii sont r eprodui t es plancl.e IX,
Hgurcs 3, h et Elles pr é s ent ent les caraclères ordinaires des de rni e r s os de cette région; le
cannai vertébral a complètement disparu et les trous, qui livrent passage aux vaisseaux, s'élèvent
verticalement au milieu du corps de l'os, à c6té des dernières traces du canal rachidien. Ces
vertèbres pr é s ent ent encore mi eux que la précédente le c a r a c t è r e amphiompha l . La figure 3
correspond à la dix-hui t i ème c auda le et l'autre à la vingtième.
La pl anche HI, figure 4, r eprodui t un os en V, vu de profil, légèremenl mutilé à son bord
postérieur. Nous en avons encore un autre, mais il ne présente rien de particulier.
Nous ferons r ema r q u e r ici en passant ([ue les difTérentes es|)èces de Plésiocètes, y compris l'espèec
et qu'elles ont été recueillies pour la plupart dans le
(jui nous occupe, provi ennent du même ter
inte |)rès de Uorgerhout. Ce fossé de ronccinte n'a pas moins de 1 4 , 0 0 0 nièlre;
v a surtout deux endroits où cet ossuaire est ext r aordina i r eui cnl r i che ; h
fossé capital de l'e
de développement
premier est silué à la bifurcation de la chai
gauche de la chaussée d'Anve r s à Lierre. Celui riui |)()m
à l'un ou à l'autre de ces endroits serait certain d'y déci
notre F a u n e ma r i n e terliaire. C'est au for! de Vi eux-D
tre à Vieux-Dieu, à
; faire louiller le sol
rmos nouvelles pour
nt été mis au j o u r cl
c de Tu r n h o u l et de l ai
t se donne r !o luxe (h
l ' i r e n c o r c i hien des fo
([uc les Squalodons (i
itte de ces r ema r i p d)les Célodontes
iles, i
jusqu'à pr é s ent on ne connaît pas !e sq
Pour bien se r epr é s ent e r les coiiehes qui r e n f e rme n t ces ossements U
une notice avec planches, publiée par A. Du J a r d i n , capitaine en premier du géni
titre : DmripUon de deux coupes failed à travers les rouchcs des M
ainsi que les couches snpmeiires, prés de Ui ville d'Anvers (').
(1) RMclin ih l'Académie ro„alo d. flelnù/ue, 2' série, i. XIII, 1802, 170.
t l)on de cousull(
nie, et qui a pou
ien et diesliei
DES ENVIRONS D'ANVERS.
P L E S I O C R T U S D U B I U S .
Cette espèce est assez voisine de la précédente e t , si elle n'était pas si l a rgement représentée
par un nombr e considérable d'ossements de toutes les régions du corps, on pourrait facilement
jirendrc ces diiïéronces pour des modifications individuelles et la confondre avec les espèces
voisines. On a pu reeueillir plus i eui s c r âne s avec les caisses lympaniques , les roche r s cl les
apophyses on place, une mandibul e, plusieurs colonnes vertébrales, plus ou moins bien conservées
e t (les os des memb r e s ; en un mot on |)ossède à peu près tous les os du squelette.
D'après le relevé fait par i l . De Pa uw, le Musée royal possède deux c r â n e s , un fi'agment de
frontal et de pariétal, trois t emp o r a u x de gauche et autant de droite, qua r ant e caisses t ymp a -
n iques de droite et tr ente et une de gauche, doux roche r s isolés et trois apo|)hyses mastoïdiennes,
u n occipital isolé, deux inlermaxillaires, un vome r , huit maxillaires inférieurs mutilés.
La colonne vertébrale, comme noiis venons de le dire, n'est pas moins bien représentée, puisque
nous trouvons neuf atlas, sept axis et les antres cervicales, toutes représentée s au moins trois foi.^
nous avons éga l ement toutes les vertèbre s de la région dorsale, lombaire et c auda le re[)rodiiit('s
en un grand n omb r e de fois. Nous en trouvons qui se répèteni jusqu' à huit fois.
Les os des memb r e s , conservés dans les galeries du .Musée, consistent eu irois omoplates
de droite mut i l é e s , deux h umé r u s de droite et deux de g a u c h e avec des radius et cubi tus des
deux côtés.
Nous trouvons dans nos collections à Louvain des f r agment s du temporal, avec un condvle de
mandibule, plusieurs fragments d'atlas et d'axis avec des vertèbre s cervicales, dorsales, lombaires
et caudales.
C'esl suri out sur le crâne, la caisse tympanique , le maxillaire inférieur , les ve i l èbr e s et
l'humérus que cette espèce a été élablie. C'est, nous vouons de le di r e , le Plésiocète le |)lus commun.
Ce qui le distingue avant tout, c'esl raplatissomcnt du c r âne , la brièveté de l'apophyse
inastoïdo, la l a rgeur et le peu de haut eur de la mandibul e .
Le Plesiocetiis Dubivs est assez semblable au P/esiocelus Ihirlinii, dont nous parlerons plus loin,
mais l'atlas et l'axis sont notablement plus massifs; d'autre part l'atlas et les vertèbre s lombaires sont
plus allongés. Ces dernière s s'approchcnl même sous ce rapport des vertèbres de Zipliioïdes. La taille
de ce Plésiocète est aussi un peu plus forte (|ue celle du Plésiocèlo de Hurtin, Nous trouvons toutefois
certains squelettes (|ui semblent indiquer que la taille n'est pas aussi constante que nous l a v i o n s
cru d'abord. Nous avons fait observer dejuiis longlemps (¡ue, en compa r ant les Cétacés fossiles aux
vivants, il existe celte r ema rquabl e dilTcronce ent r e eux : les Cétaccs vivants adultes dilièrcnt
i)ien peu de taille, tandis que les Cétacés fossiles, tout en étant com[ilèlemenl adultes, varient souvent
notablement ent r e eux sous ce rapport. Depuis le c omme n c eme n t de nos rccherciies nous avons
élé frappé de cette particularité et no
\ elles dans ce cas.
Les os conservés au Musée
880 , !)0S, 8 4 8 , 1 2 3 7 ,
1452, 14G0, 1 3 0 ,
souvent lutté pour ne pas créer des espèces l)U-
1 i l I ^
1230, 4i}tK 138.
royal portenl les numé ros : 8 2 , 7 1 5 , '
737, I 4 0 S , 9 4 2 , 2 3 , 1 2 3 8 , '
1418, 8 2 2 , 1 4 1 9 , 7 3 9 , 7 4 0 , 8 8 8 ,
36, S 2 0 , 140(>, 9 0 7 , 1 4 0 7 ,
86, 8 8 , 1 4 8 2 , 1 4 8 3 , 1 4 7 2 ,
l a O l , 4 1 , 8 5 8 , 9 3 ' / , 8 6 1 ,