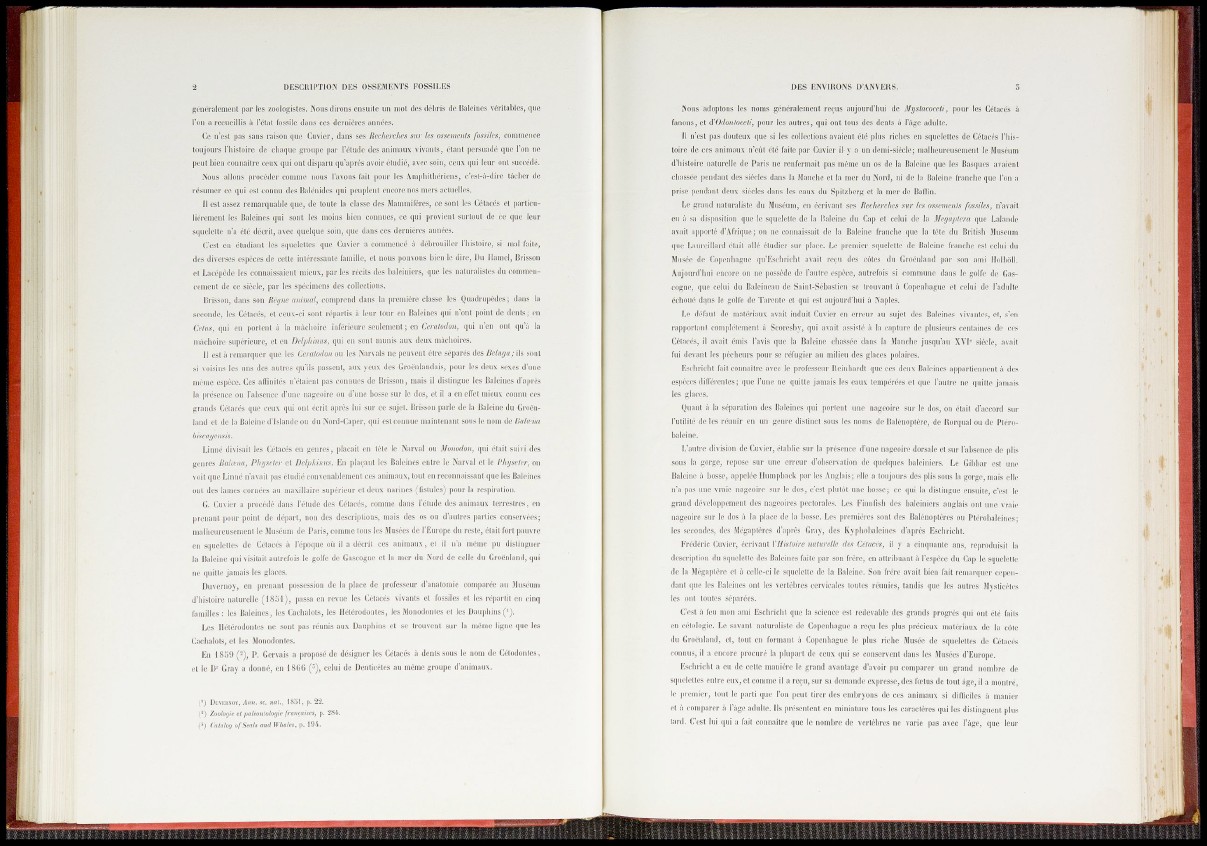
H
2 DESCRIPTION DES OSSEMENTS FOSSILES
gonérolemeiil par les zoologistes. iSous dirons ensui t e un mol des débris do Baleines véritables, que
l'on a reeueillis ù l'étiil fossile d;ins ces dei nières anné e s .
Ce n' e s t pas s ans raison que Ciivier, dans ses Recherches sur les ossements fossiles, coniinence
toujours riiistoire de eiiaque jiroupe par r é t u d e des animaux vivant s , é t ant persundé que l'on ne
puut bleu conua i i r e ceux qui ont disparu qu' apr è s avoir étudié, avor soin, ceux (|ui leur ont succédé.
Nous allons procéder comme nous Tavons lait pour les Amphi t l i é r i ens , (;'est-à-dire t â che r de
résumer ce qui est connu des Balénides qui peuplent encore nos me r s actuelles.
Il est assez r ema r q u a b l e que , de t ont e la classe des iMammileres, ce sont les Cétacés cl particuliéreniciil
les IJolcines qui sont les moins bien connues, ce qui provient surtout do ce que leur
siiuelelle n'a été décrit, ave c que lque soin, que dans ces dernière s années.
C'est en étudiant les squelettes que Cuvier a commenc é à débrouiller l'iiistoirc, si mal l'aile,
des diverses espèces de celte intéressanie l'amille, et nous pouvons bien le dii'o, Du llamel, Brisson
el La c épède les connaissaient mieux, par les récits des baleiniers, que les naturalistes du commen -
cement de ce siècle, par ies spé c imens des collections.
IJrisson, dans son liègne animal, conq)rond dans la première classe les Qu a d r u p è d e s ; dans la
seconde, les Cétacés, et ceux-c i sont répartis à l eur tour on Baleines ijui n'ont point de d e n t s ; eu
Oliis, qui en portent à la mâ choi r e inlérieure s e u l eme n t ; en Ceraloclon, qui n'en onl qu'à la
inncboire supé r i eur e , et eu Delphimis, (¡ui en sont mu n i s aux deux mâchoires.
Il est à r ema r q u e r qu e les V.eratodon ou les Narvals ne peuvent être s épa r é s des Uelugu; ils sont
si voisins les u ns des aut r e s qu'ils passent, aux yeux des Groënl anda i s, pour les deux sexes d'une
même espèce. Ces allinités n'étaient pas connue s de lirisson, mais il distingue ies Baleines d'api'ès
la présence ou l a b s c n c e d'une nageoire ou d'une bosse sur le dos, et il a en elTet mi eux connu ces
grands dé l a c é s que ccux qui ont écrit après lui sur ce sujel. Brisson pai'le de la Baleine du Groén-
• ou du Nord-Caper, (|ui est connue ma inl hind et de la Baleine d'Islan enani sous le nom de lîaUi
bisen¡¡e nais.
Linné divisait les Cétacés en g e n r e s , plaçait en tèle le Narval o
sciu'es Bulwna, Ph y scier et Delphi mis. En plaçant les Baleines enl
\oit que Linné n'avail pas é l iul i é convenabl ement ces animaux, tout ci
onl des lames corné e s au nuixillaire supé r i eur et deux na r ines ((isli
.1 .Vonodon, qui était suivi des
•(; le Narval et le l'hi/seler, ou
I reconnaissani que les Baleines
les) pour la respiralioi).
(¡, Cuvier a procédé dans l'élude de.s Cétacés, c omme dans l'étude des animaux t e i r e s t r c s , en
|ii'onant pour point de dépa r t , non des descriptions, mais des os ou d' aut r e s parlies cons e rvé e s ;
nialheureusemenl le Muséum de Pa r i s , connne lous les Musées de l'Europe du reste, était fort p a u v r e
en si|uclelles de Cétacés à l'époque où il a décrit ces a n ima u x , et il n'a même pu distinguer
la JJaleine qui \isitait a utrero is le golfe de Gascogne et la me r du Nord de celle du Groenl and, qui
ne quitte j ama i s les glaces.
Duvei'uoy, en pi'onant possession de la place de jn'ofesseur d'à nato mie comparée au Muséum
d'in'sloire na tur e l l e (\S'6i), ]>assa en revue les Cétacés vivants el fossiles et les réparlit en cinq
familles : ies Ba l e ine s , les Cachalots, les ilétéi'oiiontes, les Monodonles el les I)auj)hins ( ' ) .
Les l l é t é rodont e s ne sont pas réunis aux Daupiiins et se t rouvent SUI' hi que ies
Caeiialots, et les Monodontes.
Eu I Siii) (•}, !'. Gervais a proposé de désigne r les Cétacés à déni s sous le nom de Cétodonles,
et le D' Gray u d o n n é , en 186G celui de Dcnlicètes au même groupe d' animaux.
(') l)ûvi;ii.NOï, Ann. se, nal., 18at, p.
/.oologie et ¡tnléoniolor/ie frauaiises, p. 28Í-.
(') Calaloo of Seals and Whales, p. lO-i.
DES ENVIBOJNS D'ANVEUS.
^ o u s adoptons Ics noms g é n é r a l eme n t r e çus a u j o u r d ' h u i de .ilyslaeoceti, po Cétacés à
fanons, et d'Odonloceli, pour les aut r e s , qui onl lous des dénis à l'âge adulte.
Il n'est pas douteux que si les collections avaienl été plus riches en squelettes de Cétacés l'hisloire
de ces a n ima u x n'eut élé faite par Cuvier il y a un demi-siècle; ma l b e u r e u s eme n l le Muséum
d'histoire naturelle de Pa r i s ne r enf e rma i t pas même un os de la Baleine (pie les Basipies avaient
chassée pendant des siècles dans la Manche et la me r du iVord, ni de lu Baleine f r anche que Ton a
prise pendant deux siècles dans les eaux du Spitzbersí et la me r de Baffin.
Le grand naluraliste du Muséum, en écrivant ses fieclierclies sur les ossemcufs fossiles, n'avail
eu à sa disposition que le squelette de la Baleine du Cap et celui de la Megaplera {¡uc Lalande
avait a[)pt)rlé d'Af r ique ; on ne connaissait de la Baleine franche que la UHo du British Museum
que Líiui'cillard était allé étudier sur place. Le [)i'emier squelette de Baleine f r anche est celui du
Musée de Copenhague qu'Es chr i cht avait reçu des côtes du Groènlaiid par son ami llolboll.
Aujourd'hui encore on ne possède de l'autre espèce, autrefois si c ommu n e d a n s le golfe de Gascogne,
que celui du Baleineau de Sa int -Séba s t i en se t rouvant à Copenhague el celui de l'adulte
échoué dans le golfe de Tá r ent e el qui est aujourd'hui à Naples.
Le défaut de matériaux avait induit Cuvier en e r r e u r au sujet des Baleines vivantes, e(, s'en
rapportant complètement à Scoresby, qui avait assisté à la c aptur e de plusieui's centaines d(! ccs
Cétacés, il avail émi s l'avis que la Baleine chassée dans la Manche jusqu' au X V h siècle, avait
fui devant les pê cheur s pour se r é fugi e r au milieu des glaces polaires.
Eschricht fait connaître avec le professeur l l e inha rd t que ces deux Baleines appa r l i ennen l à des
espèces di f f é r ent e s ; que l'une ne quitte j ama i s les eaux t empérée s et (|ue l'autre ne quitle j ama i s
les glaces.
Quaul à la séparation des Baleines qui portent u
l'utilité de les r éuni r en un genr e distinct sous les r
baleine.
L'autre division de Cuvier, étalilic sur la présence
nageoire sur le dos, on était d'accord sur
is de Balénoptère, de Borqual ou <le Pi é rotme
nageoire dorsale el siu- l'absence de plis
sous la gorge, repose sur une e i r e u r d'ohs(
ion de quelques baleiniers. Le Gibbai' est une
Baleine à bosse, appelée Hump b a c k par les A
is; elle a toujours des plis sous la gorge, mais elle
n'a pas une vraie nageoi r e sur le dos , c'est plutôt une bos s e ; ce qui la distingue ensuite, c'est le
grand développement des nageoires pectoroles. Les Fi nnfisli des baleiniers angl ai s onl un e vraie
nageoire siu' le dos à la place de la bosse. Les pi'emières sont des l^alénoptères ou Pl é roha l e ine s ;
les secondes, des Mégaptèrcs d'après Gray, des K\ p h o h a l e i n e s d'après Escliricht.
Frédéi'ic Cuvier, écrivant Y Histoire naturelle des Cétacés, il y a c inquant e ans, reproduisit la
desci'iption du squelelte des Baleines faite par son frère, en a t t r ibuant à l'espèce du Cap le squeletle
de la Mégaptère et à celle-ci Le squelette de la Baleine. Son frère avait bien fail r ema r q u e r c ependant
que les Baleines ont les ve r t èbr e s cervicales toutes réunies, tandis (|ue les auti'es Mysticèies
les ont toutes séparées.
C'est à feu moti ami Es chr i cht que la science est redevable des g r a n d s progr è s qui onl été faits
en célologie. Le s avant nalui'alistc de Copenhague a reçu les plus précieux ma l é r i aux de la còle
du Groenl and, et, tout en formant à Copenhague le plus r i ch e Musée de squeletles de Cétacés
connus, il a eneore procuré la plu|)ai't de ceux qui se conservent dans les Musées d'Eui'ope.
Eschricht a eu de cette mani è r e le gr and avant age d'avoir pu c omp a r e r un gr and n omb r e de
squeletles eni r e eux, et connne il a r e çu, s u r sa d ema n d e expresse, des foetus de toul âge, il a mont r é ,
le p r emi e r , tout le parti que l'on peut tirer des emb r y o n s de ces oninnuix si diiliciles à mani e r
el à c omp a r e r à i'iigc adulte. Ils présentcnl en mini a tur e tous les caractères qui les di s l inguenl plus
tai'd. C'est lui (jui a fait connaître cpie le nombr e de vertèbre s ne varie pas avec l'âge, que leuj'