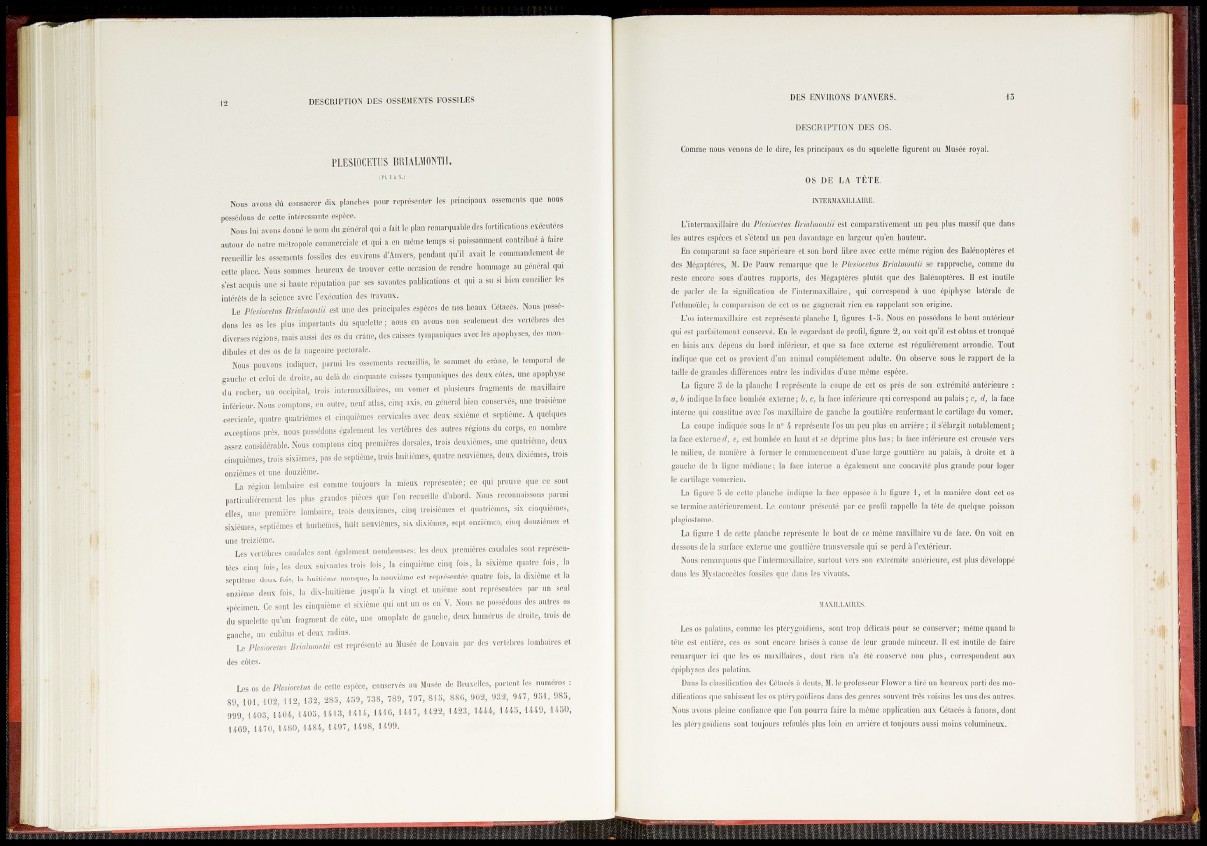
DESCiilPTlON DES OSSEMENTS FOSSILES
P L E S I O C E T I I S B l U A L M O N T l I ,
Nous avons dù consacrer dix planches pour représenter les principaux ossements que nous
posscdoiis de celte intéressante espèce.
Nous lui avons donné le nom du }i^nérai qui a fait le plan remarqnal.lc des forlificalions exécnîées
autour de notre niétropole commerciale el qui a en mime temps si puissamment contribué ii faire
recueillir les ossomenls fossiles des environs d'Anvers, pendant qu'il avait le cominandument de
celle place. Nous sommes lieureux do trouver celte occasion de rendre hommage au général qui
s'est acquis une si haute réputation par ses savantes publications et qui a su si bien concilier les
intérêts de la science avcc rexécution des travaux.
Le Pieûocetus Drialmonlii est une des principales espèces de nos beaux Cétacés. Nous possédons
les os les plus importants du squelette; nous en avons non seulemeiU des vertèbres des
diverses régions, mais aussi des os du crâne, des caisses lympaniqiies avec les apophyses, des man^
dibides et des os de la nageoire peclorale.
Nous pouvons indiquer, parmi les ossemems recueillis, le sommet du crâne, le temporal de
gaucbe et celui de droite, au delà de cinquante caisses tympaniques dos deux côtés, une apophyse
du rocher, un occipital, trois intermaxiliaires, un vomer et plusieurs fragmenls de maxillaire
inférieur. Nous comptons, en outre, neuf ailas, cinq axis, en général bien conservés, une troisième
cervicale, quatre quatrièmes el cinquièmes cervicales avec deux sixième el septième. A quelques
exceplioiis prés, nous possédons également les vertèbres des autres régions du corps, eu nombre
assez considérable. Nous comptons cinq premières dorsales, trois deuxièmes, une (luatriéme, deux
cinquièmes, trois sixièmes, pas de septième, trois buiiièmes, quatre neuvièmes, deux dixièmes, trois
onzièmes et une douzième.
La région lombaire est comme toujours la mieux représentée; ce qui prouve que ce sont
particulièrement les ¡.lus grandes pièces que l'on recueille d'abord. Nous reconnaissons parmi
elles, une première lombaire, trois deuxièmes, cinq troisièmes cl quatrièmes, six cinquièmes,
sixièmes, seplièmes et huitièmes, huit neuvièmes, six dixièmes, sept onzièmes, cinq douzièmes el
une treizième.
Les vertèbres caudales sont également nombreuses; les deux premières caudales sont représentées
cinq fois, les deux suivantes trois fois, la cinquième cinq fois, la sixième quatre fois, la
septième deux fois, la huitième manque, la neuvième est représentée (|uaire fois, la dixième et la
onzième doux fois, la dix-huitième jus<|n'à la vingt el unième sont représentées par un seul
spécimen. Ce sonl les cinquième et sixième (jui ont un os en V. -Nous ne possédons des autres os
du squelette qu'un fragment de côte, une omoplate de gauche, deux humérus de droite, trois de
gaucho, un cubitus et deux radius.
Le PlemceUiH linahnonlii est représenté au .Musée de Louvain par des vertèbres lombaires el
des côtes.
Les os de Pkmcclas de cette espèce, conservés au Musée de Bruxelles, [)Ortcnl les rmméros :
8 9 101 109 1 1 9 , 132, 2 8 3 , 738, 789, 797, 815, 88G, 902, 9 3 2 , 947, 9 i i l , 9 8 5 ,
999, 1 4 0 3 , 1404, 1 4 0 5 , 1413, 1414, 1416, 1 4 1 7 , 1422, 1423, 1444, U 4 5 , 1 4 4 9 , 145U,
1469, 1470, 1 4 8 0 , 1 4 8 4 , 1497, 1498, 1499.
DES ENVIRONS D'ANVERS. iZ
DESCRIPTION DES OS.
Comme nous venons de le dire, les principaux os du squelette figurent au Musée royal.
OS DE LA TÊTE.
INTERMIX I1.1AIRE.
L'interniaxiilaire du Plesioce/us Brialmonlii est comparalivement un peu plus massif que dans
les autres espèces el s'étend un peu davantage en largeur qu'en hauteur.
En comparant sa face supérieure et son bord libre avec celle même région des Balénoptères el
des Méguptères, M. De Pauw remarque que le Plesiocetus Brialmonlii se rapproche, comme du
reste encore sous d'aulres rapports, des Mégaptéres plutôt que des Balénoptères. Il est inutile
de parler de la signification de rintei-maxillaire, qui correspond à une épipliyse latérale de
l'ellunoïde; la comparaison de cet os ne gagnerait rien eu rappelant son origine.
L'os intermaxillairc est représenté planche 1, figures l - o . Nous en possédons le bout antérieur
qui est parfaitemenl conservé. En le regardant de profil, figure 2, on voit qu'il est oblus et tronqué
en biais aux dépens du bord inférieur, et que sa face externe est régulièrement arrondie. Tout
indique que cet os provient d'un animal complètement adulte. On observe sous le rapport de la
laille de grandes différences entre les individus d'une même espèce.
La figure 3 de la planche 1 représenle la coupe de cet os près de son extrémité antérieure :
«, b indique la face bombée externe; b, c, la face iuférieure qui correspond au palais ; c, d, la face
inlerne qui constitue avec l'os maxillaire de gauche ia gouttière renfermant le cartilage du vomer.
La coupe indiquée sous le n° 4 représeute l'os un peu plus eu arrière; il s'élargit notablement;
la face externe d, e, est bombée en haut et se déprime plus bas; la face inférieure est creusée vers
le milieu, de manière à former le commencement d'une large gouttière au palais, à droite et à
gauche de la ligne médiane; ia face inlerne a également une concavité plus grande pour loger
le cartilage vomerien.
La figure 5 de cette planche indique la face opposée à îa figure 1, et la manière dont cet os
se termine antérieurement. Le contour présenté par ce profil rappelle la tète de quelque poisson
plagiostome.
La figure 1 de cette planche représente le bout de ce môme maxillaire vu de face. On voit en
dessous de la surface externe une goultière transversale qui se perd à l'extérieur.
xXous remarquons que rintcrmaxillairc, surlout vers son extrémité aniérieure, est plus développé
dans les Mystacocètes fossiies que dans les vivants.
MAXlt.l.AlIllïS.
Les os palatins, comme les ptérygoïdiens, sont trop délicats pour se conserver; môme quand la
tèle est entière, ces os sonl encore brisés à cause de leur grande minceur. Il est inutile de faire
remarquer ici que les os maxillaires, dont rien n'a été conservé non plus, correspondent aux
épiphyses des palatins.
Dans la classification dos Cétacés à dents, M. le professeur Flower a tiré un heureux parti des modilicalions
que subissent les os ])térygoïdiens dans des gem-es souvent très voisins les uns des autres.
Nous avons pleine confiance que l'on pourra faire la même application aux Célacés à fanons, dont
les ptérygoïdiens sonl toujours refoulés plus loin en arrière et toujours aussi moins volumineux.
• Î î l M i