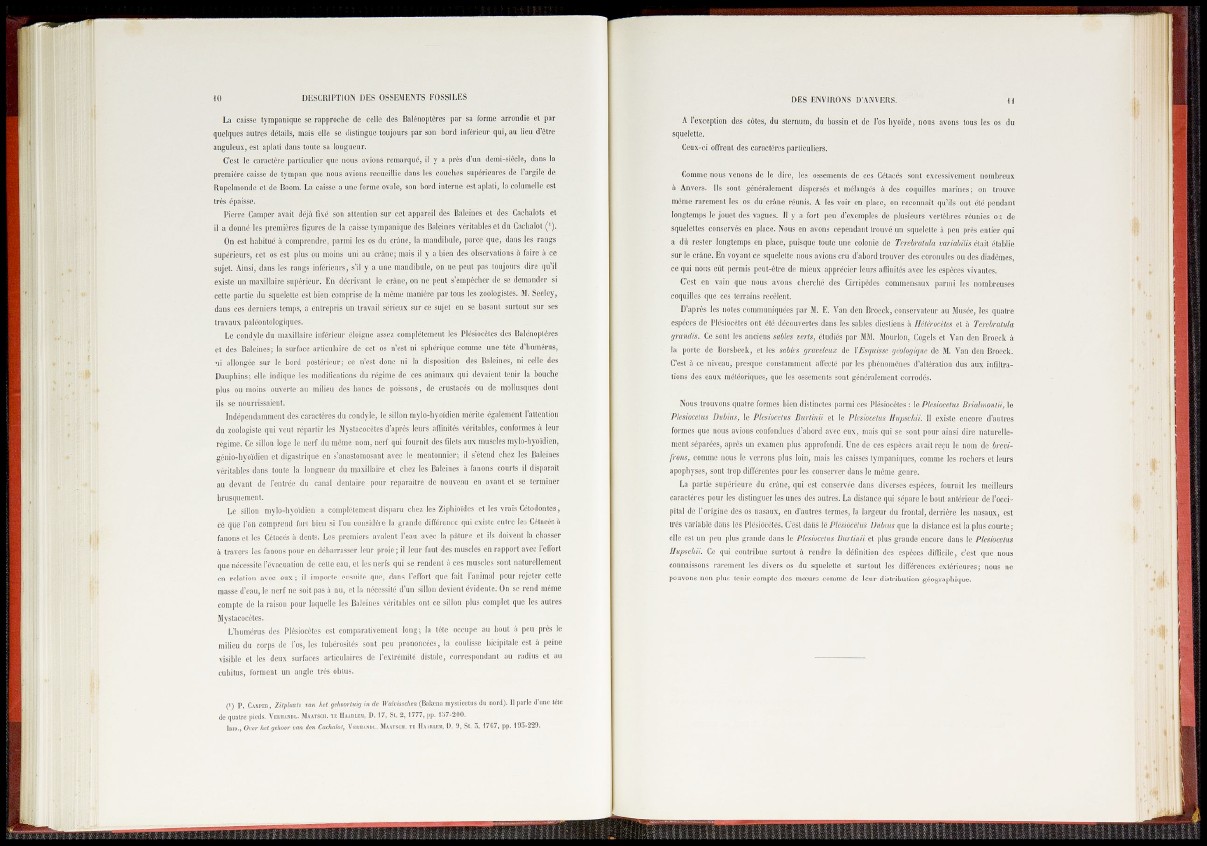
10 DESCRIPTION DE S OSSECIENTS FOS S I L E S
La caisse t ymp a n i q u e se r a p p r o c h e de celle des Ba l énopt è r es p a r sa forme a r r o n d i e et p a r
quelques a u t r e s détails, ma i s elle se ilistingae t o u j o u r s pa r son bord i a f é r i enr q u i , au lieu d' ê t re
anguleiix, est aplati d a n s toute sa l o n g u e u r .
C'est le c a r a c t è r e pa r t i cul i e r q u e nous avions r ema r q u é , il y a pr è s d'un demi - s i è c l e , d a n s la
première caisse de t ymp a n q u e n o u s avions recueillie dans les c o u c h e s supé r i eur e s de l'argile de
Rupelmondc et de Boom. La caisse a u n e f o rme ovale, son bord int e rne est apl a t i , la columc l le est
très épa i s s e.
P i e r r e Ciunper ava i t déjà fixé son a t t ent ion s u r cet apparei l des Baleines et des Cachalots et
il a d o n n é les p r emi è r e s f igur e s de la caisse t ymp a n i q u e (les Baleines vé r i t abl e s cl du Cachalot ( ' ) .
On est h a b i t u é à c omp r e n d r e , p a rmi les os du c r â n e , la ma n d i b u l e , pa r c e q u e , d a n s les r a n g s
supérieurs, c et os est plus ou mo i n s uni au c r â n e ; mais il y a bien d e s obs e rva t ions ù f a i r e à ce
s u j e t . Ainsi, d a n s les r a n g s i n f é r i e u r s , s'il y a u n e ma n d i b u l e , on ne p e n i pas toujour s d i r e (|u'il
existe un maxi l l a i r e s u p é r i e u r . En d é c r i v a n t le c r â n e , on ne peut s ' emp ê c h e r de se d ema n d e r si
cette pa r t i e du squelette esl bi en compr i s e de la même ma n i è r e pa r tous les zoologistes. Jl. Se e l ey,
dans ces d e r n i e r s temps, a e n t r e p r i s un travail s é r i eux sur ce suj e t en se b a s a n t sur tout sur ses
travaux pa l éontologique s .
Le c o n d y l e du maxi l l a i r e inf é r i eur é loigne assez c omp l è t eme n t les Plésiocéies dos Ba l énopl é r e s
et des Ba l e i n e s ; la sur f a c e a r t i cul a i r e de cet os n'est ni s p h é r i q u e c omme u n e tè t e d ' h umé r u s ,
ni a l longée sur le b o r d pos t é r i eur ; ce n'est donc ni la disposition des Ba l e ine s , ni cclle d e s
Dauphins; elle indiqu e les modilîcations du r é g ime de ces a n ima u x qui deva i ent tenir la b o u c h e
plus ou mo i n s ouve r t e au milieu des b a n c s de poi s sons , de c rus t a c é s ou de mol lusque s dont
ils se nour r i s s a i ent .
Indépendamment d e s c a r a c t è r e s du condyl e , le sillon my l o - h y o ï d i e n mé r i t e é g a l eme n t l'altcnlion
d u zoologiste qui veut r é p a r t i r les Myslacocète s d' apr è s l eur s ailinités véritables , c o n f o rme s à leur
régime. Ce sillon toge le nerf du même n om, nerf qui f o u r n i t des filets a u x mu s c l e s my l o - h y o ï d i e n,
génio-hyoïdien et diga s t r ique en s ' ana s tomos ant ave c le me n t o n n i e r ; il s'étend che z les Baleines
véritables dans toute la l o n g u e u r du maxi l l a i r e et che z les Baleines à f a n o n s cour t s il di spa r a î t
au d e v a n t de l ' ent r é e du canal d e n t a i r e potir r e p a r a î t r e de nouve au en a v a n t et se t e rmi n e r
brust|uemenl.
Le sillon my l o - h y o ï d i e n a c omp l è l eme n t di spa ru chez les Ziphioïde s et les vrais Cé t o d o n t e s ,
ce q u e l'on c omp r e n d fort bien si l'on cons idè re la g r a n d e dilTérence qui existe e n t r e les Cétacés à
fanons et les Cétacés à dent s . Les p r emi e r s ava l ent l 'e au ave c la p â t u r e et ils doivent la cha s s e r
à t r a v e r s les f anons pou r en d é b a r r a s s e r leur proie ; il l eur faut des mus c l e s en r a p p o r t avec l'efiort
que né c e s s i t e l ' éva cua t ion de celte e a u , et les nerfs <|ui se r e n d e n t ù ces mu s c l e s sont n a t u r e l l eme n t
en r e i a i ion ave c eux ; il imp o r t e ensui t e q u e , dans l'effort q u e fait l'animal p o u r r e j e t e r cette
masse d' e au, le ne r f ne soit pas à nu, et ia nécessité d'un sillon devi ent évident e . On se r e nd même
compte de la raison pou r laquell e les Ba l e ine s véritables ont ce sillon plus compl e t q u e les a u t r e s
Myslacocètes.
L'humérus d e s Plésiocéies est c omp a r a t i v eme n t l o n g ; la lète oc cupe au bout ù peu près le
milieu du c o r p s de l'os, les tubé ros i t é s sont peu p r o n o n c é e s , la coulisse bic ipi ta lc est à pe ine
visible et les d e u x sur f a c e s a r t i cul a i r e s de l ' ext r émi t é di s t a l e , c o r r e s p o n d a n t au r adius et au
cubitus, f o rme n t un a ngl e t r è s obtus .
(1) P. CAMPER, Zilplaals lan liei gehoorltiig m de Walvissclien {Mxm mysiicelus du nord). Il parle d'une tóic
d e q u a t r e p i e d s . VERMANDI- MAATSC». HAARLEM, D. 1 7 , S I . 2, 1 7 7 7 , ¡ )p. 1 5 7 - 2 0 0 .
IBIO-, 0 « R hct gehoor van den Cachalot, VKTIIIASDL. MAATSCII. TE IIAVRLEM, U. 9, S I . 3, 1 7G7 , p p . 1 9 5 - 2 2 9 .
DES ENVIRONS D'ANVERS. \i
A l'exception des côles, du s t e r n um, du bassin et de l'os h y o ï d e , n o u s a v o n s tous les os du
squelette.
Ceux-ci of f r ent des c a r a c t è r e s particuliers.
Comme nous venons de le di r e , les os s ement s de ces Cétacés sont e x c e s s i v eme n t n omb r e u x
à An v e r s . Ils sont g é n é r a l eme n t di spe r s é s et mé l a n g é s à des coquille s ma r i n e s ; on t rouve
même r a r eme n t les os du c r â n e r éuni s . A les voir en place, on r e c o n n a î t qu'ils ont été p e n d a n t
longtemps le j o n e t des v a g u e s . Il y a fort peu d' exempl e s de plus i eur s v e r t è b r e s r éuni e s ou de
squelettes cons e rvé s en place. Nous en a v o n s c e p e n d a n t t rouvé un sque l e t t e ù peu près e n t i e r qui
a dû r e s t e r longt emps en place, pui s qu e tout e une colonie de Terebralida variabilis était établie
sur le c r â n e . En v o y a n t ce sque l e t t e nous avions cru d'aboi'd t r o u v e r des c or onul e s ou des di adème s ,
ce qui nods e û t p e rmi s p e u t - ê t r e de mi e ux a p p r é c i e r l eur s affinités ave c les e spè c e s vivantes.
C'est en vain q u e nous avons c h e r c h é des Ci r r ipède s c omme n s a u x pa rni i les n omb r e u s e s
coquilles q u e ces t e r r a i ns recèlent .
D'après les notes c ommu n i q u é e s pa r M. E. Va n den Br oe c k, conservateui ' au Mus é e , les q u a t r e
espèces de Plésiocéies ont été dé c ouve r t e s d a n s les sables diestiens à Hctcrocèles et à Terebralvia
grandis. Ce sont les anc i ens sables vnrls, étudiés p a r MM. Mourlon, Cogels et Va n den Broe ck à
la por t e de Bo r s h e e k , et les sables graveleux de VEsquisse géologique de M. Van den Broe ck.
C'est à ce nive au, p r e s q u e c o n s l amme n t affecté pa r les p h é n omè n e s d' a l t é r a t ion d u s a u x inf i l t r a -
tions d e s e a u x mé t éor ique s , q u e les os s ement s sont g é n é r a l eme n t cor rodé s .
Nous t r o u v o n s q u a i r e forme s b i e n distinctes p a rmi ces Plésiocéies : le Plesiocetus Brialmonlii, le
Plesiocelus Dubiiis, le Plesioceius Burtinii et le Plesiocetus llupschii. 11 existe e n c o r e d' aut r e s
formes q u e nous avions cou fondue s d' abord ave c e u x , ma i s qui se sont p o u r ainsi d i r e n a t u r e l l e -
ment s épa r é e s , apr è s un e x ame n plus approfondi . Un e de ces espèces avait reçu le n om de brevifrons,
c omme nous le ve r r on s plus loin, ma i s les caisses t ymp a n i q u e s , c omme les r o c h e r s et l eur s
apophyses, sont li'op di f f é r ent e s pou r les cons e rve r d a n s le même g e n r e .
La partie s u p é r i e u r e du c r â n e , qui est cons e rvé e dans dive r s e s e spè c e s, fourni t les me i l l eur s
caractères pou r les di s t ingue r les une s des aut r e s . La di s t anc e qui s é p a r e le bou t a n t é r i e u r de l'occipital
de l 'or igin e des os na s aux, en d' aut r e s t e rme s , la l a r g e u r du f ront a l , d e r r i è r e les n a s a u x , est
très v a r i a b l e dans les Plésiocètcs. C'est dans le Plesiocelus Dubias q u e la d i s t a n c e est la plus c o u r t e ;
elle est un peu plus g r a n d e d a n s le Plesiocelus liurUnii cl plus g r a n d e encor e d a n s le Plesiocelus
Hupschii. Ce qui c o n t r i b u e s u r t o u t à r e n d r e la définition des espèces difficile, c'est q u e nous
connaissons r a r eme n t les dive r s os du squelette et s u r t o ut les dilTérences e x t é r i e u r e s ; n o u s ne
pouvons non plus t eni r compt e des moeu r s c omme de l e u r di s t r ibut ion g é o g r a p h i q u e .