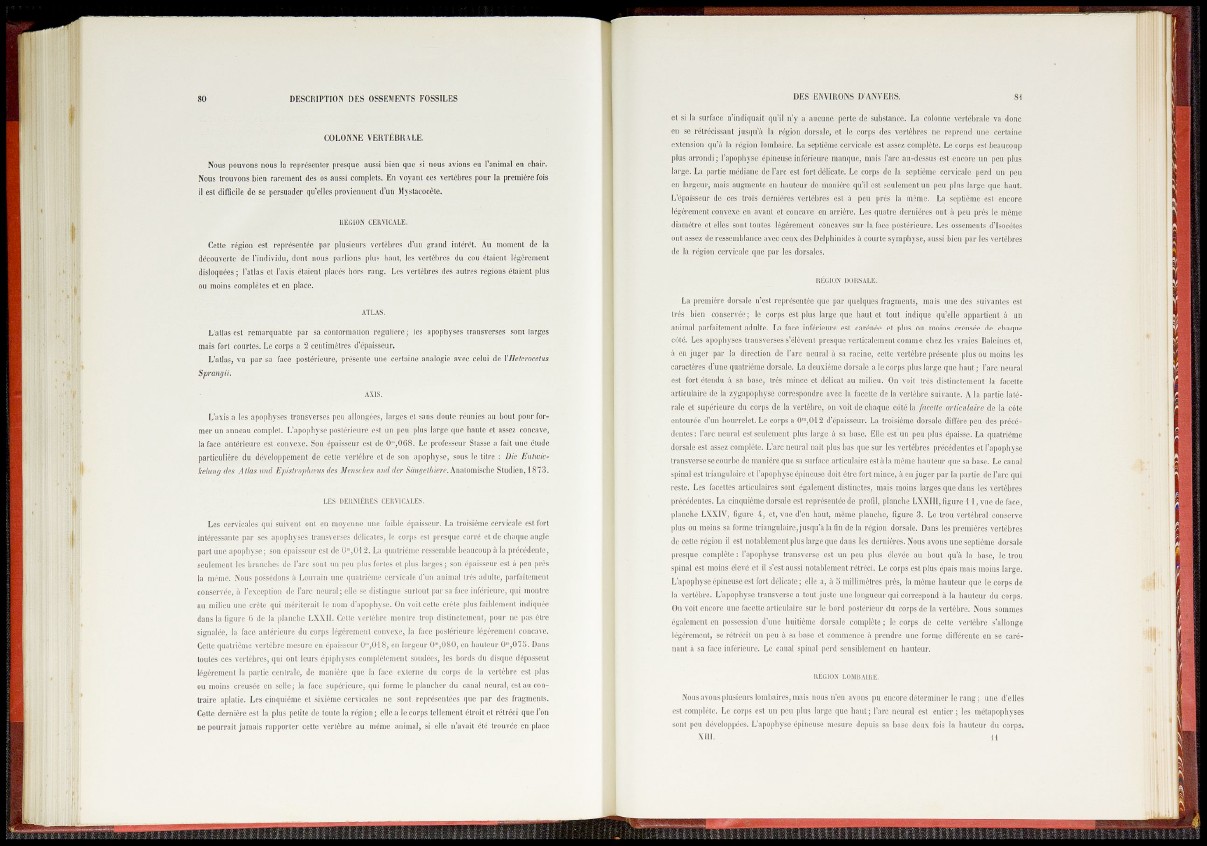
80 DESCRIPTION DES OSSEMENTS FOS S ILES
COLONNE VERTEBRALE.
Nous pouvons nous la r epr é s ent e r presque aussi bien que si nous avions eu l'animal en chair.
Nous t rouvons bien r a r eme n t des os aussi complets. En voyant ces ve r t èbr e s pour la pr emi è r e fois
il est diiTiclle de se pe r suade r qu'elles provi ennent d'un Mystacocéte.
UÉGlOiN CERVICALE.
Cette région est r epr é s ent é e par plusieurs vertèbre s d'un gr and intércH. . \u mome n t de la
découverte de l ' individu, dont n o u s parlions plus haul, les ve r t èbr e s du cou étaient légèrement
disloquées; l'atlas ci l'axis élaieiil places hor s r a n g . Los ve r t èbr e s des aut r e s r égions étaient plus
ou moins compl è t e s et en place.
ATLAS.
L'atlas est r ema r q u a b l e par sa coiiformalion r égul i è r e ; les apophys e s i r ansve r s e s .«ont larges
mais fort cour t e s . Le corps a 2 c ent imè t r e s d' épa i s s eur .
L'atlas, vu p a r sa face pos t é r i eur e , pr é s ent e u n e c e r t a ine analogie ave c celui de yIleterocetus
Spranga.
L'iixis a les a p o p h y s e s t r ansve r s c s peu allonirées, larges et sans dout e r éuni es au bout pour former
un anne a u complel. L' apoj jhys e pos t é r i eure esl un peu plus large (|ue haut e et assez concave,
la face ant é r i eur e est convexe . Son épa i s s eur est de 0 " ' , 0 6 8 . Le professeur Slasse a fait un e é tude
particulière du déve l oppement de cette vertèhro et de son a p o p h y s e , sous le tilre : Die Enlwichelmg
des Arias lutd Epislrophoevs des Me»s<:heu nnd dcr Aiialomische S l u d i e n , 1 8 7 3 .
LES DEliNlÈIiES CERVICALES.
Les cervicales qui suivent ont en mo y e n n e un e faible épaisseur. La troisième cervicale est fort
intéressante par ses a p o p h y s e s t r ansve r s e s délicates, le coi'[)b est pi'csque c a r r é cl de c h a q u e angl e
part un e a j ) 0 p h y s e ; son épa i s s eur esl de U'",012. La iiuatriènic re:rscini)le be aucou p à la pr é c édenin,
seulement les b r a n c h e s de l'arc sonl un peu plus forles et plus larges ; son ('[¡aisseur est à peu pr ès
la mi'nie. Nous pos s édons à Louvain un e qua t r i ème cervicale cruii animal li'ès adulte, parfailemeni
conservée, à rexceplioii de l'arc n e u r a l ; elle se distingue s ur i ou l j)ar sa face inférieure, qui moiiti'c
au milieu une crête qui mé r i t e r a i t le nom d' apophys e . On voit cette cnMe plus f a ibl ement indiquée
dans la figure 6 de la |)lanche LXXI I . Celle ve r t èbr e mo n t r e t rop di s t inc t emeni , pour ne pas être
signalée, la face a n l c r i e n r e du corps l égè r ement convexe , la face po.slérieuro l égè r emcnl concave.
Celle qua t r i ème ve r t èbr e me s u r e en épa i s s eur 0 " ' , 0 1 8 , en l a rgeur 0 ' " , 0 8 0 , en h a u t e u r 0 " ' , 0 7 5 . Dans
toutes ces ve r t èbr e s , qui onl leurs epiphys e s compl è l cment soudées, les bords du disque dépassent
légèrement la partie eeiilralc, de ma n i è r e qu e la face c x i e r n e du corps de la ve r t èbr e est plus
ou moins c r eus ée en s e l l e ; la f a c e supé r i eur e , qui forme le pl anche r du canal neural, esl au contraire
aplalie. Les c inqui ème et sixième cervicales ne sonl r epr é s ent é e s que par des fi'agments.
Celte de rni è r e est la plus pelile de tout e la r é g i o n ; elle a le corps t e l l ement étroit et rétréci que l'on
ne pour r a i t j ama i s r a p p o r t e r cette ve r t èbr e au même anima i , si elle n'avait été t rouvé e en place
DES ENVIRONS D'ANVERS. 8 i
et si la surface n'indiquait qu'il n'y a a u c u n e pe r l e de subs t anc e. La colonne ve r t ébr a l e va d o n c
en se rétrécissant jusqu' à la région dorsale, et le corps des ve r t èbr e s ne r e p r e n d u n e c e r t a ine
extension qu'à la région lombai re. La sqUi ème cervicale est assez compl èt e . Le corps est be aucoup
plus arrondi ; l ' apophys e épineus e inf é r i eur e ma n q u e , mais l'arc au-de s sus est encor e un peu plus
large. La partie mé d i a n e de l'arc est fort délicate. Le corps de la se|)tième cervicale pe rd un peu
en l a rgeur , mais a u gme n t e en haut eur de ma n i è r e qu'il est s e u l eme n t un peu plus l a rge qu e h a u t .
L'épaisseur de ces trois de rni è r e s ve r t èbr e s est à peu près la même . La s ept i ème est e n c o r e
légèrement convexe en avant et concave en a r r i è r e . Les qua t r e de rni è r e s out à peu près le même
diamètre et elles sont toutes l égè r ement concaves sur la face pos t é r i eur e . Les os s ement s d'Isocètes
ont assez de r e s s embl anc e ave c c eux des De lphinide s à courte s ymp h y s e , aussi bien par les vertèbre s
de la région cervicale que par les dorsales.
lOECiON DORSALE.
La pr emi è r e dorsale n'est r epr é s ent é e que par que lque s f r agment s , ma i s une des suivant e s est
très bien c o n s e r v é e ; le corps est plus l a rge que haut et tout indique qu'elle appa r t i ent à un
animal pa r f a i t ement adul t e . La face inf é r i eur e esl c a r é n é e et plus ou moins c r eus é e de c h a q u e
côté. Les apophys e s t r ansve r s e s s'élèvent p r e s q u e ve r t i c a l emenl c omme che z les vraies Baleines et,
à en j u g e r par !a direction de l'arc neural à sa r a c ine , cette v e r t è b r e pr é s ent e plus ou moins les
caractères d'une qua t r i ème dorsale. La d e u x i ème dorsale a le corps |)lus l a rg e que haut ; l'arc neur a l
est fort é t endu à sa ba s e , très minc e et délicat au milieu. On voit très di s t inc t emen t la facette
arliculaire de la z y g a p o p h y s e cor r e spondr e ave c la facel le de la ve r t èbr e suivant e . A la pa r t i e l a t é -
rale et supé r i eur e du corps de la ve r t èbr e , on voit de c h a q u e côté la facette arliculaire de la côte
entourée d'un bour r e l e t . Le corps a O ^ O I S d'épaisseur. La troisième dorsale diffère peu des pr é c é -
dentes: l'arc neur a l esi s eul ement plus l a rge à sa base. Elle est un peu plus épaisse. La q u a t r i ème
dorsale est assez complète. L' a rc neur a l nait plus bas qu e sur les ve r t èbr e s pr é c édent e s et l ' apophys e
transverse se c o u r b e de ma n i è r e qu e sa sur f a c e ar l i cul ai r e e s t à la même h a u t e u r ( j u e s a base. Le c ana l
spinal est triangulaire et l ' apophys e épineuse doit être fort minc e , à en j u g e r p a r la pa r t i e de l'arc qui
reste. Les facettes articulaires sont éga l ement distinctes, ma i s moins larges que d a n s les v e r t è b r e s
précédentes. La c inqui ème dorsale est r epr é s ent é e de profil, pl anche LXXI I I , figure 1 1 , v u e de f a c e ,
planche LXXIV, figure 4, et, vue d'en haul, même pl anche , figure 3. Le t rou ve r t ébr a l cons e rve
plus ou moins sa forme t r i angul a i r e, j u s q u ' à la fin de la r égion dorsale. Da n s les p r emi è r e s ve r t èbr e s
de celte région il est n o t a b l eme n t plus large que d a n s les dernières. Nous avons un e s ept i ème dorsale
presque c omp l è t e : l ' apophys e t r ansve r s e est un peu plus élevée au bout qu' à la base, le t rou
spinal est moins élevé et il s'est aussi not abl ement rétréci. Le corps est plus épais ma i s moins l a r g e .
L'apophyse épineuse est fort délicate ; elle a, à 3 millimètres jirès, la même h a u t e u r q u e le corps de
la vertèbre. L' apophys e t r ansve r s e a lout j u s t e une l ongueur qui cor r e spond à la h a u t e u r du corps.
On voit encor e un e faceti e ar l i cul ai r e s u r le bord postérieur du corps de la ve r t èbr e . Nous s omme s
également eu possession d ' u n e hui t i ème dor s a l e c omp l è t e ; le corps de cette ve r t èbr e s ' a l longe
légèrement, se rétrécit un peu à sa ))ase et c omme n c e à p r e n d r e un e f o rme dilîérente en se c a r é -
nant à sa face inférieure. Le canal spinal perd s ens ibl ement en h a u t e u r .
RÉGION LUMliAlRE.
Nous avons plusieurs lombaires, ma i s nous n'en avons pu encor e d é t e rmi n e r le r a n g ; u n e d'elles
est compl èt e . Le corps est un peu plus l a rge que h a u l ; l'arc neural est e n t i e r ; les mé l apopl ivs e s
sont peu développées. L' apophys e épineuse me s u r e depuis sa base deux fois la h a u t e u r d» corps .
MU. 11