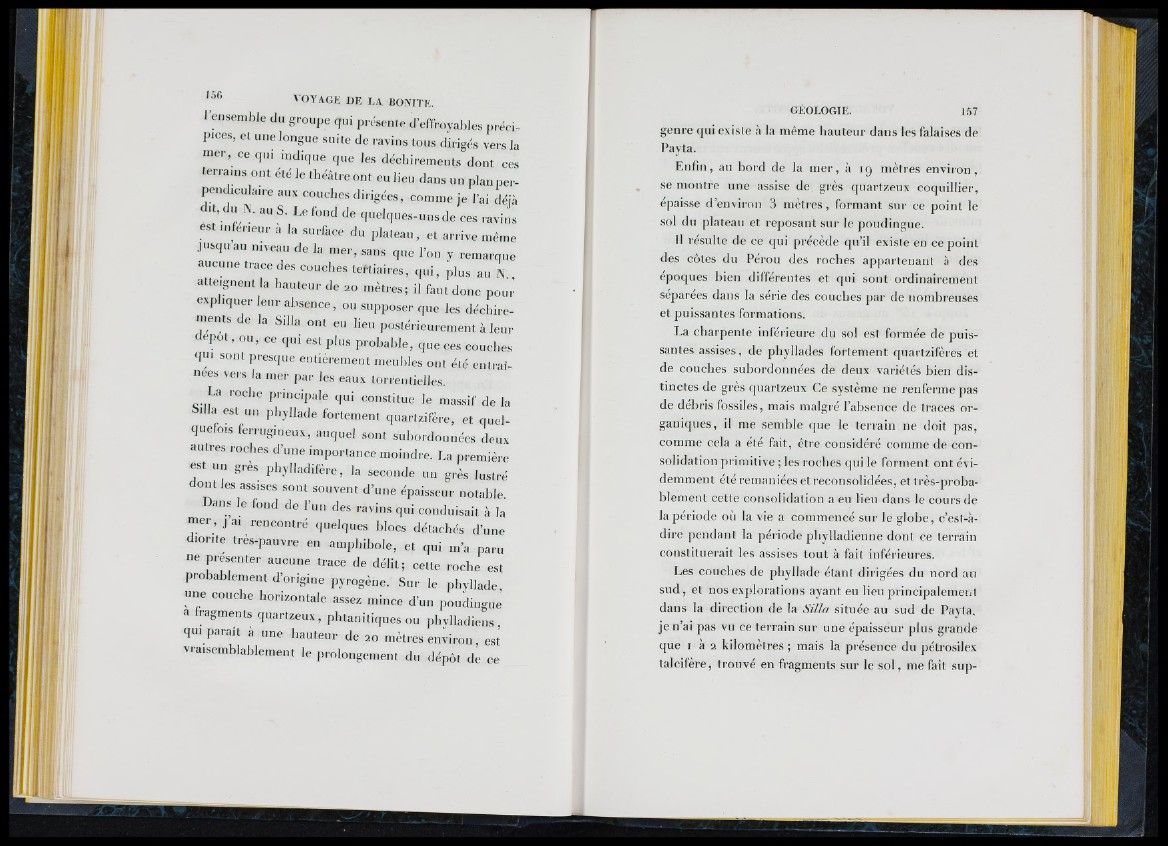
Y OYAGE DE EA BONITE,
l’ensemble dn grouj.e qui présente d’eflVoyables pr écipices,
et une iongne suite de l'avins tous dirigés ver s Ja
mer, ce qui indique que les déclrirernents dont ces
«erra,ns ont été le ibéâtr e ont en lieu dans un plan per-
pcrrrhcularre aux couches dirigées, comme je Fai déjà
du, d.r N. au S. Le fond de qirelques-nnsde ces ravirrs
est rnferreur à la surface dn plaleau, et ar rive même
,1-squan nrveau de la mer, sans qrre l’on y remarqrre
ancnne trace des conciles tertiaires, qui, pins au N.,
attergnent la iranteirr de 20 mètres; il faut donc pour’
exp rqner leru' abserrce, on supposer ipre les déchirements
de la Silla ont en lien liostér ieur ement à leur
‘iepol, on, ce qui est pirrs pr obable, que ces couches
qui soin pi-esqne eiitièiemeiit meubles ont été entraînées
vers la mei' par- les eaux torreiitielles.
La rocl.e principale ipri constilne le massif de la
illa est nn phyllade fortement quar tzifère, et quelquefois
feiTiigirienx, auquel sont snliordonnées deux
auti'es roches d’une importance moindr e. La pr emièr e
« t un gr-ès phylladifère, la seconde nn grès lustré
dont les assises sont souvent d ’une épaisseur notable
Bans le fond de l’un des ravins qui conduisait à la
mer , j ai rencont.-é quelques blocs détachés d’nne
d.orrte tres-pauvre en amiiliibole, et qui m’a pai-n
ne présente,' aucune trace de délit; celte roche est
probablement d’oirgine pyrogène. Sur' le phyllade,
une couche horizontale assez mince d’un poudingue
a fragments quartzeux, plitanitiqnes ou pbylladiens ,
qui parait à une liautenr de 20 mètr es envir'on , est
vrar.semblahlement le prolongement d„ dépôt de ce
genre qui existe à la même liauleiir dans les falaises de
l’ayta.
Enfin, au bord de la mei', à 19 mètres environ,
se montre une assise de grès quartzeux coquillier',
épaisse d ’envii'on 3 mètres, formant sur ce point le
sol du plateau et reposant sur le poudingue.
11 résulte de ce qui précède qu’il existe en ce point
des côtes du Péi-on des roches appartenant à des
époques bien différentes el qui sont ordinairement
sépar ées dans la série des couclies par' de nombi'euses
et puissantes formations.
La charpente inféiieni'e dn sol est formée de puissantes
assises, de phyllades fortement qnartzifèies et
de couches subordonnées de deux variétés bien distinctes
de grès qnai’tzeux Ce système ne reiifei'me pas
de débris fossiles, mais malgré l’absence de ti'aces oi'-
ganiqiies, il me semble que le terrain ne doit pas,
comme cela a été fait, être considéré comme de consolidation
pr imitive ; les r ocbes qui le foiiiient ont évidemment
été remaniées et reconsolidées, et très-probablement
cette consolidation a eu lien dans le coin s de
la période où la vie a commencé sur le globe, c’est-à-
dire pendant la période phylladienne dont ce ten-ain
constituerait les assises tout à fait iiiféi'ienres.
Les couches de phyllade étant dirigées du nord au
sud, et nos explorations ayant eu lien principalemeiD
dans la dir ection de la Süla située an sud de Payta,
je n’ai pas vu ce ter rain sur une épaisseur pins grande
que I à 2 kilomètres ; mais la pr ésence dn pétrosilex
talcifère, trouvé en fragments sur le sol, me fait sup