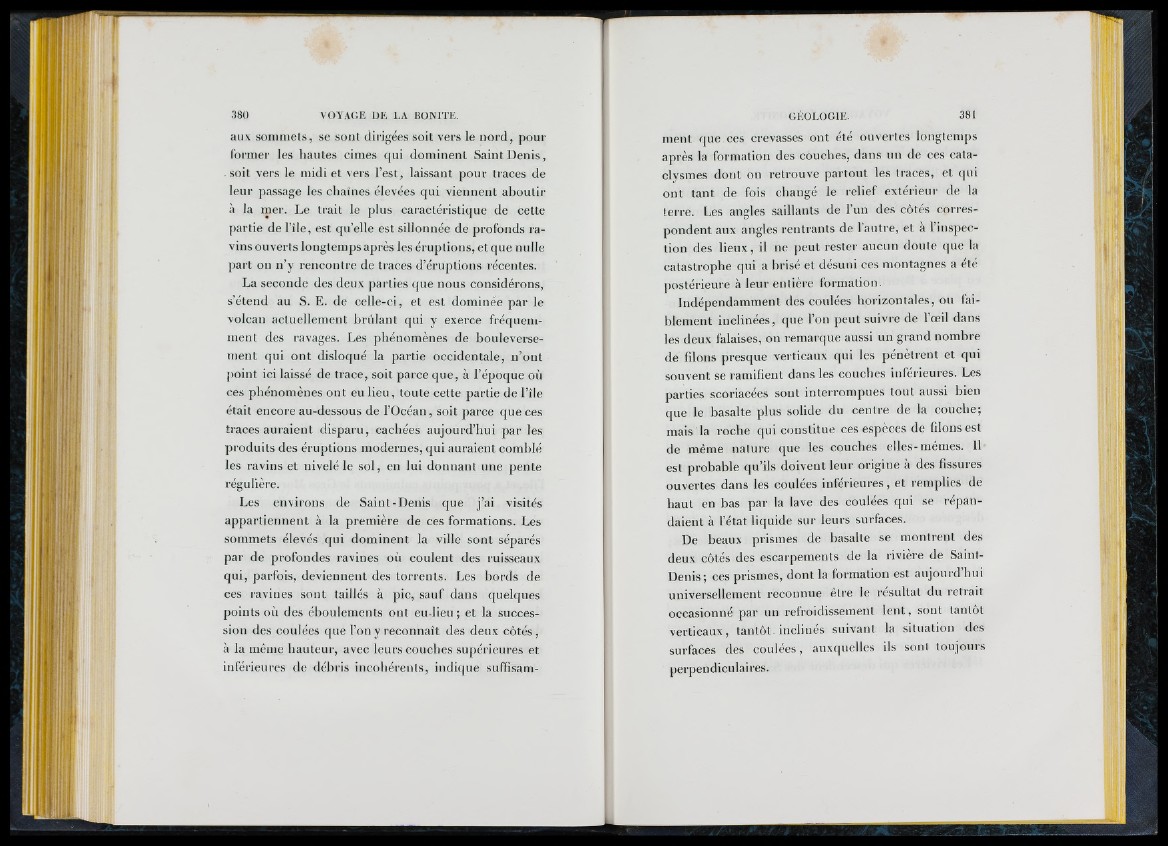
i'l
i* II,
aux sommels, se sont dirigées soit vers le nord, pour
former les hautes cimes qui dominent Saint Denis,
soit vers le midi el vers l’est, laissant pour traces de
leui' passage les cliaines élevées qui vieuuenl aboutir
à la ruer. Le trait le plus caractéristique de cette
partie de l’île, est qu’elle est sillonnée de profonds ravins
ouvert s longtemps après les éruptions, et que nulle
part on u’y rencontre de tiaces d’éruptions récentes.
La seconde des deux parties que nous considérons,
s’étend au S. E. de celle-ci, et esl dominée par le
volcan actuellement brûlant qui y exerce fréquemment
des ravages. Les phénomènes de bouleverse-
uieut (¡ui ont disloqué la partie occidentale, u’out
jioiut ici laissé de trace, soit parce que, à l’époque oû
ces phénomènes ont eu lieu, toute cette partie de l’île
était encore au-dessous de l’Océan, soit parce que ces
traces auraient disparu, cachées aujourd’hui par les
produits des éruptions modernes, qui auraient comblé
les ravins et nivelé le sol, en lui donnant une pente
régulière.
Les environs de Saiul-Deuis que j’ai visités
appartiennent à la première de ces formations. Les
sommets élevés c[ui dominent la ville sont séparés
par de profondes ravines oû coulent des ruisseaux
qui, parfois, deviennent des torrents. Les bords de
ces ravines sont taillés à pic, sauf dans quelques
points oû des éboulements ont eii-Iieu; et la succession
des coulées que l’on y reconnaît des deux côtés,
à la même hauteur, avec leurs couches supérieures et
iuféi'ieures de débris incohérents, indique suffisamment
que ces crevasses ont été ouvertes longtemps
après la formation des couches, dans un de ces cataclysmes
dont ou retrouve partout les traces, et qui
ont tant de fois change le relief exlérieui' de la
terre. Les angles saillants de l’un des côtés correspondent
aux angles rentrants de l’autre, et à l’inspection
des lieux, il ue peut rester aucun doute que la
catastrophe qui a brisé el désuni ces montagnes a été
postérieure à leur entière formation.
Indépendamment des coulées horizontales, ou lai-
biemeut inclinées, que l’on peut suivre de l’oeil dans
les deux falaises, ou remarque aussi un grand nombre
de fdons presque verticaux qui les pénètrent et qui
souvent se ramifient dans les couches inférieures. Les
parties scoriacées sont interrompues tout aussi bien
que le basalte plus solide du centre de la couche;
mais la roche qui constitue ces espèces de filous est
de même nature que les couches elles-mêmes. 11
est probable qu’ils doivent leur origine à des fissures
ouvertes dans les coulées inférieures, et remplies de
haut en bas par la lave des coulées qui se répandaient
à l’état liquide sur leurs surfaces.
De beaux prismes de basalte se montrent des
deux côtés des escaipements de la rivière de Saint-
Denis; ces prismes, dont la formation est aujourd’bui
universellement reconnue être le résultat du retrait
occasionné par uu refroidissement lent, sont tantôt
verticaux, tantôt inclinés suivant la situation des
surfaces des coulées, auxquelles ils sont toujours
perpendiculaires.